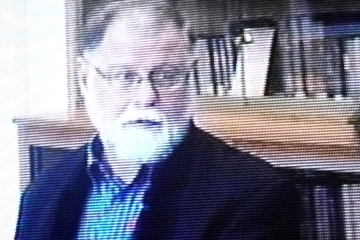
La Cité des mots : de l’éditeur comme accordeur, et de la littérature comme socialement superflue
Je suis habitué maintenant des livres d’Alberto Manguel. Et s’il a retenu la leçon de Borges, dont il a été, à 16 ans, le lecteur à haute voix, c’est dans cet art de prendre écart. Et d’aborder les points les plus obscurs de notre relation au monde par où ils deviennent des puits d’imaginaire, et cheminer vers eux par la littérature, mais un rapport à la littérature qui à la fois guide dans un infini retour aux oeuvres maîtres, et ne sépare pas de ce chemin l’écriture, l’intuition, la forme, ni le rêve.
On s’y habitué, pour Alberto Manguel, dans cette vie qui lui a fait traverser toutes les langues et les pays, avant d’installer sa bibliothèque à proximité de Poitiers, dans son Journal d’un lecteur, dans son Histoire de la lecture, dans le Dictionnaire des lieux imaginaires ou plus récemment La bibliothèque, la nuit.
Dans La Cité des mots, il s’agit de cinq conférences, de ces rendez-vous qu’on vous assigne dans un cadre prestigieux, avec suffisamment de poids pour que ce soit, pour soi-même, un rendez-vous sur le fond. Ces conférences ont été données en octobre 2007 au Massey College de Toronto, et diffusées en direct à la radio : on peut les écouter ici (en anglais).
Voici donc l’exercice : vous allez avoir 60 ans, vous êtes entré en littérature via l’adoubement direct de Borges et vous y avez consacré votre vie – que choisissez-vous pour vos 5 thèmes ?
Aussi, c’est un livre qui résiste. L’impression qu’Alberto vous parle de zones périphériques, qui ne sont pas ce qu’on attend quand à une approche qui dise ce rapport à la littérature. J’ai mis longtemps pour aborder, une à une, les conférences. Et puis on constate dans la tête une rémanence forte : l’écart incruste les figures de départ. Et, ces jours-ci, je les relues intégralement et dans l’ordre, les cinq conférences, comme un conte fantastique, mais qui vous ferait explorer les galeries du dessous de la littérature. Les livres, les oeuvres, sont au-dessus. En les voyant vaguement se dessiner au-dessus de nos têtes, depuis loin sous le sol, là où ça rêve, voyage, écrit, la vue est déformée : ce sont les lignes de force dont on s’est saisi.
Et il est fort, Alberto. On le savait. Mais pas qu’il viendrait comme ça sur notre terrain des réseaux, de l’écriture web, de la politique.
Le premier écart par Alfred Döblin : depuis l’exil, et sa controverse avec Marinetti. Le livre achevé ne m’intéresse pas... Mais de Döblin on remonte à Job, à la Bible, aux commentaires médiévaux sur Adam, aux invocations à prononcer dans les champs pour en repousser les rats. C’est ça aussi, la langue. De Döblin et la politique, on sera soudain en train de traverser Aristote, et du retour de Döblin dans l’Allemagne de 1948 (Vous devez vous asseoir longuement parmi les ruines et les laisser vous affecter, et ressentir la douleur et le jugement...), Manguel finit par une évocation de Cassandre.
Mais la 2ème et 3ème conférence, on repart encore plus loin. De cet archéologue qui fut le premier à déchiffrer un fragment éclaté des tablettes de Gilgamesh, et du rapport de Gilgamesh à son double sauvage, Enkidu. Et de ce que l’épopée dit de la nécessaire conjuration à instituer sur soi-même quand on exerce un pouvoir politique. Et de ce que les Allemands ont fait de la figure du double. Dans les briques de Babel, on revient à ces tablettes d’argile par quoi une surface et une matière deviennent récit. Le prisme pour y parvenir : la tour de Babel racontée par Kafka, et ses notes dans cette période de Zürau, où vivait sa soeur Ottla (et cette phrase de Kafka : Croire au progrès ne signifie pas que le progrès a déjà eu lieu, ce serait ne pas croire). Mais, de Babel, Manguel passe à l’idée de colonisation. Est-ce que c’est pour parler à Toronto, la ville la plus cosmopolite d’Amérique du Nord ? Il passe en quelques lignes de la guerre d’Irak, et de ce qui advient des poètes irakiens, à l’imaginaire Inuit. L’autre matin, dans le train, j’étais parti de cette phrase, Nous ne sommes pas perdus, puisque nous sommes ici, sans plus arriver à retrouver où lue, où entendue. Il m’a fallu un long chemin pour l’associer à ce texte d’Alberto, et qu’il provoque du coup la relecture.
La quatrième conférence est sur le Quichotte. Borges y aurait obligé, même depuis là où il est. Les mots réalité, invention, fiction. Et qu’on n’en finit pas de s’expliquer avec eux. Même, voire surtout, dans ce genre de texte , qui n’est pas fiction – citant encore Borges : Ménard définit l’histoire non comme une investigation de la réalité, mais comme sa source. La vérité historique, pour lui, n’est pas ce qui s’est passé. C’est que nous croyons qui s’est passé.
Mais comment penser que dans un tel cadre, c’est en commentant une scène de 2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick, que Manguel clôturerait ses conférences ? Bien sûr via la linguistique, l’origine du langage, l’inquiétude qu’on a pour le monde, et l’ordinateur...
A visiter : le site Alberto Manguel (anglais). Ci-dessous, un seul passage. Il faut lire La cité des mots.

Commander La Cité des mots sur Bibliosurf..
Librairie en ligne. 5% remise. Port gratuit à partir 25 euros.
Alberto Manguel | L’écran de Hal (extrait)
Dans l’univers du livre, ce processus de réification s’effectue au moyen d’une manipulation industrielle que désigne le mot anglais d’editing. Implanté dans toutes les maisons d’édition de langue anglaise depuis le début du XXe siècle, et encore peu pratiqué dans les autres langues (bien que le système soit en train de s’insinuer partout en raison de l’influence du marché anglophone dan sle monde), le processus industrialisé de l’editing repose sur plusieurs idées fausses que dénonce la thèse de Honneth. Parmi ces idées, la plus dangereuse est la présomption qu’un texte est « perfectible ». : c’est-à-dire que l’écriture doit aspirer à une sorte d’archétype platonicien, un modèle idéal du texte littéraire. Il s’ensuit dès lors que cet idéal peut être atteint avec l’aide d’un spécialiste, d’un editor qui, tel un accordeur ou un mécanici, peut « perfectionner » le texte grâce à des talents de lecteur professionnel. une création littéraire n’est donc pas considérée dans sa nature intrinsèque d’ « oeuvre en cours », jamais conclue, jamais définitive, arrêtée au moment de la publication (« Nous publions pour cesser de nous relire », disait l’écrivain mexicain Alfonso Reyes), mais comme un produit plus ou moins abouti mis en oeuvre par l’auteur, achevé par un editor et approuvé par différents spécialistes du marketing et des ventes. Anthony Burgess, dans un article consacré à la version originale d’Amants et fils, de D.H. Lawrence, s’est plaint de cette procédure. « Je crois que la tradition éditoriale anglo-américaine a besoin, au point où elle en est, d’être prise à partie. L’éditeur dont l’absence de talent créateur est compensé par le goût artistique a reçu trop de louanges. Certains d’entre nous aimeraient savoir ce que Thomas Wolfe avait écrit avant que l’editor Maxwell Perkins ne s’empare de lui, ou à quoi ressemblait Catch 22 avant que le raffinement éditorial de l’ancien rédacteur du New Yorker ne lui donne sa forme léchée. Nul editor n’amende jamais les partitions d’orchestre ni les peintures panoramiques ; pourquoi le romancier devrait-il être distingué comme le seul artiste qui ne comprend pas son art ? »
Il va de soi que tout écrivain possède son conseiller ou sa conseillère maison : conjoint, ami qui peut, avec le temps, s’être imposé à la confiance de l’écrivain comme quelqu’un dont celui-ci peut évaluer l’opinion avant de choisir de suivre ou non ses avis. Et bon nombre d’editors professionnels, cernés par des contraintes de plus en plus fortes, continuent courageusement à essayer de se mettre au service de l’écrivain, pas à celui de l’industrie, en aidant l’auteur à comprendre plus clairement son livre et à le débarrasser de certaines faiblesses. Le travail de tels editors paraît plus remarquable encore si l’on considère le combat qu’ils mènent contre les gros groupes industriels exigeant la production d’une littérature industriellement efficace, à vente rapide, qui assimile difficulté à manque de talent, veut que chaque situation fictionnelle soit résolue, oppose des affirmations à chaque doute suggéré par l’imagination, et présente du monde une image pleinement compréhensible, d’où toute complexité a été éliminée et pour laquelle nulle connaissance nouvelle n’est requise, offrant en échange un état de « bonheur » décervelé.
Une telle littérature existe dans tous les genres, de la fiction sentimentale au thriller sanguinaire, du roman historique au baratin mystique, des confessions véridiques au drame réaliste. Elle confine fermement la littérature « vendable » dans les domaines de la distraction, du passe-temps et donc de ce qui est socialement superflu et en définitive accessoire. Elle infantilise auteurs et lecteurs en faisant croire aux premiers que leurs créations ont besoin d’être peaufinées par quelqu’un de plus compétent qu’eux, et en convainquant les seconds qu’ils n(ont pas la capacité intellectuelle de lire des récits plus intelligents et plus complexes. Aujourd’hui, dans l’industrie du livre, plus le public visé est vaste, plus on attend de l’auteur qu’il obéisse aux injonctions des éditeurs et des libraires (et aussi depuis quelque temps des agents littéraires), leur permettant de décréter non seulement des corrections pratiques de données et de grammaire mais également des modifications de scénario, de personnages, de cadre et de titre. Pendant ce temps, des livres qu’autrefois on n’aurait pas considérés comme abstrus et académiques mais simplement comme intelligents sont désormais publiés principalement par des presses universitaires et des petites maisons aux budgets héroïques. Dans Le meilleur des mondes, le roman d’Aldous Huxley datant de 1932, l’Administrateur donne de cette tactique une explication succincte : « C’est là la rançon dont il nous faut payer notre stabilité. Il nous fallait choisir entre le bonheur et ce qu’on appelait autrefois le grand art. Nous avons sacrifié le grand art. »
© Alberto Manguel, La Cité des mots, Actes Sud, mars 2009.
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne et dernière modification le 4 juillet 2009
merci aux 3565 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page


