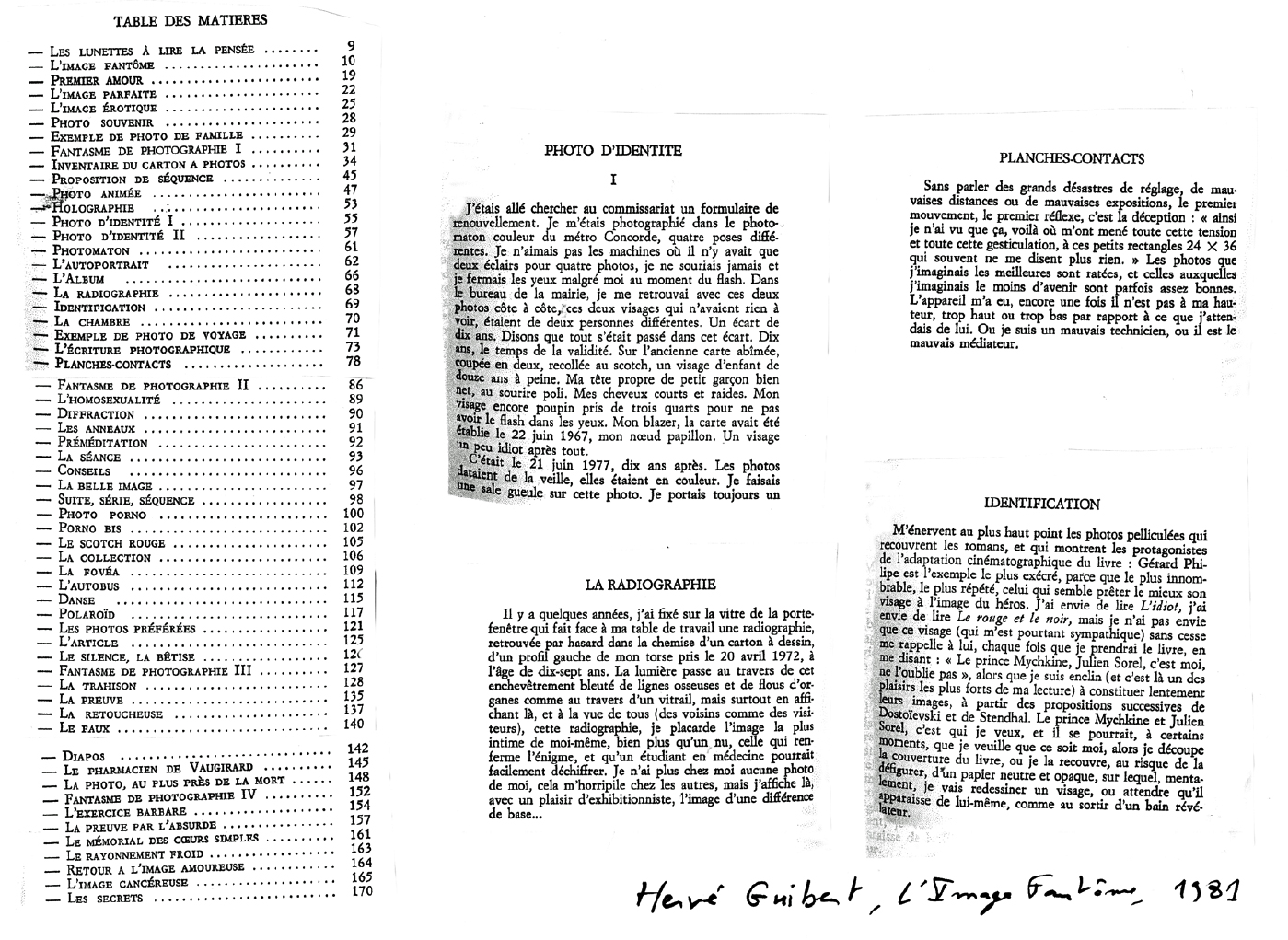ce qui change dans écrire par l’irruption de la photographie, exercice à partir de « Histoire » de Claude Simon
de la photographie comme écriture, une intro
Ces problématiques sont probablement originelles pour l’écrit. Mais la prise en compte de la photographie comme élément narratif spécifique s’est faite tardivement et lentement. Baudelaire et Flaubert passent à côté, Zola, Nerval ou Huysmans pratiquent (7000 plaques de verre pour Zola) mais n’écrivent pas sur leur pratique. Rimbaud franchit la frontière comme involontairement, décrivant à sa mère un autoportrait qu’il a raté, lui disant ce qu’elle aurait pu y voir. Et puis voilà les 198 occurrences du mot photographie, une quinzaine d’usages distincts, qui interfèrent avec la narration de À la Recherche du temps perdu.
Il faut attendre les années 1980 pour que des livres paraissent, abordant la photographie par cette notion de classement, et d’arborescence des usages : dans La chambre claire de Roland Barthes, 42 usages spécifiques, tous repérés par une oeuvre ou cliché repère de l’histoire photographique, et L’image fantôme d’Hervé Guibert, avec 70 déclinaisons de l’image photographique chacune traitée en forme brève (photomaton, retouche, planche-contact, polaroïd, album, radiographie, photo d’identité, la pose, la photo-souvenir, etc.).
Désormais, la photographie est traitée par la narration comme un des éléments du réel à égalité de tous les autres (il y a un chemin parallèle à accomplir, et les exercices qui vont avec) pour l’image cinématographique). De grandes oeuvres comme celles de W.G. Sebald, des livres entre essai et fiction comme ceux de Jean-Christophe Bailly, des oeuvres narratives comme celles d’Annie Ernaux ou d’Anne-Marie Garat installent la photographie dans le corps même de la narration (et non pas comme illustration) sans que nous en soyons en rien surpris.
Il n’y a rien de plus élémentaire que de proposer d’écrire sur une photographie. Et c’est un formidable exercice de grammaire narrative : que regarde-t-on, dans quel ordre, comment le reconstruit-on narrativement.
On peut proposer l’exercice à partir de photographies réellement apportées par les participants, ou bien selon qu’ils les convoquent mentalement.
Mais il faut aussi nous faire à nous-mêmes violence : nos photographies sont des dossiers fragiles et encombrés, sur des disques durs ou dans la mémoire d’un téléphone. La valeur symbolique de l’image en est-elle affectée ? Pourquoi ne pas alors faire directement démarrer l’exercice de nos pratiques en matière d’image (si on repense à ce que cela signifiait pour Zola, en terme de commande de l’appareil, fourniture des plaques et produits, trépieds et temps de pose, puis archivage des plaques). Que photographie-t-on, comment le classe-t-on. Aucun intérêt ? Tentez par exemple de faire écrire depuis les images perdues, les images ratées, les images pas faites alors qu’on aurait dû. L’imaginaire d’aujourd’hui, parce qu’il intègre la photographie comme élément du réel, part vers lui-même comme vers une image, sans forcément besoin de texte.
Et puis un ultime rebond : on parlera ailleurs de la mécanique cinématographique, comme on parlera ailleurs de la question temps narratif et temps référentiel. Le temps référentiel de l’image photographique, c’est celui de sa pose. Elle inclut cependant un temps sujet : tous les photographes le savent, se rendre sur les lieux, attendre, rendre possible, marcher dans la ville inconnue sans appareil. Alors les textes qui vont résulter de cet exercice, parce qu’ils sont narrativement complexes (des personnages, des décors, des abstractions, des tragédies dont on ne perçoit qu’un signe extérieur et même indifférent), seront des modèles d’expansion narrative depuis un instant de réalité arrêtée et arrachée.
Il y a d’autres emboîtements. Tout Balzac est une narration depuis un point de vue anthropomorphe. Rimbaud pratique, lui, la focale variable, parfois en montage cut à l’intérieur d’un même paragraphe. Le film nous a habitués à ces variations séquencées, ces ruptures. Mais savons-nous écrire avec focale, ouverture, série ?
Quelle magnifique tentative, il y a quelques années, celle d’une de nos agences nationales du territoire, définissant dans tout le pays quelques centaines de points témoins, villes, campagnes, côtes, demandant à quelques pointures de la photographie (ça ne s’improvise pas) de définir une image référentielle, qui serait ensuite reprise, depuis des années maintenant, une fois par trimestre dans les mêmes conditions.
Il y a bien sûr de multiples façons d’entrer dans ce champ d’écriture.
Je présente ici celle qui a ma faveur depuis que je l’utilise. Claude Simon fut photographe avant que d’être romancier. Dans Histoire, il inventorie par une suite de paragraphes sans ponctuation (le paragraphe devenu surface mimétique de l’image, jusqu’en son grain) une collection d’images trouvées dans le tiroir d’une maison que vide le narrateur. On est en 1967, l’année de Sergeant Pepper’s Lonely Heart Club Bnad, mais encore 13 ans avant La chambre claire.
À chacun de trouver son exercice. Mais toujours de souvenir qu’on va faire artificiellement ou intentionnellement se rejoindre deux histoires qui n’ont pas marché à même vitesse. Et qu’on touche aussi, parce qu’on propose l’exercice aujourd’hui (pratiquant l’atelier d’écriture depuis 20 ans, c’est un renversement qui me paraît stupéfiant après certaines séances), aussi bien dans le rapport quantitatif aux images qu’à leur dématérialisation (mot qui ne doit pas occulter la réelle matérialité des supports, des échanges aussi – une page Facebook fictive, quelle proposition.... mais les déclinaisons à partir des usages Facebook, albums, identités, deviennent aussi territoires potentiels de fiction) où se rejoignent dans un nouveau ballet le texte et l’image.
Je laisse donc en l’état la présentation de 2005, vous convie à compléter par images classées (BU Angers, 2010), une formulation plus récente. Je ne crois pas avoir jamais proposé de cycle en atelier d’écriture sans m’être arrêté sur cette instance : parler de la photographie comme matérialité, c’est arrêter notre geste scriptural en amont de la réalité, savoir qu’on bâtit la surface infiniment mince de la représentation, et qu’elle seule constitue le texte. La photographie d’une pyramide non plus n’inclut la pyramide.
FB
Ci-dessus : l’arrivée à New York photographiée par Julien Gracq (1970).
1, Claude Simon : le réel comme image
La photographie est une pratique qui a mis longtemps à percer dans la fiction. Malgré une page visionnaire de Balzac sur Daguerre en 1840 dans Le Cousin Pons, et malgré le bref chapitre des Curiosités esthétiques chez Baudelaire (mais sans rien de visionnaire comparé à son Peintre de la vie moderne , à partir des croquis de guerre de Constantin Guys : Baudelaire passe à côté de la dimension artistique de la photographie naissante), rien chez Nerval ni dans les proses de Rimbaud, alors que lui-même au Harar se fait photographe, et qu’on peut suivre dans ses lettres tout le cheminement depuis la commande, entre théodolite, baromètre et longue-vue (qu’il me fasse envoyer ici un appareil photographique complet, dans le but de le transporter au Choa, où c’est inconnu et où ça me rapportera une petite fortune en peu de temps, 28 septembre 1882), à la réception du matériel (je sais très bien ce que coûte un appareil seul : quelques centaines de francs. Mais ce sont les produits chimiques, très nombreux et chers et parmi lesquels se trouvent des composés d’or et d’argent valant jusqu’à 250 francs le kilo., ce sont les glaces, les cartes, cuvettes, les flacons, les emballages très chers, qui grossissent la somme, 8 décembre 1882), la lecture du manuel indispensable (un traité de topographie — et non de photographie, j’ai un traité de photographie dans mon bagage, 15 janvier 1883), jusqu’à l’envoi des premiers résultats (ci-inclus deux photographies de moi-même par moi-même, 6 mai 1883) de Rimbaud photographe, qui n’a pas obtenu la fortune prévue. Il reste que, muséalement, ce 6 mai 1883, ce texte célèbre doit être le premier d’un grand auteur à introduire dans la langue la description d’une photographie, c’est-à-dire transposition dans un univers de signe d’un autre univers de signe, lequel a déjà pour fonction de représenter. Renversement qui prend aujourd’hui une considérable importance : on utilise l’habitude chez le destinataire du texte de manier une représentation du réel, la photographie, pour construire à distance une représentation intérieure à effet de réel, qui pourra alors se passer de l’existence matérielle d’une photographie, et tirer son effet de fiction de la seule description d’image, mais emprunter à la photographie comme la caution, pour la fiction, que ce qu’elle décrit est vrai.
Arthur Rimbaud, lettre du 6 mai 1883, Œuvres complètes, Gallimard, 1972.
Pourtant, de tous les grands auteurs du XIXe siècle on connaît depuis bien avant cela le visage, puisqu’ils ont posé pour Nadar ou Carjat (voir dans les écrits de Nadar ce que Balzac improvisait, pendant les séances de pose, sur le portrait photographique). Mais si le texte ci-dessus appartient aux lettres de Rimbaud, et non à son œuvre, c’est Lautréamont qui devient le précurseur, par ce très étrange passage de l’ouverture du chant III de Maldoror. Il utilise en effet, pour noter à mesure de la narration elle-même son principe de fonctionnement et d’expansion, le très précis vocabulaire technique de la photographie dans l’instant même de sa révélation (l’image flottante du cinquième idéal se dessine lentement, comme les replis indécis d’une aurore boréale, sur le plan vaporeux de mon intelligence), parlant de cuves, de l’œil oblique, de cercles concentriques pour disposer à la surface même de son texte ses personnages brillant d’une lueur émanée d’eux-mêmes, avant, quelques pages plus loin dans le même troisième chant, de convoquer l’instant de la prise de vue, en reconstruisant explicitement une chambre obscure, avec la phrase récurrente et mon œil se collait à la grille avec plus d’énergie et l’apparition d’une lueur phosphorique pour sa fameuse scène du cheveu : même si Isidore Ducasse est familier de ces emprunts à des manuels techniques ou scientifiques, zoologie, chimie, mathématiques qu’on a pu pour la plupart identifier, la performance et l’intuition sont remarquables. Rien chez Mallarmé non plus. C’est seulement chez Proust, et alors elle est liée à la mort, à la cessation de l’être, que la photographie intervient en tant que telle dans la fiction, quand Saint-Loup rapporte au narrateur le visage de sa grand-mère juste décédée, et qu’il avait traitée de coquette parce qu’elle s’était apprêtée pour la pose.
Jusqu’alors la transmission de connaissance et d’informations passaient aussi principalement par le récit. Nous ne pouvons certainement pas, à échelle de temps si rapprochée, mesurer encore assez bien le bouleversement mental et langagier qu’a produit, depuis quelques décennies, la circulation autonome des images.
Les pistes, bien sûr, sont multiples pour travailler à partir de photographies, ou sur la photographie. Et on peut y revenir plusieurs fois dans un cycle, tant chaque fois le rapport au réel s’exprimera puissamment. Il y a aussi de nombreuses pistes pour mener l’atelier d’écriture conjointement à la présence d’un photographe.
Ce qu’on voudrait proposer ici, c’est de traiter le texte comme photographie. Le penser d’abord comme surface, et les mots comme occupation d’espace. Essayer donc de déplacer tout aussi bien notre perception visuelle du texte comme lecture simultanée d’un bloc (comme Mallarmé pouvait dire : « l’unité, c’est la page ») et essayer de penser à cette manière de percevoir le texte avec les outils mentaux de la perception visuelle, dès la genèse de notre écriture. Tenter que ce qu’on représente, la photographie, conditionne le texte jusque dans ses ponctuations (ici, le refus de certaines majuscules), son grain (la répétition ceux qui jouent jouent), le rapport entre instant et durée répété entre constat et supposition (ce qu’on peut déduire).
la photographie représente une cour d’école à platanes, et marronniers. C’est l’automne ; quelques bogues de marrons sont à terre. Le photographe de la photographie a saisi des enfants en tabliers noirs. certains jouent. d’autres regardent ; car ceux qui jouent jouent aux barres. Je suis sur la photographie, ma position marquée d’une croix. Je viens juste de me mettre à courir, à partir de mon camp (c’est ce qu’on peut déduire de ma position, si on a une connaissance, même sommaire, du jeu de barres)…
Jacques Roubaud, Autobiographie, chapitre dix, Gallimard, 1977.
Mais on va s’appuyer aussi sur l’objet représenté par le texte, la photographie assemblage de pigments selon une largeur de grain précise, pour explorer une composante importante de la langue : écrire sans ponctuation, pour se contraindre mieux à cette tension de surface des mots, dont le rythme et la texture s’organiseront sans autre appui qu’eux-mêmes. Ce passage par l’écriture sans ponctuation est nécessaire pour appréhender concrètement l’idée de rythme interne de la langue, ce qui, pour sa construction même, passe par un appui sur le temps propre de prononciation et l’ordre des mots plutôt que sur les repères visuels des signes diacritiques. L’écriture sans ponctuation implique d’en passer par une apparente déconstruction, mais on croise à nouveau ici un point d’origine de l’écriture, un appui sur la seule scansion.
L’impossibilité même de clore le texte ou boucler la phrase deviendra un principe neuf d’expansion, une manière de sentir ce mouvement de basculer en avant qu’est le récit. Quand on reviendra à la ponctuation, nul doute qu’on l’utilisera avec une conscience accrue de son rôle propre. Des enseignants rétorquent parfois qu’une telle proposition va au rebours de ce qu’ils s’efforcent à construire : la maîtrise même de la ponctuation, un des critères historiques les plus variables de la langue, impose de comprendre de façon dynamique ce qu’elle a pour tâche de régler, au sens musical du mot : dans la genèse chacun de sa propre écriture, ce qui ne nous choque plus, dans l’absence de ponctuation, pour un texte poétique de Cendras ou d’Apollinaire que le vers découpe, garde l’apparence d’un défi pour la prose narrative. Je suis persuadé du contraire : et c’est le paragraphe alors dont on va éprouver, comme pour le vers chez Cendrars, la force de coupe et rupture, l’effet de cadre. J’en veux pour preuve cette phrase admirable de Proust, dans cette magistrale leçon qu’est son article À propos du style de Flaubert (Nouvelle Revue Française, 1920), qui n’est certainement pas une phrase longue, mais où la disparition de la ponctuation interne est liée au fait qu’il y parle mimétiquement de cet appui sur le son même des mots pour organiser la force de la phrase : Mais nous les aimons ces lourds matériaux que la phrase de Flaubert soulève et laisse retomber avec le bruit intermittent d’un excavateur. A rapprocher de la réponse de Proust à cette Enquête sur le renouvellement du style (Le Renaissance littéraire, politique, artistique, 1922) où les points et les virgules reviennent, là encore pour désigner l’écriture elle-même, mais comme juste et légèrement portés par le mouvement propre de la phrase. C’est cela, qu’on peut apprendre en se privant, le temps d’une séance, de toute ponctuation (il m’arrive, dans le temps de lecture, de demander aux participants de prononcer à voix haute le nom des signes diacritiques, point, virgule : exercice est vraiment riche aussi pour partir à la maîtrise de la ponctuation).
Marcel Proust, réponse à une Enquête sur le renouvellement du style, Le Renaissance littéraire, politique, artistique, 1922.
En exemple de ce bouleversement potentiel de toutes les catégories d’action mentale du récit par la circulation autonome des images, je propose un texte extrait de Histoire de Claude Simon, livre en général méconnu d’un auteur fondamental de notre modernité, où cette exploration des images, traitées pour telles, devient matière même du livre, dans sa brutalité et ses brillances, grâce justement à cette manière de défaire la prose en deçà de toute ponctuation autre que la coupe du paragraphe.
...
et onze heures du matin à Zanzibar : Water carriers at the pipe des négresses aux cheveux courts crépus remplissent des bidons de tôle à un robinet placé sur un socle de ciment et derrière elles un mur lépreux décrépi avec deux fenêtres garnies de barreaux les bidons s’entrechoquent avec un bruit creux le soleil tellement violent que l’une des femmes se protège le visage à l’aide d’un bidon vide une autre vêtue d’un tricot moutarde déchiré s’éloigne de la fontaine un bras pendant tiré vers le sol par sa charge le corps penché de l’autre côté pour l’équilibrer le bras libre horizontal en balancier
Claude Simon, Histoire, Minuit, 1967.
L’image est trop omniprésente désormais pour qu’on se contente d’énoncer une contrainte formelle. Le repli est trop facile sinon sur des images toutes prêtes, et trop lisses. Je demande que l’affect soit le principe de sélection des photographies sur lesquelles on va choisir d’écrire. Le thème suivant est sans doute le plus riche : les cinq premières photos qu’on connaît de soi-même. Va compter d’abord l’environnement graphique : murs, ciels, relation avec celui qui fait la photo, habits, jouets, autres personnages, même partiellement déchirés. On intégrera dans cette liste l’objet photographique lui-même : cadre, papier, marges, bords, annotations, jaunissement et pliures, etc. Ce thème paraît élémentaire, mais peut se révéler de grande violence (celle qui dans sa famille d’accueil n’a jamais été photographiée, celui qui répondra par son image déformée dans le robinet du lavabo collectif de l’institution où les miroirs même étaient absents ; le vieil homme qui se souvient que la seule photographie évoquant son père était une photo déchirée par le milieu par sa mère, où passait cependant le genou sur lequel l’enfant était assis ; celui qui se voit rendre par la FNAC avec la mention « non facturée » un autoportrait flou fait dans une circonstance pour lui majeure, etc.) : simplement parce qu’on fait du sujet, qui reste l’enjeu principal de l’écriture, un objet second dans l’écriture, où tout ce qui viendra s’écrire sera d’abord ce qui ne concerne pas ce sujet lui-même : un visage s’écrit avec la vie, et sur ces premiers visages qu’on connaît de soi-même, il n’y a rien d’écrit.
J’amène souvent aussi lors de ces séances des photographies du Japonais Iroshi Sugimoto, qui a fait tout autour du monde, au bord de toutes les mers, strictement la même image, deux tiers eau, un tiers ciel. Toujours le même principe pour la photo, rien d’autre de représenté, même cadrage, même hauteur du pied, et travail magnifique, jamais semblable. Sugimoto accompagne ses photographies de narrations envoyées à ses commanditaires, qui produisent toutes les conditions concrètes de la prise de vue, voyage, transports et accès, météorologie, hôtels et repas. Là aussi s’ouvrent de belles pistes, pour qu’un texte appliqué à une photographie qu’on a faite soi-même s’appuie sur la narration des circonstances au plus précis de la prise de vue, pour que le cliché lui-même soit fixé à l’intérieur du texte, comme un arrêt provoqué du temps et du mouvement.
Si je n’en parle jamais en présentant forme et thème de la séance, l’intérêt adjacent, mais majeur aussi, de cette voie d’exploration, c’est que les textes issus de description de photographies, par effet de cadre en particulier, et par la distance, toujours lisible dans le texte, du représenté et de ce qu’il représente, apprend à manier narrativement des objets extrêmement complexes, figures de groupe, tensions entre personnages, ébauches saisies de mouvement, écriture de décor purement visuel et d’objets détachés. En fin de séance, dans le temps de lecture des textes, c’est sur cet aspect-là que je fais principalement porter mes commentaires.
J’insiste sur la richesse potentielle de ce texte de Claude Simon, parce qu’il est un texte de transition, ouverture par le dedans de la syntaxe à un dépli de la représentation, qui nous permet d’accorder avec la plus grande précision son point de netteté, sa focale, non pas sur le monde, mais sur l’objet qui l’a saisi dans un instant donné. Ce qu’il y a hors cadre, nous ne le saurons pas. Pourtant, paradoxalement, lorsqu’on lira les textes, on mettra les participants devant une autre bascule majeure ; les textes, parce qu’ils explorent un instant arrêté du monde, en déploient la complexité, l’espace global des relations à un point, en un instant, et l’appui autonome sur l’illusion créée par le texte remplace le réel qui en fut la source. On est passé dans l’univers de la fiction, par ce découpage de cadre, par cette mise à distance des signes. On est dans le roman, un petit fragment de roman, parce que l’interrogation portait tout entière sur la représentation, et non sur le réel.
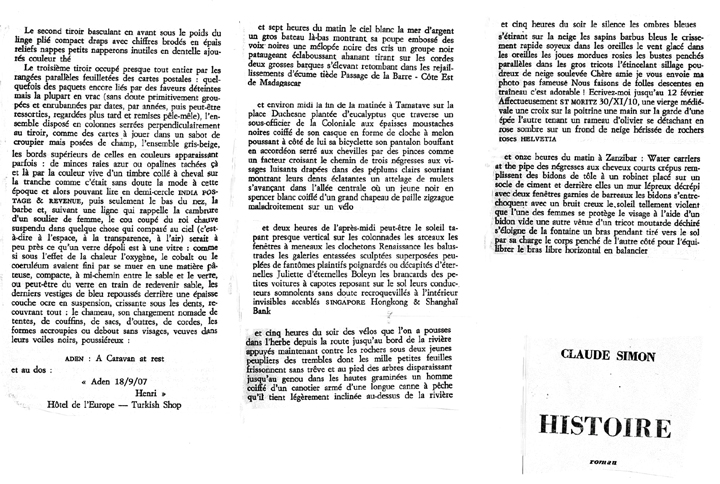
Variations sur l’usage de la photographie : Minyana, Guibert, Barthes
J’apporte toujours avec moi, lorsque je souhaite faire un travailler un groupe sur cette notion de réel arrêté et cadré par la photographie, le livre de Roland Barthes, La Chambre claire. Simplement pour dire que ce livre, essentiel quant à notre possibilité de théoriser la photographie, est très récent par rapport à l’histoire plus ancienne de la photographie : qu’il s’agit d’une histoire encore à écrire. Les quarante-huit chapitres de Barthes sont chacun consacrés à un mode, une façon d’établir la photographie dans son rapport au monde, à ce qu’elle fixe du monde comme à la façon dont elle s’inscrit par rapport à celui qui la regarde. L’idée même de classement déplace immédiatement notre mémoire, notre catalogue mental de photographies. Ce qui est indifférencié passe par la diffraction d’un prisme.
Ainsi L’Image fantôme, d’Hervé Guibert, paru juste après le livre de Barthes. Le travail de critique photographique d’Hervé Guibert, en particulier ses chroniques pour Le Monde, est paru récemment. Dans L’Image fantôme, il ne s’agit pas de ce travail critique, énonciation « sur » la photographie. Mais bien du chemin intérieur que déplace en nous l’accumulation mentale des images, et le déplacement du rapport au monde qui s’en induit. Hervé Guibert photographie sa mère malade, elle s’apprête et pose, et ce qu’ils traversent tous deux lors de cet instant est une rencontre à rebours de toutes la pesanteur familiale. Lorsqu’il veut développer la photo, il constate que la pellicule, mal enclenchée, est restée enroulée : la préparation et le geste de la photographie ont remplacé l’image qui n’existera pas.
Chez Guibert, soixante-quatre chapitres qui correspondent chacun non plus, comme chez Barthes, à une définition du rôle ou du statut de la photographie, mais à l’inventaire matériel de l’image. Photos d’identité, photomatons (comme le peintre Bacon ou le poète Queneau les pratiquaient aussi), radiographies médicales, planches contact, album ou carton de photos, le Polaroïd, la retouche, la séquence, l’autoportrait, la photo-souvenir : l’éclatement proposé par Hervé Guibert n’est pas un simple inventaire et jamais un jeu formel. Il est ce prisme par quoi l’image nous apprend nous-mêmes et notre corps. Mais c’est la dispersion et le prisme qui les débusquent, parce qu’on convoque les formes matérielles différentes de l’image, qu’on pousse à bout cet inventaire pour soi-même, et qu’on tâche à chaque fois de savoir à quelle photographie précise cela correspond dans ce qu’on en garde au-dedans, et qu’est-ce qu’on en a appris : il y a encore dans la table des chapitres l’image amoureuse, l’image érotique, l’image pornographique, l’image parfaite, les diapos, l’appareil, ou le fait divers (« l’exercice barbare »)…
L’étrange avec ce livre, c’est la façon dont il agit simplement en déplaçant notre position intérieure par rapport à notre mémoire des images : en prenant distance et tentant de les classer, elles surgissent.
Et peu importe qu’on revienne, pour l’exercice lui-même, à cette contrainte d’une écriture sans ponctuation, ce que ne fait pas Hervé Guibert, mais qui ouvre une telle adéquation entre le grain de la photo et la lettre ou le mot sur l’espace blanc de la page. Ainsi, par exemple, en proposant ces photographies dites par Philippe Minyana dans Habitations / Pièces, où le « pièces » vaut autant pour le rapport aux lieux qui lui servent de matière que pour l’affirmation théâtrale. Une photographie dite par un acteur à quelqu’un qui l’imagine sans la voir, c’est l’essence de ce travail auquel nous procédons, convocation de nos représentations mentales et mémorisation des images, et comment le langage s’en approprie et les reconstruit comme fiction pour un autre :
L’entrée de la villa
photographiée par Jean-Claude
Le narrateur commente la photo.
Annie devant la porte jupe et cardigan la porte verre sable et traverses en alu laqué foncé à gauche mur de refend devant le mur coin bureau au sol grès crème
Vision de Jean-Claude
j’ai vu Annie couchée morte dans l’entrée
Propos recueillis lors de la fameuse affaire
Le narrateur commente la photo.
Dans l’entrée à gauche cinq placards plafond lambrissé la porte d’entrée étant composée de nombreux vitrages la lumière palpite dans l’entrée l’agencement de l’entrée rend la villa originale chaleureuse
Philippe Minyana, Habitations / Pièces, éditions Théâtrales, 2001.
Où le dispositif graphique qui relie la photographie à l’acteur qui la dit permet une autre variation pour l’exercice : le commentaire du narrateur, qui peut être complètement décalé de la réalité, passer à l’onirique, au fantasme.
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne 5 octobre 2013 et dernière modification le 24 février 2020
merci aux 3343 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page