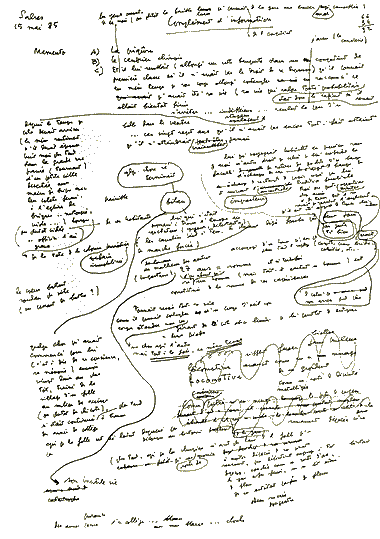
ce qu’on lui doit
C’était jeudi à 17h. Je disposais de 50 minutes pour parler, à Arles, dans le colloque des Rencontres internationales de photographie. La question posée partait du mot engagement. D’ailleurs, je comptais y revenir sur ces pages, et ce sera dans les jours à venir. J’avais voulu répondre en essayant de déplier ce qu’il en était du concept de réalité pour la littérature, et comment la fiction s’installait dans ce prisme qui articule le langage et le monde, mais de façon instable, cinétique et mouvante, où chaque œuvre est une cristallisation spatiale précise dans l’intérieur de ce même concept. Si Proust a bouleversé d’un seul coup la totalité de notre littérature jusqu’à lui, c’est parce qu’il touche à ce concept. Il me semble que l’œuvre de Claude Simon naît de ce bouleversement, complété des outils de Faulkner. Il me semble que nous n’avons pas quitté le champ à la fois dévasté et renouvelé de ce bouleversement : par lui nous pensons les notions de temps réversible, de possibilité statistique de matière, concepts qui auraient été scandaleux, dans l’application éventuelle à notre réalité quotidienne et notre perception du monde, il y a encore trois décennies. D’ailleurs, en partant sur ces pistes pendant les 50 minutes qui m’étaient allouées, je sortais certainement du strict cadre de ce colloque : mais c’est à cette condition que la notion de réalité nous est concrète en littérature, dans ce grand écart qui va de Ponge à Artaud, et c’est là notre espace de travail.
La veille, j’avais passé beaucoup d’heures auprès d’Armand Gatti. Il a 83 ans, il est plus jeune que Claude Simon, il parle aussi de l’âge, prétend, dans son vieux vocabulaire anarchiste, que bientôt « il s’en ira chez Plumeau ». Il a lui aussi parlé dans ce colloque, et on a partagé les repas, les attentes. Gatti a traversé l’œil du cyclone, la torture, l’extermination, l’évasion. Il parle des arbres. Ceux de son maquis, et ceux de l’évasion : quand on marche quatre mois dans la neige, mangeant de la neige, et qu’on dort dans les arbres pour survivre. L’arbre est devenu sa fable : il ne nous parle plus que de l’arbre, et c’est ce qui nous sauve.
Ce jeudi, à 17h, j’ai parlé de Nathalie Sarraute, et puis je me suis embarqué dans un parallèle entre Armand Gatti, écouté la veille, et Claude Simon. Je n’avais pas prévu de le faire. J’ai parlé aussi de l’âge de Claude Simon, et de sa claustration. J’ai lu deux pages de son Discours à Stockholm, très précisément les pages 24 et 25, du paragraphe qui commence par Je suis maintenant un vieil homme... jusqu’à la variation sur Stendhal. Nous avions encore tous l’image et les mots de Gatti nous embarquant dans sa fable : l’arbre était devenu réel. L’arbre de Gatti devenait la traversée du cataclysme. Ce jeudi soir, en m’embarquant dans ce parallèle d’entre Gatti et Simon, je cherchais à exprimer en quoi, ou bien si (et qui sommes-nous, nous qui n’avons pas été de ce cataclysme, pour en raisonner), le fait que Claude Simon ait pu traverser à un peu plus de distance, par l’expérience de Barcelone, par le cheval mort de la Route des Flandres, par son œil d’artiste déjà constitué, et aussi par n’avoir pas été dans l’instance centrale de l’extermination, permettait à son œuvre de nous rendre la réalité du cataclysme, quand Gatti nous le rendait présent par la fable.
Je n’ai évidemment pas tenu compte des minutes, en public j’en suis incapable. Je tirais mon fil, sur un point qui me semblait essentiel : Sarraute et Simon refusaient la notion d’engagement, et Sartre, dans ce Discours de Stockholm, n’a pas le beau rôle : c’est par là qu’ils nous apprennent. Mais, dans ces quelques minutes du paradoxe, dans un lieu pour moi évidemment central de l’exercice de la littérature, j’avais le sentiment de deux présences, deux vivants : le grand âge de Gatti, le grand âge de Simon, et que ces grands témoins nous portaient, à bout de bras, l’expérience même du cataclysme, par quoi seul apprendre à vivre, et ce que signifient les mots dont on use, est encore possible avec un peu de dignité.
J’ai eu quelques secondes, derrière moi, aussi près qu’était Armand Gatti la journée précédente (il nous a même parlé de La Chèvre de monsieur Seguin, Gatti l’homme allégorie), la proximité de deux vivants. J’ai appris hier après-midi que le Plumeau de Gatti, à cet instant, moi parlant de sa surdité, de l’immobilité forcée qui était celle de Claude Simon depuis plusieurs années.
Je suis persuadé que si j’avais appris ce décès avant jeudi 17h, dans mon heure de colloque je n’aurais parlé que de lui et de ses livres, Claude Simon. Et que ce que j’aurais trouvé par les mots, l’usage de l’improvisation déchiffrante, m’aurait sans doute amené sur d’autres terrains que lorsque, il y a deux mois, j’en parlais aux étudiants des Beaux-Arts (de lui Claude Simon, qui avait basculé directement des Beaux-Arts dans la guerre). Comme cette année à de si nombreuses reprises j’ai apporté Les géorgiques ou Le Jardin des Plantes lors de mes ateliers d’écriture : cette étrange suite de passages dans Le Jardin des Plantes où il scrute ce moment où, l’avion approchant d’une ville, que cette ville soit Chicago, Mexico, Tokyo ou Novossibirsk, on perd la structure globale de l’établissement humain dans le chaos des forces naturelles, pour être mis face à son détail - et cet homme, quand il écrit ces paragraphes, a plus de 80 ans. Ce que nous devons à la marche récurrente et obstinée de ses livres. Et l’histoire même d’une lecture susceptible de commencer aujourd’hui comme en son temps, désormais clos, cela n’était pas encore possible. Etrange paradoxe peut-être que de deux œuvres strictement contemporaines, Histoire et Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band, l’une a vieilli plus que l’autre, et ce n’est pas le livre.
Cette nuit, me restait ceci : avoir parlé de lui en vivant, sans savoir qu’il n’était plus. Avoir passé ces derniers jours, et notamment les heures qui se sont enchaînées entre son décès et son inhumation, avec entre les mains quasiment sans arrêt son Discours de Stockholm, parce qu’il inscrivait le plus difficile et le plus précis de ce que nous avons à penser, et à ouvrer, ouvrir et œuvrer, quant au temps, quant au monde.
– mon propre hommage : d’où vient la rage quand on écrit ?
– dossier Claude Simon sur remue.net
– ce 10 juillet, un entretien avec Pierre Bergounioux dans Libération
– sur le site de Patrick Rebollar, ensemble de textes de Claude Simon parus en revue, dont quelques très rares
– la page manuscrite de L’Acacia vient du dossier Claude Simon de l’ADPF
– sur le site du Banquet du livre de Lagrasse, un hommage à Claude Simon que j’avais rédigé en 1995
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne 10 juillet 2005 et dernière modification le 10 juillet 2005
merci aux 4048 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page

