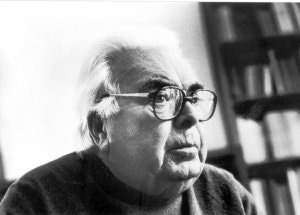
de la possibilité du roman de dire les camps
Au lendemain de la disparition de Maurice Nadeau, je remets en Une de Tiers Livre ce billet mis en ligne en juin 2005, lors de la réédition d’un livre essentiel sur les camps, celui de David Rousset, Les jours de notre mort, avec une préface de Nadeau qui est un texte d’un enjeu considérable, sur littérature et réalité.
note initiale, juin 2005
Après avoir rédigé ce blog, continuant ma lecture de David Rousset, j’ai proposé sur remue.net une version plus théorique : Le roman peut-il dire les camps ?, texte repris dans la Quinzaine Littéraire de ce 1er juillet 2005.
David Rousset, à son retour de déportation, avait publié un livre qui compte essentiellement dans les quelques livres qui nous ont appris l’impensable (Eugen Kogon, puis L’Espèce humaine de Robert Antelme, Bettelheim et les autres), pour David Rousset c’est L’Univers concentrationnaire, il publie moins de deux ans plus tard ce livre de près de mille pages, Les jours de notre mort, dans cette différence essentielle qu’il ne s’agit pas de témoignage, mais qu’il convoque son expérience, les récits, les images, et convoque aussi toutes les techniques de récit, scène, dialogues, pour nous livrer le camp via les outils de l’écriture.
Parce que ce livre ne se revendique pas du témoignage, tout en mobilisant l’énorme masse d’éléments de ce réel inqualifiable, mais profus, complexe, enserrant lui-même une masse gigantesque d’abîme, de choses tues, de meurtres sans témoins, une des plus vieilles question de la littérature comme représentation est à nouveau posée.
Pour ma part, en convoquant une forme repérable, l’entretien journalistique, pour créer une illusion de réel, et explorer la réalité masquée de Daewoo, j’ai pu constater des dizaines de fois combien cette idée restait encore une gêne : j’entends des jurés du prix Inter dire que mon livre n’est pas un roman, comme, quelques semaines plus tôt, un journaliste de la même chaîne m’appelait pour me demander le n° de téléphone... d’un des personnages du livre ! Or, il s’agit justement de créer cette illusion pour entrer dans le vrai, constituer en représentation une strate du réel qu’il ne produit pas de lui-même.
Mais respectons l’échelle : Les Jours de notre mort, c’est un livre que j’avais lu en 1991, et j’ai presque tout un cahier rempli de phrases recopiées de David Rousset. Simplement parce que les mots, pris à cet abîme, ou jetés contre lui, en extorquent un déplacement de langue qui devient notre héritage. J’ai dans mes très proches (Louis Dujardin, Willy Holt, "Bébert", Jean Laidet) des survivants de l’innommable. Nous sommes attachés à leur parole, surtout quand elle nous est ainsi venue via l’amour en partage. Ils sont des lampes fragiles au devant de nous, eux qui aujourd’hui affrontent un autre voyage, où nous tâchons d’être présent, aidant. Willy Holt a publié Femmes en deuil dans un camion, à propos d’Auschwitz,la trace est là.
Avec David Rousset, c’est une autre inscription : l’abîme se dit lui-même. Éléments réels, Benjamin Crémieux, le violoniste Hewitt, scènes de fiction, les condamnés marchant à la corde et bousculant le tabouret avant de concéder aux nazis de perpétuer leur mort... Mon exemplaire avait brûlé dans l’incendie, en 1994, de la bibliothèque d’un de ceux-ci, que je cite plus haut. Il vient de reparaître en poche, je le relis.
Et, ci-dessous, un large extrait de la préface de Maurice Nadeau.
David Rousset | Les jours de notre mort, avant-dire
Ce livre est construit avec la technique du roman, par méfiance des mots. Pour comprendre, il faut de quelque façon participer : l’univers dont il est parlé ici est à la fois singulièrement hors de proportion avec les réactions quotidiennes des hommes ordinaires, et cependant proche et intime.
Toutefois, la fabulation n’a pas de part à ce travail. Les faits, les événements, les personnages sont tous authentiques. Il eût été puéril d’inventer alors que la réalité passait tant l’imaginaire.
Discuter de la vérité serait vain. La nôtre n’est point celle des cours de justice, du papier timbré ni de la photographie.
Des noms paraissent, des personnages vivent qui sont aussi des personnalités de notre vie quotidienne. Il auré été facile de mettre d’autres étiquettes, selon les convenances du jour. Lorsque des hommes sont mêlés à de si grands événements, l’artifice du masque, toujours médiocre, se déchire de lui-même.
Maurice Nadeau | préface aux « Jours de notre mort » (extrait)
Qu’est-ce donc qu’une oeuvre littéraire ? Le produit d’un travail visant à donner forme à ce qui cherche à s’exprimer par elle et à travers elle : idées, sentiments, situations, événements. C’est la recherche d’un langage qui, au-delà de la communication, tend à exister pour lui-même en donnant du même coup l’existence de ce que nous avons décelé dans l’ouvrage de David Rousset : le témoignage, la description d’un phénomène sociologique dans son ampleur, sa diversité et son évolution, accompagnée de jugements et de réflexions, de tentatives d’explications. Toute cette matière autrefois vivante, désormais obérée par le temps, passe par le choix d’un langage qui redonne vie, qui la fait accéder à une certaine éternité.
L’oeuvre littéraire comprend des ouvrages aussi différents que les (Essais de Montaigne, la Phèdre de Racine, le Contrat social de Rousseau, le Dictionnaire philosophique de Voltaire, un roman de Balzac, Ulysse de James Joyce. Autant de genres et de langages différents, mais chacun des auteurs apparaît comme sujet et objet de son langage, celui de la confidence, celui de la tragédie, celui des Lumières, qui n’est pas le même pour Rousseau et Voltaire, celui du roman. Outre que chacun possède ce qu’on appelait autrefois, avant le structuralisme, la disparition annoncée de l’auteur, son style et qui, lui appartenant en propre, permet de le distinguer des autres. La littérature, selon Borges, vise un unique grand Livre, mais cet unique grand livre est formé de toutes les diversités de langages et d’écritures. David Rousset avait tellement conscience de faire oeuvre littéraire qu’il s’est choisi pour Les jours de notre mort le patronage entre autres de deux écrivains : Henri Michaux, le poète de La Grande Garabagne, pays imaginaire dont les habitants ont des moeurs insolites et Swift, l’auteur des Voyages de Gulliver. Déjà, dans son essai L’Univers concentrationnaire qui a précédé Les Jours de notre mort, il avoquait Jarry et son père Ubu, il évoquait Kafka. Le monde qu’il entendait décrire n’atait pas sans ressembler à ceux que ceux-ci avaient imaginé.
J’en viens à ce qui, pour beaucoup, a pu paraître une énigme, comment le camarade qui, à peine revenu des camps, a venait de donner à notre Revue Internationale, la revue que dirigeait Pierre naville, un essai sociologique aussi précis dans l’analyse rationnelle et aussi pénétrant que L’Univers concentrationnaire, comment ce camarade pouvait-il penser à écrire un roman à partir d’une expérience collective aussi énorme et aussi tragique, vécue par des millions d’hommes, et aussi hors des normes ? Comment pouvait-il intituler "roman" un ouvrage qui portait sur une réalité dont nous n’avions pas encore pris complètement conscience ?
Bien que le genre romanesque ait beaucoup évolué depuis Balzac et Flaubert, bien que relèvent de ce genre Ulysse de James Joyce et A la Recherche du temps perdu de Proust, le mot "roman", après avoir été assosicé depuis des siècles au récit d’aventures en tout genre et surtout amoureuses, ne continue-t-il pas d’évoquer des situations plus ou moins imaginaires, des personnages inventés par l’auteur, un réel qui s’éloigne plus ou moins de la réalité ? Or, c’est bien d’une horrible, d’une aberrante réalité dont David Rousset veut nous entretenir et les personnages qu’il met en lumière, tirés des foules de centaines de milliers d’anonymes, il les présente sous leur nom d’état civil : nos camarades Roland, Marcel, Philippe, le Kapo allemand à qui David a dû de survivre, Emil Kunder, le communiste français Marcel Paul, le musicien Hewitt, Julien Cain, conservateur de la B.N., les chefs de blocks et les chefs de camp à Buchenwald, Neuengamme, Dora, Mauthausen. Il justifie l’appellation de roman par la construction du livre : Avec la technique du roman, dit-il, par méfiance des mots. Comment la technique du roman mène-t-elle à se méfier des mots ? De quels mots faut-il se méfier ? Des gros mots qui résument et définissent événements et situations à l’emporte-pièce alors qu’il s’agit de décrire, de montrer, d’analyser, de trouver le mot juste comme s’y était employé Flaubert. Rousset connaît particulièrement des romanciers américains dits réalistes, comme Dreiser, Sinclair Lewis, Dos Passos. Il les a pratiqués, il a vu comment ils s’y prennent pour décrire les méfaits de la société capitaliste américaine. Il entend user des mêmes procédés pour décrire, analyser, la société concentrationnaire.
La réalité qu’entend évoquer le roman en tant que genre oblige à prendre du recul et de la hauteur. Le romancier c’est, comme le dira Flaubert, Dieu dans sa création invisible, à la fois partout et nulle part. Comment Rousset, à peine revenu des camps, pouvait-il en quelques mois acquérir cette maîtrise, construire une oeuvre d’un millier de pages ? Il lui faire évoluer son récit à la fois dans l’espace et le temps, lui imaginer des rebondissements, le mener vers un dénouement qui marque son achèvement...
© Maurice Nadeau, Hachette Littérature.
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne 19 juin 2005 et dernière modification le 17 juin 2013
merci aux 9080 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page

