
postface au livre de Jean-Claude Biraud et sa méthode : « Être, énergie, fréquences »
vidéo personnelle, juillet 2016
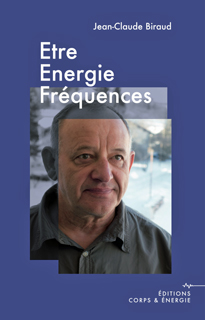
– on peut se procurer le livre de Jean-Claude Biraud ici sur Amazon
– important : visiter son site www.biraud.posture.com
– sa réalisation a été collective, transcription des chapitres depuis dictaphone par Caroline B., photo de couv Nicolas B., la couv elle-même (merci Perrine Martinot), relectures et corrections (merci Annick D.) et certains des praticiens formés par J-C. (merci notamment Gaëlle G.), pour ma part, souvenir de nos séances téléphoniques du matin pendant toute la durée du confinement, puisque 200 km nous séparaient...
– différents liens dans mon journal images, dont les plus récents ici et ici.
Jean-Claude Biraud, portrait de loin
UNE MEME MAISON grand-paternelle, son jardin, ses greniers, le labyrinthe de ses conches et rivières du marais poitevin, bien avant l’âge touristique. Pays habité, pays de tradition aussi, où parler aux morts n’est pas une aberration notable.
Pourtant à égalité d’âge, deux enfances symétriques : ils étaient les cousins de la ville, le frère et la sœur, mais qui s’installaient pour toute la durée des vacances dans la vieille maison familiale, en savaient bien plus que nous, qui ne vivions qu’à l’autre bout du marais, plus près de la mer, mais dans un village bien semblable, et ne venions en visite chez ces grands-parents-là qu’une fois par mois, dans le lourd rituel du dimanche.
Mais on savait leur faire visiter aussi le petit garage automobile qui était notre terrain de jeu, ou aller nager dans les vagues : une enfance si banale, en somme, dans cette bascule des années cinquante, avec encore les ombres de deux guerres pas loin, et rien qui laisse pressentir les grandes furies qui allaient se saisir du monde.
Je crois que Jean-Claude et moi-même sommes profondément, malgré nous ou pas, enracinés dans cet avant, qu’il est ou a été aussi notre chance. La figure patriarcale d’Édouard Biraud, né en 1893, le père de Jean, côté Jean-Claude, et de Madeleine, du mien, y est tutélaire. Fils d’instituteur, marié à une fille d’instituteur, il sera à Verdun dans les batailles du front de la Première Guerre. Instituteur en monde rural, parce qu’il sait lire et écrire il y sera vaguemestre, avec la responsabilité d’un âne pour porter plis, colis et courriers dans la boue et la mort. Les futurs surréalistes, souvent étudiants en médecine, devront leur survie eux aussi à ces hasards : on les mettait brancardiers. J’ai le droit d’en parler : j’ai, dans mon tiroir des affaires secrètes, un petit carnet où le grand-père avait recopié à la main, de 1909 à 1914, ses poèmes préférés, où Verlaine tient la meilleure part. Le dernier poème recopié est de Victor Hugo, avec mention de la caserne de La Roche-sur-Yon où il est mobilisé, puis ensuite les pages sont déchirées. Je sais aussi que, lorsque dans l’armoire vitrée où étaient les livres et la collection de timbres-poste, j’ai découvert et lu son édition Larousse de Rabelais, il m’a dit qu’un ami du front, sachant qu’il venait de vers Fontenay-le-Comte, le lui avait offert. Il y avait aussi Balzac, et Perrochon, et Verlaine bien sûr. Moi, c’est à cette armoire vitrée que je tiens ma route. Dans le garage, de l’autre côté de la cloison, l’établi, les filets de pêche, et une trappe pour accéder à un grenier où l’instituteur agricole itinérant, ce qu’il avait été longtemps, avait accumulé tous les savoirs, conservait tous les objets : il m’a toujours semblé que Jean-Claude, qui tient de lui aussi son visage, avait trouvé sa route de ce côté-là.
Et puis ce coup de foudre, en tout cas ce que j’ai ressenti comme tel. C’était l’époque du lycée, en plein chamboulement de mai 68 : le monde s’ouvrait aux couleurs, aux voyages, au bruit insidieux de radio et télévision. Peut-être que c’était un coup de foudre pour moi (et Annick sa sœur, et Pierre, mon frère, mon autre frère et nos autres cousins étaient plus jeunes) encore plus que pour Jean-Claude : au moment même d’entrer en terminale, d’accéder à ce passeport pour l’indépendance, la lente sculpture du devenir, l’annonce qu’il allait irréversiblement et totalement perdre la vue.
Moi j’étais myope aussi, jamais les yeux n’ont été mon fort. Je crois que toute ma vie j’ai vécu, comme une ombre permanente, parallèle, la cécité de mon presque frère. Je me revois faire des exercices de marche dans le noir, ou comment ça pouvait être de jouer à colin-maillard dans le plus ordinaire et quotidien de la vie courante.
Jean-Claude voyait encore : et il me faut cette postface, là dans sa propre maison (et lui occupé à ses bateaux tout auprès) pour que j’ouvre en moi cette porte. Ce qu’il y avait de terrifiant dans cette maladie, comme le dernier regard de Michel Strogoff dans nos Jules Verne, c’est qu’elle s’annonçait comme inéluctable, que déjà le centre de la rétine était noir, mais que tout le reste de l’œil lui laissait encore pratiquer tous les excès qu’en pareil cas on veut pour soi-même. La course, le vélo, le bateau, comme un infini épuisement de soi-même qui était déjà sa marque.
Est-ce que je savais ce que je voulais ou pouvais faire, de quoi j’avais envie que soit pour moi la vie, en terminale ? Certes non. Pour Jean-Claude, c’était comme un exercice imposé : tu ne verras pas, donc tu seras kiné, parce que kiné on n’a pas besoin d’y voir. Cet oukase, on n’en a jamais parlé face à face, mais je crois qu’il résonne dans ce livre : ce qu’il faut de résistance intérieure, ou de dépassement, pour accepter à dix-sept ans (« On n’est pas sérieux à dix-sept ans », écrira au même âge le poète fugueur de Charleville) qu’on vous dessine une vie qui en rajoute encore sur la condamnation subie.
Et pourtant c’est ce qu’il a fait. Est-ce qu’on se voyait souvent ? Non. Est-ce qu’il y a eu une seule période de notre vie où nous ne nous soyons pas vus, dans la même densité, la même aventure d’enfance qui s’ouvre d’un claquement de doigts, comme lorsqu’il me soigne une contracture qu’il a lui-même fait apparaître, on l’a vérifié encore hier soir.
Je revois Jean-Claude étudiant à Paris, dans son école de kiné, la joie qu’il avait à la grande ville. D’accord, il portait ces lunettes fumées, disait que le monde passait progressivement en noir et blanc, mais que lui importait. Alors pour moi aussi c’était moins grave.
Moi j’ai erré, passé plusieurs années dans des routes de traverses, pas toutes gratifiantes. Lui, pendant ce temps, ouvrait un cabinet à Reims, tout en pratiquant ses soins à l’hôpital : oui, kiné c’était un métier comme un autre, mais ça semblait lui convenir.
Dès ce moment, je revois Pauline, comme si elle ne l’avait jamais quitté, depuis le lycée même. Que Pauline avait donc toujours été prévenue de la non-voyance de son amoureux. De ces années, et pour longtemps, ils deviennent indissociables dans le souvenir. Et les deux enfants qui naîtraient, un tout petit peu avant les miens. Et que la furie du garçon, champion de patinage de vitesse (aujourd’hui c’est la moto), mais qui partirait en tour du monde sur les destroyers de la marine, tenait bien de son double héritage, comme l’attirance pour la montagne, les longues aventures en ski de fond de sa sœur en étaient le versant symétrique.
Ce goût du sport comme un risque ou une limite à tout le temps rejoindre, cela m’est resté étranger, alors ça m’amusait de les voir : en tandem, en dériveur ou en kayak, ou le Jean-Claude partant faire le marathon de New York.
Souvenir d’un soir de brusque coup de vent sur la côte vendéenne, Jean-Claude parti sur une minuscule coque de noix, et que lui comme nous savait bien qu’à cinq cents mètres au large il n’était plus en possibilité de deviner la ligne du rivage. Au vent, oui. Mais quand il se met à souffler en désordre. Il ne revenait pas. Le soir tombait. Puis la nuit. On allait se décider à appeler les secours, dans les bourrasques la plage restait vide, et puis finalement il était de retour. Il n’avouait rien, mais on sentait bien qu’un mystère était là, qui ne concernait que lui et lui seul.
Paradoxalement, je crois que c’est cette même journée, ou le lendemain, que toute son image de kiné ordinaire s’est pour moi écroulée tout d’un bloc. On était dans ma maison d’enfance à moi, et dans le fond d’un placard il y avait un jouet, sous l’emblème Michelin, qui traînait là depuis des années : une sorte de portion de sphère en plastique bleu et rouge, sur laquelle on devait tenter de se tenir en équilibre. Et Jean-Claude de tomber fasciné, nous demandant l’autorisation de l’emporter : ça pouvait l’aider à soigner ses patients en guérison d’entorse. Ah bon.
Pourtant il le fut, et complètement, kiné. L’été, il nous racontait le tournoi de Roland-Garros vu depuis les coulisses, et comment ces stars qu’on voyait à la télévision se comportaient avec lui, une fois sur la table de massage. Puis l’aventure du stimulateur électrique, un simple boîtier portable et sa prise 220 volts, avec des électrodes au bout d’un fil. Dans le cabinet de Reims, les espaliers, les poids, élastiques et appareils relégués dans une pièce. Et, dans la petite salle où il soignait, juste de quoi s’asseoir, et lui devant. Il n’a jamais fait marche arrière.
Quant à voir, c’était bien fini (provisoirement peut-être, c’est évoqué dans le livre : il y a eu ce soir où il m’avait téléphoné en pleurant, parce qu’il venait de réapercevoir ses mains, et l’écriture du livre et son projet sont en partie venus de là). Jean-Claude, dans le monde non-voyant, les championnats handisport, les matériels qui facilitent la vie urbaine, s’est impliqué avec la même rage : comme si ce type-là ne s’était jamais appartenu lui-même.
Jean-Claude racontait maintenant ses rencontres avec des podologues, et tout le mystère qu’on pouvait remonter depuis la voûte plantaire. Ou ses rencontres avec des acupuncteurs, et tout le mystère que comportaient ces méridiens qu’il apprenait, là où ne savions rien. Sauf qu’il racontait aussi tellement d’histoires de soin : non pas le patient, ni la pathologie, mais ce qu’il avait appris.
Comment lui était apparu ce que depuis si longtemps il aurait dû voir, mais qu’il n’avait pas vu (le verbe voir a toujours été présent dans son vocabulaire). Je le revois une autre fois, un peu plus tard, dans cette période où avec Pauline ils partaient dans de longues expéditions avec leur petit camping-car Toyota, le tandem et les kayaks, un dériveur en remorque : c’était l’époque que nous, ses proches, appellerons « l’époque des petits scotches ». Ces rouleaux de scotch à pansement tout minces, qui se déchire entre deux doigts : un scotch ici, un scotch là. Tu te retrouvais avec six ou sept petits bouts de scotch sur le front ou le coude ou le bout du doigt, et qui aurait compris ou expliqué à quoi ça pouvait servir ? Simplement voilà, le résultat était là : guéri, plus mal. Les proches comme ces clients qui peu à peu se bousculaient pour ses services.
Ou cette manière qui lui est venue peu à peu de se passer même de cabinet : là, à Damvix, dans la maison familiale, il soignait. De passage chez tel ou tel, ou dans son Jura d’adoption, il soignait. Mais c’en était bien fini de ce qu’on nomme encore parfois « masseur-kinésithérapeute ». Il continue, paraît-il, dans ses formations ou pour certaines pathologies, d’utiliser les petits scotches. Mais c’était cette phase qui mènerait à ce que les gens qu’il forme nomment « méthode Biraud » qui s’ouvrait — le soin qui peut même s’exercer à distance.
Et comment nous-mêmes aurions pu le mettre en cause, quand il nous disait son propre étonnement à ce qui progressivement se révélait ? Un jour il me demande de trouver, en moi, l’image qui serait affectivement la plus dense, la plus profonde et nette émotionnellement. Je n’ai aucun mal à la trouver. Il me demande de la lui transmettre et qu’il va, lui, y déposer un objet. Je pose cette image sur la table, c’est ce qu’il m’a demandé de faire, puis je la reprends : on va créer, puis supprimer de nouveau, une douleur, un souvenir. Il y a maintenant plusieurs années que j’ai pu me familiariser avec ces éléments si mystérieux de soi-même, oh, juste une toute petite partie. J’en ai retrouvé témoignage dans des thèses et recherches très savantes sur le chamanisme sibérien ou amazonien, ou les pratiques de respiration telles que développées par le bouddhisme et même, mais plus universellement, dans les chemins du rêve, mais laissons : je m’en vais souvent rejoindre cette image intérieure, qu’il m’a aidé à faire naître, et parfois je l’y trouve assis qui m’attend. Ce n’est pas cela qu’on trouvera dans ce livre, mais certes le chemin que s’est ouvert lentement Jean-Claude n’est pas à son terme.
Il s’est voué à soigner, comprendre l’infinie complexité du corps, mais dans le but de soulager, affronter des pathologies qui restent si énigmatiques quant à ce qui les déclenche, et ce qu’il peut y avoir de si injuste quant à qui elles choisissent pour victimes. Du chemin intérieur qui y mène, il n’est que très peu fait mention ici : l’humilité des grands.
Alors, et nous sortons à peine de ce deuil, l’irréversible maladie de Pauline, sa compagne, la mère de Nicolas et Caroline, et qui a partagé avec lui l’ensemble de ce chemin. La petite maison de Reims bousculée pour l’accompagnement de cette maladie. La rage à la vaincre, et puis un jour, de retour à la maison familiale du marais poitevin, nous accompagnions Pauline pour un autre voyage : « les morts aussi émettent des fréquences » dira sous le grand ciel qui recouvrait la tombe un lutteur qui ne se résignait pas.
La maison des grands-parents, dans ce labyrinthe des marais qu’il parcourt sans jamais se tromper, un jour on a décidé (je crois, et sans en parler, comme d’une évidence), l’ensemble de la communauté familiale, qu’elle serait la maison de Jean-Claude. Aujourd’hui encore, il y reste des traces de l’enfance, des outils, et l’air même est celui qu’on a en partage, mais dans cette maison il voit.
C’est là qu’on a terminé ce livre qu’il a dicté, qu’ensemble on a relu et travaillé, puisqu’il m’a donné cette chance-là de l’y accompagner : le coup de foudre de nos dix-sept ans, il se résout dans cette paix, ou ces nouveaux mystères. Une vie selon son choix, et qui nous a donné à tous.
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne et dernière modification le 4 juillet 2020
merci aux 1714 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page

