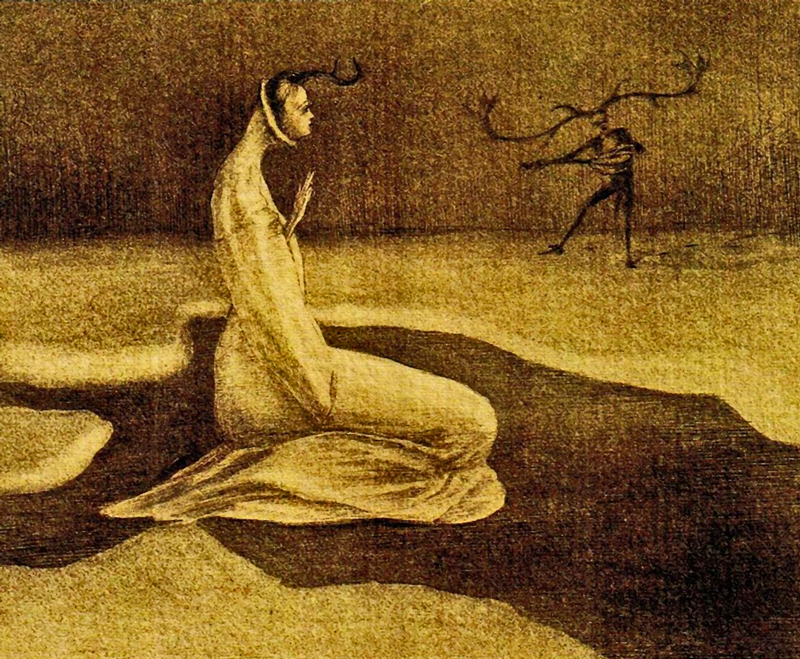
triptyques de personnages vus de trop près
– présentation et sommaire du cycle été 2017
– la proposition 2, avec vidéo et textes supports
– rappel : les contributions reçues sont mises en ligne par ordre chronologique de réception, et un groupe Facebook est disponible pour échanges, discussions, interactions entre contributeurs ;
– envoi des textes par réponse depuis la lettre d’info, fichiers joints au format .doc .docx .pages .odt (mais pas .pdf ni dans le corps de l’e-mail) – toujours rappeler en fin du doc la signature souhaitée, ainsi que l’url du site ou blog s’il y a !
– ne vous laissez pas avoir par la musique des autres, prenez du risque, faite que chaque triptyque ait sa signature formelle !
– aucun problème pour se joindre à nous en cours de route : voir le pass Tiers Livre pour contribuer (et nota habituel : accès ouvert à étudiants écriture EnsaPC ou UCP, pas besoin du pass...).
.... et super merci à tous ! FB.
Assis sur le siège individuel, il a déplié un journal écrit en chinois, on se demande comment il arrive à déchiffrer ces colonnes d’idéogrammes. Un seul truc de compréhensible sur la page qui me fait face : la photo du dirigeant de la Corée du Nord avec sa coiffure carrée de rappeur américain. Le métro file comme un plat de nouilles. Arrivé à la station Place d’Italie, le passager descend et se dirige vers un restaurant qui porte les mêmes caractères, en rouge, que ce qu’il lisait tout à l’heure dans le rythme tremblé du voyage souterrain.
Son smartphone est un univers en soi, ses cheveux blonds l’encadrent. Elle tape à toute vitesse un message, sourit, ne lève jamais les yeux de son écran. On dirait qu’elle fait la course avec les quais qui se succèdent : jamais elle ne s’arrêtera peut-être à une station. Si ses pouces étaient plus petits, elle écrirait encore plus vite. Je me lève pour sortir à République et j’entends alors sonner l’arrivée d’un SMS sur mon mobile. J’imagine que c’est peut-être elle qui m’envoie un message interminable.
L’un est brun et barbu, l’autre est chauve et glabre. Ils sont montés à Hôtel de ville mais n’osent quand même pas se tenir par la main. Ils parlent doucement, et c’est rare : ils n’utilisent pas au même moment leurs téléphones pour communiquer avec d’autres. Ils ont l’air bien dans leur peau. Une femme chic les regarde à la dérobée, comme avec un sentiment désapprobateur. Elle pense sans doute : « C’est du propre ! ». Elle trimballe un sac à main siglé Vuitton, ça fait plutôt ringard. Elle ne prend jamais une voiture noire Uber ?
Au milieu de la rame qui transpire vers Gare de l’Est. Je dévisage dans la porte vitrée mes certitudes bien cravatées. J’ai l’air froid, important, satisfait. Mon voisin garde avec mon cartable en cuir marron patiné une distance respectable. Entre les néons qui défilent, deux casquettes haussent derrière moi leurs pectoraux dessinés sous la finesse d’un coton pur blanc. Leur jeunesse ne me défie pas : ils ne m’ont pas vu.
Il est chauve, un peu rond. Il porte des chaussures en daim rouge qu’il pointe vers l’intérieur. Les portes claquent. Il replonge dans sa lecture, oubliant rapidement le monde chaotique qui le transporte. Soudain, sans jamais plus quitter son livre des yeux, se met à grimacer. Se tripote le nez, sans gêne, avec l’index, avec le pouce, soulève ses babines, contorsionne sa bouche puis promène, lentement, avec une inquiétante sensualité, sa main blanche sur son crâne rasé. Je n’ai pas noté le titre du bouquin.
Chaussée d’Antin. Il s’est jeté devant moi sur un strapontin. Sans savoir. Un mélangé à peau mat, la bouche bien dessinée. Casque audio et jogging, cordon dénoué. Il regarde par la vitre, deux petits grains de beauté au dessus de la lèvre, perdu dans des pensées où je ne suis pas. Station Cadet. Il avance vers moi sa basket à virgule. Je pousse négligemment le noir ciré de ma chaussure. Détaille l’espace entre nos bouts de pied. Trente alvéoles, six têtes de vis, deux portes et vingt ans nous séparent.
voilà c’est reparti je divague au kilomètre comme la foule méduse multicolore qui déferle en lame de fond droit sur moi c’est sûr je passe pas je peux jamais pourquoi c’est toujours moi qui m’arrête coincé bloqué la masse jette son paquet de mer devant moi étrave je la fends en deux mais non elle m’ignore pathétique écueil bon ça se bouscule s’éventre en deux courants sauf lui là qui avance tête baissée droit sur moi les yeux rivés sur l’écran de son portable il capte rien va me rentrer dedans non il esquive – comment ? – au dernier moment – tiens ? – un sonar - un instinct pour éviter l’obstacle au radar ? Lui et tout ceux-là qui marchent sans rien voir tournant comme des automates aux embranchements carrelés de blanc. Se hâtent et se bousculent têtes et bustes perchés sur jambes pressées en transit.
le mendiant filiforme accroupi au ras du sol, son treillis, son sac plastique, le gobelet marron foncé Paul entre les longs doigts maigres et sales, ses yeux bleu-acier de mer ses cheveux gris raides et filasse - sa barbe plus sel que poivre et son air pâle d’entre-deux morts. M’a vu venir de loin, harponné, crocheté dans la marée. Tu me payes un café ? Et ça là dans le gobelet carton, c’est pas du café ? Rires ! C’est du froid. Tu comprends y m’faut un café pour tremper le pain, c’est parce que j’ai plus d’dents. C’est vrai la misère ça bouffe les dents. Lui ai payé un nouveau café de chez Paul d’à côté.
dernier palier bétonné avant l’ultime volée de marches, bouffées brusques des poinçons d’air froid le jour dehors s’annonce la fatigue et son plomb je les laisserai dedans oui dedans. Ces deux là. Lui grand mince, manteau beige trois quart col en imitation mouton, jeans. Réfugié au creux de l’encoignure. Elle petite, jeans moulants – baskets blanches, pull épais torsadé, bombé doux –chaud à l’endroit des seins, bonnet, cheveux qui, par en-dessous, débordent. De sa main gauche Elle a saisi le col du manteau de Lui, et Elle le tire vers Elle et Elle l’agrippe, se hisse vers Lui qui la domine, le courbe vers Elle tandis que de sa main droite Elle emprisonne la nuque de Lui et entortille les cheveux bouclés noirs autour de son index à Elle. Envoûtés Elle et Lui embrassent et aiment férocement entredévorer Lui et Elle. La foule dispersée ici en molécules singulières - soupçons d’humains - ombres-fossiles – les dépasse ignorante. Ces deux iridescents là.
Dans le TER en face de moi s’assoit une étudiante qui pose sur la table du carré son poisson – un élégant combattant aux nageoires bleues flottant comme des voiles dans l’eau- dans son bocal archétypal. De minuscules galets en verre vert tapissent le fond du petit aquarium. La jeune fille s’adressant à une autre explique en souriant qu’elle éprouve le besoin d’amener dans son studio de la compagnie pendant sa semaine de cours. D’où le transport de l’animal de compagnie aquatique. Étonnement de voyager en train avec devant moi, tournant en rond, un ravissant poisson bleu, passager insolite de la SNCF, découvrant de son univers aqueux celui du transport ferroviaire.
Au Géant Casino à 18h45, la queue aux caisses est longue, quelle que soit celle vers laquelle vous vous dirigez par défaut. Au bout de dix minutes, c’est quand même votre tour de commencer à déposer vos produits sur le tapis roulant, derrière ceux, bien séparés par la baguette ad hoc en travers, du client précédent. Vous avez alors le temps d’observer la caissière et les faramineux tatouages qui couvrent entièrement ses bras nus : l’un d’eux est tatoué d’un bas résille intégral, l’autre de bijoux entrelacés et d’une phrase scellant sur la peau l’amour pour un nommé Cyril. Le décolleté de l’opulente et accorte caissière est ouvert, laissant entrevoir un autre tatouage, cœur coloré celui-ci, sur sa gorge au-dessus de sa poitrine. La caissière vous salue de manière sympathique et enthousiaste et tout en flashant les codes barre de vos articles, vous informe que quelqu’un vous regarde dehors, sur sa droite, de l’autre côté de la vitre du magasin : une copine vous attend en effet. Vous êtes autant impressionnée par la vivacité multidirectionnelle de la caissière que fascinée par l’élaboration de ses tatouages.
Premier tour des élections présidentielles. Bureau de vote n°2 d’une ville de 7000 habitants. Il y a plus d’une heure de queue avant de pouvoir espérer déposer son bulletin dans l’urne. La queue fait un angle droit, commence sur le trottoir et se poursuit à l’intérieur de la salle des fêtes. Un monsieur obèse en fauteuil roulant automatisé vous salue. Vous le connaissez vaguement et lui faites part de votre doute quant à la possibilité même de voter –votre train part dans trente minutes, et même si la gare est toute proche, vous hésitez à courir le risque de le manquer pour accomplir à tout prix votre devoir civique. Le monsieur en fauteuil se décale de la queue pour la remonter jusqu’aux assesseurs puis revient aussitôt vous annoncer d’un air entendu : « c’est bon, allez-y, je les connais, ils vont vous faire passer. » Et c’est ainsi qu’un peu embarrassée quand même, vous allez voter après seulement cinq minutes de queue, grâce à un citoyen handicapé solidaire qui a pris en main et résolu votre dilemme.
Il y a ce volumineux livre ouvert aux dernières pages, aux caractères si minuscules et si serrés, tenu par deux mains ordinaires délestées sur une paire de cuisses non moins ordinaire. Je ne vois pas le visage, basculé en avant mèche pendante. Le haut du corps est courbé. Le tout pétrifié est affecté en bloc par des vibrations et secousses plus ou moins brutales. Autour, les bruits anéantissent l’idée même d’une conversation. Comment fait-il pour lire ?... est-ce bien ici la fonction du livre que d’être lu ?... est-ce bien ici la fonction des vies que d’être mues ?
Une mâchoire qui tire tout le corps vers l’avant, de profil, tout le visage vers le bas, de face. Mais ce n’est rien à côté de la gravité musclée qui parcours chacun de ses traits. Sa peau est tendue, écartelée entre les angles, les arêtes, les méplats d’un visage cabossé. J’ai croisé son regard bleu, exorbité et pénétrant, surmonté de sourcils rivetés à la lisière du cuir chevelu. Il ne porte aucun objet sur son crâne rase, aucun objet dans ses mains écorchées. Pourquoi ne m’a-t-on pas permis de faire sa rencontre avant ?... avant que je ne puisse émettre un jugement ?... avant que tout mon être habitué ne perçoive dans ce décalage une violence terrifiante ?
Au milieu des froides beautés parisiennes, huiles d’un réalisme absolu et fou, elle révolutionne principes et perspectives. Je la vois qui se tient d’une main délicate à la barre verticale, délicatesse qui parcourt tout son corps jusqu’au mien. Je me redresse involontairement. Elle est de dos, les cheveux bruns, ondulés, détachés et ramenés vers l’avant au-dessus de l’épaule gauche, laissant découvrir la peau de son cou qu’une tunique légère vient caresser. Des frissons m’assaillent. Je ne pourrai la regarder si elle se tourne. Elle, pourrait tout voir en moi, je le sais. Que la splendeur est intimidante ! Qu’elle est violente ! `
Sur le banc dans la station, elle suce ses doigts encore un peu chocolatés, l’impression que c’est là le souvenir du seul repas de la journée, du seul plaisir de la journée.
La capuche du pull à capuche du jeune en pull à capuche tient à peine sur sa tête, pas enfilée, posée comme un peu un perroquet. J’attends alors que la 14 freine fort, fort, pour voir un perroquet s’envoler.
Il occupe trois places. En comptant ses sacs et ses jambes. Mais pourquoi ne serait-il, après tout, que juste un tronc, parce qu’on serait assis, tacitement enjoints à ne se regarder qu’à demi, à demi aussi nos yeux, puisque partant du principe qu’on devra, c’est le jeu du RER, se croiser sans se voir vraiment, sans se regarder. La brûlure à son avant bras pourtant. La peau râpée qui devient rose vulnérable. Si j’ai envie de toucher ? J’ai envie, et peur à la fois. Ses bras. Lorsqu’il pose son téléphone contre l’oreille c’est le bras qui tout entier se recroqueville pour mieux déballer sa puissance. Et c’est vrai que je l’écoute moins que je le regarde mais c’est vrai aussi que c’est dans une autre langue. Il remet le téléphone dans la poche et je sais que c’est habituel ça, le frottement alors du téléphone contre sa cuisse. Il met ses mains entre ses jambes qu’il a posées sur la petite barre du siège d’en face, comme à l’église les barres font envie aux enfants, et même si on n’a pas le droit. S’il est croyant ? Ça ne se sera pas vu. Il est croyant : une coccinelle vient de tomber du plafond sur ma robe, et on s’est souri. Il est croyant ou dieu existe, n’importe, et dieu prend le RER C.
Il aime lire dans le métro. Il oublie alors tout ce qui l’entoure. Il ne remarque plus rien, et ce jour ne voit pas la jolie jeune femme qui le dévisage, furtivement. Elle essaye de lire le titre de son livre, lui est absorbé, ne change pas de position, presque statufié. Elle n’est pas loin pourtant. Elle essaye, encore, cette fois de croiser son regard pour alors oser lui parler, engager la conversation : il est charmant. Mais cela ne prend pas, ne marche pas. Elle se demande quel est ce livre qui le coupe du monde qui l’entoure. Elle soupirera quand il descendra de la rame.
Il marche d’un pas assuré et rapide, traverse les couloirs, prend l’Escalator puis de nouveau un couloir, un autre encore. Cette sortie n’en finit pas d’arriver, de se faire désirer. C’est en sortant du métro qu’il le verra. Assis par terre, mal habillé, l’oeil vague et perdu, il tend une coupelle pour recevoir. Après une brève hésitation, il s’arrête, cherche une pièce, la lui donne. « Merci , merci » recevra-t-il en échange.
Elle repère malgré elle cette femme qui pleure, au milieu de la rame. Elle est si touchée par cette femme qu’elle ne peut s’empêcher, va vers elle puis l’accompagne quand elle descend de la rame : « Madame, ça va ? Vous avez besoin d’aide ? » « Non, non, ça va, merci », balbutiera la dame entre deux sanglots.
La voix enregistrée annonce la station où selon le chauffeur du bus je dois descendre. La nuque sous chignon croulant de la femme assise juste un peu devant moi se dresse, elle pivote sur son siège, ses jambes sont de grosses gourdes violacées, mes yeux imaginent leur douleur, font honte à ma crispation panique. Je suis ses trois pas trébuchant vers la porte en tentant un sourire qui laisse insensible la sérénité de son beau visage nu, mon regard guette l’arrêt, parallèle à son attente lasse.
Nous descendons presque sur les pieds d’un homme assis sur un banc abrité sous un micocoulier, un complet usé porté avec une dignité qui parle des Aurès et ce visage d’ancien, sec et doux, humble et fier, qui me donne envie, malgré mon âge, de l’appeler oncle avec déférence, des yeux où dort une lumière, venue peut-être du livre auquel il retourne, un livre de poche, quel ?, pour user les heures ou un peu plus.
Avance vite vers mon rendez-vous, en suivant trois croupes, trois crinières et trois rires, avec l’effarement de ma génération devant la joyeuse arrogance des deux fesses chaloupant gaiment dans un minuscule short découvrant les fortes cuisses de celle qui monopolise la parole. En les dépassant, attendrissement dans la vision furtive des traces d’enfance du visage et le petit animal que je crois deviner derrière les yeux très fardés.
C’est la ligne 13, « Guy Môquet ». Deux hommes montent, prennent deux strapontins, la foule se tasse, eux s’assoient. L’un, casquette de base-ball, vieux blouson de cuir, santiags, bière à la main, est très énervé. « Ils veulent mourir ceux là ! Ces mecs, ils se croient où ? T’as vu comment ils me parlent ? Rien à foutre de leur musique, de leur chiens… Ils se croient pauvres mais c’est 400€ le RSA... Ils devraient aller en Syrie, tiens. Là bas, c’est pas 400€ qu’on te donne, c’est une kalach’, des munitions, et allez, dégage… Et si t’es pas d’accord, une bonne rafale dans le ventre, ça calme ! ». « C’est clair », répond son pote.
Un parking de supermarché, devant la place Handicapés. Il cherche à se garer mais la place est prise. Il fait le tour, puis il revient. La voiture sur la place a mis ses warnings, il ouvre sa vitre, il s’énerve. Une jeune femme sort du magasin, se dirige vers la voiture au warnings. « C’est une place pour handicapés, madame ». « Et alors ? J’en avais pour cinq minutes, y a pas le feu ! ». « Madame, ça fait plus d’1/4h que j’attends », plus fort, « et, j’ai demal à marcher, moi ! » Elle monte dans sa voiture, manœuvre vite, ouvre sa vitre et lui crie « de toute façon, t’as une tête à attendre ! ». Les pneus crissent sans réplique.
Le petit vieux, de retour du marché, s’essouffle, alors il pose son cabas. Juste avant de me croiser. Je passe devant lui, nos regards se croisent. Il a les joues creusés, les yeux enfoncés, la casquette un peu rejetée en arrière. Je lui demande s’il a besoin d’aide, il sourit. « Ça va », me fait-il, « c’est l’opération, j’ai été opéré du rein, ça tire un peu, alors je fais des pauses, j’habite juste un peu plus bas ». « Ah, moi aussi ». Je sens qu’il cherche la conversation, je ne sais pas quoi ajouter, je lui dit un peu brusquement « au revoir ». En partant, je me retourne, je garde en mémoire, son regard de solitude, la vieillesse sur ses épaules. Je ne suis pas à l’aise, j’ai presque honte.
Guy Fawkes Night, flamme de novembre, feux d’artifice en défi à l’hiver. C’est une obscurité d’encre plus que de poix, intense aux yeux et légère à la peau, et l’on va par enjambées rétrécies dans le spumeux clapotis des voix, surpris par la soudaine proximité de corps et de visages échappés in extremis à la rétention nocturne – se frôler pour ne pas se cogner. Sans les hélices fluorescentes qui fleurissent à hauteur de genoux ou de hanches, on piétinerait des enfants. Vient un silence inaugural, puis la lacération d’un sifflement colorature. Eblouissante, une rosace de feu cathédrale les ténèbres. Fracas. Presque au-dessus de moi surgit la ligne fulgurante d’un profil, le nez long, l’œil celé au creux d’une orbite profonde. Stridence, lumière. Le ciel étouffé de lueurs finit en reflet d’incendie sur un verre de lunettes. Sur les cheveux, le mauve des fusées ne s’altère pas : signe d’âge. Un crépitement d’argent révèle les cratères d’une joue, un sillon lunaire glissant vers la bouche. Et puis – reflet d’absinthe – brille une queue de comète… un rêve de sel sur ma langue. Le bouquet final : big bang pour les funérailles de l’année.
Jour de grève sur les quais du RER – et c’est l’été. On sent moutonner les trop-pleins, s’effriter les garde-fous d’une civilisation faite à l’équilibre tempéré. Les soupirs enflent sous l’étau des maxillaires, les odeurs offensent, et déjà, la fermentation fait éclater quelques tempéraments volatils. Pourtant, trois rangées de corps plus près des rails, flanquée par des masses suantes qui la dépassent de l’épaule et lui donnent l’air d’être conduite à son jugement, il y a cette silhouette frêle, droite sans raideur. Il y a cette nuque parfaite sous un chignon d’une hâte savante, ces épaules flottantes, ces bras naissants promesses de paumes ouvertes. La nuque comme la chemisette sont sèches. J’en déduis, jaillies de sandales romaines, des jambes de danseuse qui seules, dans l’immobilité forcée, peuvent justifier cette grâce d’apesanteur. L’espace s’ouvre. Le RER peut tarder.
Déjà cinquante minutes de queue bien tassée, mais les sourires fleurissent toujours les barbes – la jeunesse, réelle ou prétendue de cœur. Déjà dans l’ambiance, on teste discrètement le ressort de ses jambes et de la chevelure qu’on porte longue, on éveille du menton la pulsation à laquelle on désire impatiemment livrer le mou de son ventre – qu’il durcisse – et le cristal de ses os – qu’il crie (crisse, craque). Les T-shirts font placards de circonstance : logos, slogans, crânes et seins, violence en technicolor. Un sage polo vert m’étonne le coin de l’œil. Je lève la tête. Aussitôt, c’est l’une en l’autre l’invasion et l’échappée : la posture paisible, le casque de vagues auburn, les iris de mousse et de varech, la peau nue – un champ de taches de rousseur – convoquent une lande couchée sous le vent. J’aperçois le goéland juste avant qu’il ne me traverse la poitrine. Sa compagne, une beauté aile-de-corbeau, tatouée, piercée – un champ d’expression artistique – lui tourne presque le dos, parle fort aux barbus à slogans, rit, la voix déjà floue. Lui – sur sa lèvre supérieure se sont égarées quelques taches de son, qui vacillent. J’ai peur de la désobéissance de mes mains.
Elle aimait à descendre dans le métro sans le prendre à la station Rue de la Paix quand il faisait trop froid à son goût (c’était en automne, souvent, elle avait les cheveux presque mauves et portait un manteau d’astrakan et une toque du même métal, on aurait pu la prendre pour madame Nikita Kroutchev). Assise sur l’un de ces bancs de bois bordeaux, les mains croisées sur son sac noir, elle regardait le monde passer courir vaquer, ignorant d’elle, tandis que la maison blanche et bleue de la Marsa hantait ses rêves.
Le poil roux taché de blanc, au cou un tissu dans les jaunes devenu écharpe par son élégance, sur la tête un chapeau de paille, debout son ukulélé aux bras, il chante doucement cette merveille que Jose Eduardo Agualusa a intitulée « Milagrario Pessoal » (musique Ricardo Cruz). Du sac qu’il porte à l’épaule dépasse un Melodica vert clair au bec blanc et noir.
Ce n’est pas en métro qu’on doit rentrer du cimetière. Surtout quand on y a croisé ces gens toujours plus ridés, toujours plus voûtés, toujours plus aigris. Une voilette cache la petite mouche qu’elle s’est dessinée sur la joue, avant de partir, parce qu’il aimait cette façon, elle regarde les voies de chemin de fer au dessus desquelles passe la rame et serre dans sa main gantée la rose (« rouge, cœur ardent ») qu’elle n’a pas jetée dans la tombe.
Ce matin, nous avons l’attente en commun. L’une, ses cheveux bleu électrique relevés en un chignon lâche autour de son visage gris perle, leggings imprimé d’ovnis et pull brodé de comètes comme si le papier peint de sa chambre d’enfant avait déteint sur sa peau, me sourit longuement. On vient de la même planète et, sous la verrière scintillante de pluie et de soleil, on se parle comme on le fait entre extraterrestres, par ultrasons, ravies de se retrouver après des millénaires de migration. Son fiancé la rejoint : l’anglais, continuité enchanté sans rien qui pèse, heurte ou tranche, auquel elle répond en le détachant et le désarticulant légèrement – accent allemand. Elle continue de me regarder, du blanc des yeux. Rien ne peut troubler notre entente d’outre-ciel. Une femme croisée dans le métro, qui était moi en noire et j’étais elle en blanche, des sosies de hasard ? de destinée ? On avait ri et le rire était notre manière de toucher nos visages à l’aveugle, de se régaler de ressemblance dissemblante. Sa fille sur les genoux, elle avait entonné en cadence : regarde comme la dame est belle, belle, belle, et joyeuse de la joie de sa mère, l’enfant avait fêté en lançant ses M&M’s en l’air comme des confettis.
Un autre, les coudes sur ses jambes écartées, sa main sur sa nuque inclinée, chante pour lui-même, le corps en caisse de résonnance. Tous l’écoutent en feignant de ne pas. L’espagnol d’Amérique latine, aux inflexions italiennes, purifié de la nasalisation chuintante du Vieux Continent, ayant mêlé à la terre des origines une part égale de soleil, fondu la langue des hommes avec la langue des anges pour un alliage sacré. Une fillette, 3 ou 4 ans, se laisse choir devant lui. Allongée par terre, elle brasse le soleil avec ses bras et ses jambes, imitant l’oiseau de là-bas, de leur pays à eux, gigantesque, moite et bariolé. Il lui sourit. Je le sais sans le voir, à la variation de sa voix. Un Californien rencontré dans un train avait envié ma maîtrise des langues : ça te permet de connaître plein de gens ; et les gens sont bons, n’est-ce pas ? J’avais regardé ailleurs et acquiescé songeuse, pensant : les gens font comme ils peuvent.
Une femme s’assied à côté de moi et me parle en me prenant la main. Mes rêveries sont des rivages pour bien des égarés. Un illuminé croisé sur les marches de Saint Gervais avait eu une révélation dans une église du quartier tapissée de cierges. Il ne parvenait pas à la retrouver et la cherchait dans la lueur jumelle de mes yeux. Les brumes, me dit-elle, comment font-ils pour vivre dans les brumes ? On ne peut pas rester dans le flou comme ça. Ça vous donne le vague à l’âme. Ma fille vit à Milan. Ah votre frère vit à Londres ? Les brumes, alors, vous connaissez. C’est le grand problème des Allemands, les brumes. Un pays trop humide. Vous êtes de Paris ? Bien, bien. Les brumes, ça brouille, ça embrouille. L’italien de la Sardaigne aux arêtes rudes et étincelantes, à la fois pétale et épine du cœur, tour à tour désert et oasis d’une réalité retrouvée. Un homme se lève. La femme s’interrompt, l’enfant au sol se tord et la fiancée bleue frémit. Il se lève et s’éloigne, me dérobant son visage, oubliant derrière lui un sac, d’où pourrait s’échapper le souffle de la mort. Clous projetés dans la chair, cet éclat des sans éclat.
Ça roule ça oscille, bras tendus accrochés ferme au bâtiment qui tremble dans l’accélération, mais il essaie de tenir bon même si l’oppression le gagne, sueur perlant sur son front malgré le frais de la saison — plus fraîche que la normale ils ont dit —, pourtant il est en sueur, il a du mal à supporter. Une mauvaise nuit sans doute, relents de fumée de saleté collés à son costume élimé, relents insupportables à mesure du trajet quand on est comme moi projetée le nez dans le tissu. À être tassés, impossible d’échapper. Entrée en station, ouf la porte claque, il sort ni vu ni connu — ce qu’il croit.
Juste en face une fille écrit sur son téléphone sans broncher, ne bouge presque pas — enfin le moins possible, juste les pouces très vite —, elle ne veut pas croiser les yeux de quelqu’un d’autre, elle veut rester avec elle-même dans son téléphone, avec les odeurs de la nuit précédente, les images accumulées conservées dans un petit coffret à ouvrir plus tard quand elle sera seule dans le regret d’une histoire très romantique, imaginée peut-être ou déjà achevée. À un moment donné sa lèvre se tord, je ne suis pas sûre mais j’ai l’impression qu’elle va pleurer.
On lui a cédé un strapontin. Elle s’y installe difficilement, quelqu’un l’aide un peu. Puis elle ramène sur elle le pan de sa jupe pas toute jeune, le voyage n’en finit pas, sac posé sur ses genoux qu’elle retient de ses mains ossues toutes ridées tavelées. J’imagine sa difficulté à se déplacer à pied dans la ville et à transporter ses possessions, son dos accablé et sa nuque couverte de petits cheveux blancs repoussés dru sous la ligne de croissance habituelle des cheveux, la douleur dans ses articulations. — Ça va, madame ? Ça va aller, vous êtes sûre ? Même si elle hoche la tête et murmure — Vous êtes gentille, je veille sur elle quand elle descend de la rame.
Les rires sont pour moi incontestablement slaves autour de la table à côté de moi et font vibrer la mienne. Chacun des cinq en est à sa cinquième bière au moins. L’épicier azéri regarde dans notre direction d’un air amer et résigné. La fixité de son regard m’intrigue. C’est cela qui le fait sursauter sans doute lorsque la jeune femme qui vient d’entrer plaque une photographie sur le comptoir. Il regarde, hagard, fait le geste d’enfoncer avec le poing le bocal de malassoli resté sur le comptoir. On dirait qu’il demande quelque chose à la femme puis il répète distinctement : ha-ri-cot.
On dirait que la femme au sac à dos rouge n’a pas vu entrer les policiers. Qui de la serveuse ou de moi les a vus en premier ? Moi, je n’ai pas bronché, à ma table, près de l’entrée. Elle, a stoppé aussitôt le mouvement tournant du torchon à l’intérieur du verre. Mais elle enchaîne en allant à la table de la femme qui a presque crié pour couvrir les voix du groupe qui chante. Veut-elle juste une autre limonade ? Elle a l’air de parler beaucoup. La serveuse, imperturbable, va chercher un document dans son sac derrière le bar et revient le plaquer sur la table, devant la femme, qui alors se tait. Les policiers, eux, n’ont toujours pas bronché.
L’ambiance est plutôt gaie au salon de la miniature nautique. Comme j’aime ce soleil revenu après une quinzaine si pluvieuse et si froide ! Pour la plupart des gens présents, c’est sans doute le jour ou jamais d’être tout entier à sa passion. Je commençais à être gêné pour la femme à peau pâle, assise devant une unique pièce. Aucun visiteur depuis ce matin et voici que s’approche d’elle le jeune homme à peau noire luisante qui balayait le trottoir tout à l’heure. Il prend la forcola, l’examine. Je retiens mon souffle. Il sort de sa poche une pièce de deux euro et la tend à la femme. Celle-ci éclate de rire.
Vingt-trois heures vingt deux, métro Foch. La rame vient juste de quitter le quai. Dix minutes d’attente pour la suivante. Tu t’assieds un peu à l’écart, à gauche après les distributeurs, il y a trois sièges moulés vert pomme. Sur le quai en face, le métro s’arrête puis repart. Les quais sont vides. Tu consultes sur ton portable ce que tu as pu manquer depuis les trois dernières heures. Et tout à coup il est là, devant toi, et sa voix pâteuse te fait lever la tête sur le short kaki, la braguette ouverte, le T-shirt noir et la chaine à gros maillons en argent, les cheveux bouclés noirs sur le cou large et les dents écartées. Tu penses Virgile. Tu ne sais pas pourquoi, les cheveux peut-être, les yeux vides, comme le buste sur le livre de latin des années de collège. T’aas du feu ?... Tu réponds à peine, non, je ne fume pas et tu te lèves. Ouaaais, c’est toujours paareil… Il fait trainer les mots. Pourquoi tu t’eees levée, t’aaas euuu peeeuur ?.. Tu dis non, que tu as juste envie de te dégourdir les jambes après ta journée. Mais il continue à parler, de plus en plus fort. POOOURQUOOI JE VOOUS FAAAIS PEEUUUR ???... POOOURQUOOI ?... POOURQUOOI ?... Tu ne réponds plus. Tu ne le regardes plus. Tu as juste la trouille de sa voix qui enfle autour de toi. Il continue de crier, de crier qu’Il VAAA LE FAIRE, QU’IL N’EEN AA PAAS EENVIIE MAAIS QU’IIL VA LEE FAAAIRE tandis que toi, tu fixes quelques centimètres, concentrés sur le bout de tes pieds, le bord du quai, la ligne, les rails noirs, le muret de séparation sur lequel des publicités sont projetées en boucle, l’ouverture ovale avec, de l’autre coté, l’autre portion de quai vide. Et brusquement, derrière toi ça s’accélère, des voix crient, trois ou quatre filles que tu n’as pas vu et qui se précipitent. Monsieur !...Monsieur !... Faut pas faire ça ! Remontez ! … tout de suite ! Elles courent et ton regard les suit vers la forme noire, la silhouette descendue au bord des rails, vers l’annonce en jaune sur fond noir, l’arrivée imminente de la rame et les filles qui le hissent maintenant par les bras et il est, enfin, debout sur le quai, il les remercie doucement, tu les entends parler ensemble mais il revient et s’arrête devant toi pour crier TUU VOOOIS C’QUEE T’AAS FAAAIT ? POOUURQUOI ? POOURQUOOI ? POURQUOOI T’AAS EEU PEEUR ?
Dans le métro à 13h55, il y a ce couple en plein milieu. Elle est appuyée contre un poteau de soutien, et lui, grand type maigre, silhouette d’opinel à demi ouvert est courbé sur elle, qui se voute sous les mots qu’il lui crache, on voit les postillons s’éparpiller sur la tête penchée avec le cou qui s’offre : rien qu’un triangle de soie claire que dénudent les mèches de cheveux gras, raides et sans couleur et, à chaque coup de gueule, elle s’enfonce de plus en plus sous les bontés qu’il a consenties et il martèle, lui enfonce sa hargne, ses mots qui grimacent, théâtre, tragédie, versés sur la peau blanche, sacrifice d’agneau et, à travers toute la rame, beugle qu’il est venu pour elle, comme elle l’a voulu, et lui vomit le déjeuner, le kebab qu’il hurle avoir payé. Et voilà maintenant qu’elle veut rentrer ?... — Tu te fous de ma gueule ?
Il gesticule parmi la foule et ses mouvements nerveux font s’écarter les touristes sur le parvis de la Cathédrale. A moins que ce ne soit son sillage qui fasse fuir. Le cuir noir du cou est marqué de rides de crasse sous les cheveux collés. D’anciennes sueurs se dessinent en auréoles superposées sur le T-shirt kaki. Un chien bigarré le suit comme une ombre. Il invective, à grands mouvements tournoyants des bras, les groupes qui se pressent à l’intérieur de l’édifice, il fait les cent pas surveillant les deux accès et surprend ceux qui ressortent qui se dépêchent de fuir en descendant les quatre longues marches. Lui, il caracole sur son estrade improvisée et dans ses allers-retours furieux s’empêtre, bouscule d’un coup de pied le chien, surpris, qui grogne, les babines retroussées. Alors, tout s’arrête et le bras se lève de rage, la respiration s’accélère tandis que l’animal, brusquement aplati à ses pieds lève sur le poing dur prêt à cogner, des yeux - miroirs calmes et domptés du ciel - au fond desquels il se voit : double marionnette au bras levé. Alors, soudain désarticulé, la force le quitte et son bras retombe.
Narines alertées par une odeur indéfinissable, je contourne le petit jardin public. A proximité de l’entrée latérale, un homme immobile, toujours au même endroit, croisé maintes fois, par intermittence. Rigidifié dans une crasse indescriptible, pauvre armure , mais armure. C’est son regard hébété, vide, qui frappe. L’homme disparait puis réapparait toujours au même endroit, hanté par des ombres énigmatiques. Seules leurs traces supposées le maintiennent vertical, loin de la vie. Momifié dans l’hébétude, englouti dans l’indifférence, souffrance muette, anesthésiante. Je ne le rencontre plus désormais. Un homme happé. En perspective, une biennale de Venise, une œuvre exposée montrait un SDF filmé tombant d’épuisement d’un banc, continûment. Un scandale. Combien d’hommes déshumanisés hors champ ?
Dans l’autobus, une place assise à côté d’une dame ni très jeune, ni très âgée, le regard alerte. Sourires . Nous devisons, trajets d’autobus, lenteur, longueur, temps gagné depuis les voies dédiées aux bus. Puis les dimanches, qui s’écoulent, lents ou pas. Temps du dimanche, social ou pas. Long trajet du bus, on peut se dire. Mains dans nos poches, nous cherchons je ne sais quoi. Des billets de théâtre s’exposent. Nous avons vu la même pièce aujourd’hui. Nous descendons respectivement à deux arrêts contigus. Rien de plus.
Encore dans l’autobus(le 21) qui nous délivre d’une averse orageuse sans merci. Ma voisine m’apprends « C’est aujourd’hui que le quai des orfèvres déménage »« Ils l’ont dit aux actualités » Fichtre ! Mais que vont- ils faire de ce monument emblématique ? Un musée de la police ? Un hôtel 5 étoiles ? Un ciné- club ? Maigret, Colombo, tout ça, tout ça … Les couloirs, les escaliers, les tonnes de dossiers, les territoires des uns et des autres, les humiliations, les accusations, les soupçons, les condamnations, les affaires non résolues, les notoriétés, les habitudes, les petits bistrots du quartier … Me dit préférer Colombo (et son imperméable). Lui réponds que la lenteur de ces séries, réfléchir, fumer sa pipe, marcher tranquillement signent une époque révolue. En convient …Mais quand même aimerait un ciné-club de séries policières. Me remémore le quartier de la bourse avant que son activité soit transférée dans les salles de marchés des banques, les bonnes tables des habitués, achetant avec grand soin un cigare puis se rendant chez Debauve & Gallais choisir avec le même soin un chocolat après le déjeuner. Temporalités révolues, effritements, obsolescence, péremption.
« Je crois que je vais prendre votre bras ». La silhouette frêle s’accrocha au manteau de la jeune femme sans plus de préambule, freinant la démarche dynamique qui s’élançait sur le passage piéton. Non mais, elle ne le permettait pas, elle était pressée ! Les vieux qui s’imaginent qu’on est à leur disposition et qu’on a le temps ! La bouche maquillée resta cependant coite et esquissa juste un sourire poli.
La petite s’élance sur le trottoir, elle est en retard, zigzague sur son vélo, alternant les coups de pédale. En elle sourd la panique du père qui gronde, elle est toute proche, plus qu’une minute et elle sera en retard pour dîner, ça va encore mal se passer, il aura bu et elle sera toute fragile dans sa poigne de géant. Un dernier coup de pédale, elle y est presque, elle tourne au coin, percute, tombe. Sa jambe sous le vélo touche la jambe d’une femme qu’elle a renversée. Etendues toutes deux sur le trottoir, un temps pour se demander s’il y a de la casse, remettre ses idées à l’endroit. Mais on n’a pas le droit de rouler comme ça, tu ne peux pas faire attention ? D’autres silhouettes accourent, interrogent, soulèvent le vélo, sourcils froncés, regards méchants. Elle ne pense qu’à fuir cette tempête, qu’elle soit la plus courte possible, pour avoir la force d’essuyer la deuxième à la maison…
Elle revient du marché, les bras appesantis par les sacs chargés de fruits et légumes. Devant sa voiture, un postier l’air consterné. « Vous plaisantez ? Sur la voiture ? » Il avait stationné son vélo devant la porte de cette maison trois mètres plus loin, le vent avait soufflé, mini-tourbillon, emporté l’engin sur la pente douce, fait glissé sur la carrosserie l’armature métallique qui supportait les sacoches. Oh, ce n’était rien. Non, rien, bien sûr, sauf que.
Il est avachi dans le fauteuil roulant. Le menton sur la poitrine, les lunettes légèrement de travers et les mains pieusement croisées sur les genoux. Il s’est assoupi à force d’attendre. On ne peut pas toujours être en alerte quand on attend. Je l’avais déjà remarqué ce monsieur en costume gris. A cause du fauteuil. A cause de sa façon de dire en se ratatinant qu’il ne veut pas gêner, qu’il n’existe pas, que ne faites pas attention il va bientôt partir. Un jour nos regards se sont croisés. La même interrogation. Celle qui est dans les yeux de tous les patients en hématologie. C’est grave ? Je lui avais souri. Il avait détourné le regard comme si un sourire, ici était mal venu. Aujourd’hui il dort. Je le trouve amaigri. Il bouge un peu et ouvre les yeux. Des yeux gris dont le regard se perd facilement dans l’espace qui nous sépare. Je lui souris. Je ne sais pas ne pas sourire. Il hoche la tête et quand l’ambulancier vient le chercher, il se tourne vers moi et chuchote presque « adieu Madame »
Quand elle est entrée dans la salle d’attente on ne pouvait pas ne pas remarquer. Des seins qui débordaient la robe à grosses fleurs bariolées. Des seins qui disaient qu’ils étaient vivants et qu’ils tenaient à le rester. Devant nos regards convergents – la salle d’attente était pleine – elle avait jeté un châle léger sur les épaules qui devait recouvrir en partie ces seins vindicatifs. Elle s’était installée sur la dernière chaise disponible et cherchait des yeux avec qui elle pourrait engager la conversation. Le silence lui pesait. Le silence et l’attente. Parler de l’attente, voilà un sujet qui fait l’unanimité. Il y avait dans les bouches de l’inadmissible. Elle s’animait. Le châle aussi. Les seins étaient au balcon et suivaient la conversation. Et nous, nous suivions les seins du regard. Je trouvais admirable cette façon de s’exposer. Les seins libres, le crâne glabre sous un foulard fuchsia. Une infirmière est venue la chercher. Elle s’était trompée de salle d’attente.
Il est beau. Il est avec sa femme. Il a l’air amoureux. Lequel des deux est malade ? Rien ne paraît. Ils discutent, complices. Il est bronzé. Détendu. Comme celui qui revient de vacances. Il rit facilement quand elle s’adresse à lui. Ses dents sont un peu trop bien alignées pour être d’origine. Ses lunettes sont élégantes. Il est élégant. Il me plait bien. Je dois le regarder avec une certaine insistance. Il s’en aperçoit et imperceptiblement se tourne davantage dans ma direction. Il continue à plaisanter avec sa compagne tout en vérifiant régulièrement que je suis bien là, que je le regarde encore et encore. Voilà un égo à qui je fais du bien. Et dans une salle d’attente où les patients ont des pathologies plutôt lourdes, faire du bien, c’est pas mal ! Je suis appelée. Je passe devant lui. Nos regards se croisent. Ils se donnent. Je prends de l’énergie pour ce qui va suivre. Une belle et bonne énergie toute en chaleur. C’est comme ça que la vie peut être la plus forte.
Plus je la vois faire des allers et retours de son siège à l’entre-deux wagons, plus elle m’inquiète. Avec le bébé porté devant en écharpe qui pleure sans cesse et la petite fille — environ deux ans — accrochée à ses jambes qui réclame un câlin mais en hurlant comme dans l’Exorciste, elle est en panique. Grande, vêtue d’une salopette qu’elle a dû acheter au cours de sa grossesse et qu’elle porte toujours pour cacher son ventre resté énorme, elle n’est pas maquillée — pas eu le temps — et encore moins coiffée— elle a carrément oublié. Ses joues sont très rouges et son regard suppliant. Elle est si démunie face aux cris de ses enfants qu’elle prie intérieurement, mais ça se voit, pour qu’ils s’arrêtent par miracle. Au moins l’un des deux, pour savoir par quel bout commencer. Dans la voiture du TGV, se font entendre des remarques à son encontre, comme toujours dans ces cas-là. Mais elle ne le sais pas et croit qu’elle est la seule à qui survient ce genre de problème. Elle croit qu’elle est une mère nulle, la seule mère nulle, la seule au milieu de mères qui savent. Sous la pression, elle va craquer, elle faire une bêtise. En fait elle en veut à ses enfants de lui faire violence dans sa tête après la violence dans son corps. Etant donnée sa taille, elle a dû prendre 25 kilos, en pensant au début que ce n’était pas grave, qu’elle les perdrait, mais on ne les perd jamais tous. C’est toujours marrant d’entendre vanter les mérites de tel acteur qui a pris 20 kilos pour un rôle, oh De Niro, pour Raging Bull, quel exploit, alors que les femmes le font plusieurs fois dans leur vie sans que personne ne se pâme d’admiration. Récemment, j’ai rencontré une femme qui a avait eu neuf enfants. Comme la situation ne s’arrange pas, la seule solution qu’elle trouve est de s’en prendre à la petite, jamais contente celle-là, toujours à réclamer, insupportable, vilaine, l’âpreté des relations mère-fille s’instaure dans l’urgence mais pour longtemps.
Ce n’est pas le logiciel de la SNCF qui nous a installées face à face, elle n’a pas de billet. Et me le confie volontiers dès le début de notre conversation. Elle ne s’en vante pas mais ne s’en inquiète pas non plus. Opulente, la peau toute lisse ronde et tendue, arborant des lèvres badigeonnées de rouge très rouge, elle a l’air « bien dans sa peau » comme on dit. Elle porte un haut en dentelle noire, très sexy, tandis qu’en bas elle est toute moulée dans un jean stretch. Son attitude me rappelle celle d’un garçon rencontré il y a quelques années, gros chauve et macho avec l’assurance d’être irrésistible, au moins autant qu’Alain Delon. Je le détestais jusqu’au jour où un ami commun m’a montré une photo de lui jeune. On comprend beaucoup de choses lorsque l’on voit des photos des gens à 18 ans. La femme d’en face se comporte comme lui, comme des personnes autrefois magnifiques qui font comme si le monde était encore à leur pied. D’ailleurs, elle me raconte tout naturellement que dès la fin de son adolescence elle a été mannequin. Quand arrive le contrôleur, l’opération de charme prend une tournure épique. Elle lui explique qu’elle n’a pas pu prendre de billet car elle ne parvenait pas à lire les instructions de la machine, faute d’avoir reçu des lunettes qu’elle avait pourtant commandées chez l’opticien, après des mois dans l’attente d’un rendez-vous chez son ophtalmo… Hilare, je renchéris, oui, oui, c’est illisible sur ces écrans ! Mais à ce stade de fascination, aucune importance, le contrôleur est tombé dans son piège et lui sait gré ne serait-ce que de bien vouloir échanger quelques mots avec lui. Reine de beauté, elle l’a été un jour et ça lui suffit pour en conserver le pouvoir.
Elle me sourit quand elle me voit m’installer dans le carré famille à côté du sien, bien qu’elle soit en pleine conversation téléphonique. Benoît, il a manqué de … Elle a l’air sympa. Une quarantaine d’année, de look classique mais dans le détail pas tant que ça, avec à ses pieds une petite valise pleine à craquer du type de celle qu’on prend pour partir juste un week end et c’est le cas, un vendredi soir de pont. Le train est bondé mais toutes les deux, on a été malignes, on a trouvé ces places libres où prendre ses aises dans le dernier wagon. C’est sans doute pour cette raison qu’elle m’a souri : soeurs de ruse. A moins qu’elle n’ait perçu en moi autre chose. Faut vraiment en parler à Jean-Christophe, non mais faut lui dire… Elle est à fond dans sa conversation. Même en sachant que je suis là, que je l’entend, pire, que je l’écoute puisque je la regarde, elle poursuit sans baisser de ton tant sa discussion avec son interlocuteur est cruciale. Et puis arrivent ces mots qui me font clairement comprendre de quoi elle parle et qui m’intéresse au plus haut point…. En cas de triangulaire, moi je te le dis, on s’en fout, on se maintient. Brune, les cheveux au carré, pas très jolie mais pas laide non plus, en réalité très attirante par son charisme, elle ne m’est pas inconnue mais c’est peut-être parce qu’elle me sourit tout le temps que j’ai cette impression. Dès qu’elle raccrochera, je lui parlerai, il faut que je lui parle, je prépare déjà ce quelle vais lui dire pour l’aborder. Mais toujours plongée dans sa conversation… Oh excuse moi j’ai un double appel, je te reprends après, à tout de suite… Oui comment s’est passé cette réunion alors ? Bien, bien ! Elle repart de plus belle répondant à un autre interlocuteur avec une faconde extraordinaire et une capacité d’adaptation inouïe. Elle est à la fois douce et déterminée, on doit lui obéir avec plaisir. Puis, alors que le train traverse une zone où d’habitude il fonce, toujours pendue au téléphone elle rassemble vite ses affaires et, tel l’un de ces héros de western qui fait stopper le train au milieu de nulle part parce que c’est là qu’il veut aller, elle descend et disparait dans la campagne.
Il entre à petits pas tellement courbé que l’on ne voit que le sommet de son crâne dégarni. Chaque mouvement l’essouffle et sa canne lui sert d’ange gardien. Il lève les yeux vers les personnes déjà assises, adressant un sourire édenté à la cantonade. Il avise une chaise dans le coin de la pièce, s’assoit lourdement en laissant tomber son portefeuille. Il se penche en avant déployant un bras décharné noueux comme un tronc centenaire, tendant sa main ridée et tremblante vers le sol. Mais le portefeuille à glissé sous le siège du voisin qui l’ignore, les oreilles cachées derrière un énorme casque audio qui lui mange la moitié du crâne. Le vieil homme se redresse, à bout de souffle, les lèvres cyanosées et se tient la poitrine en fermant les yeux. La plongée en apnée, ce n’est plus de son âge, pense-t-il, la terre est trop basse pour ses vieux os. Il s’accorde quelques secondes de répit, attendant que son cœur se calme et que ce vertige cesse pour faire une seconde tentative.
Elle affiche un visage conquérant empreint de l’insouciance de sa jeunesse, un regard aux reflets de bronze dont elle balaye la pièce à chaque nouvelle entrée, avant de se replonger dans son roman en anglais. Elle ne se laisse vraiment distraire que par les notifications qui illuminent sans arrêt son écran de smartphone. Une frange de cheveux châtains lui barre le front, ondulant avec les oscillations de son crâne, synchronisée au tempo du morceau de Dylan qui sort de ses écouteurs et dont tous les voisins profitent généreusement. Elle fait mine de ne pas remarquer l’arrivée du vieil homme mais un léger tremblement apparaît sur ses lèvres lorsqu’il fait tomber son portefeuille. Sans lever la tête, elle jette un coup d’œil sur cette main tremblante, fait la moue, puis se lève brusquement, ramasse l’objet et le tend au vieil homme. Sans un mot, elle se rassoit en balayant les visages des adultes présents d’un regard outré qui leur fait monter le rouge aux joues. Elle hausse les épaules et se remet à lire.
La secrétaire entre dans la pièce, s’approche du porte-revues pour disposer les derniers numéros de Paris-match qu’elle vient de recevoir, puis énonce le nom du patient suivant. Une petite femme se lève pour la suivre, le front en sueurs, soudain prise d’une quinte de toux caverneuse. Elle se précipite dans le couloir, en bougonnant "c’est pas trop tôt !" entre ses dents. La secrétaire qui en a vu d’autres, ne perd pas son sang froid et répond : "le docteur avait été appelé pour une urgence à la clinique, il a terminé et va donc pouvoir s’occuper de vous." Elle adresse un sourire à la cantonade, remonte ses lunettes sur le nez, redresse son chignon banane et sort derrière la patiente. Elle se dit que dans trois heures, à son cours de salsa, elle pourra oublier à quel point les patients sont de moins en moins patients.
ANVERS. Un chien dans un sac. Une fille tatouée, t-shirt rouge et short en jean. Cheveux orange coupés au sécateur. La fille, comme dessinée par Robert Crumb. PLACE DE CLICHY. des pickpockets peuvent être présents à bord. Un enfant rit. La rame se vide. La fille en short reste debout. ROME. Le chien, la fille aux larges hanches sont descendus. VILLIERS. Je sors à MONCEAU.
Un long manteau noir en laine sur un chemisier blanc boutonné jusqu’en haut, les cheveux châtains — banane sur le devant, chignon derrière, un bandana rouge noué sur la tête —, jean bleu foncé, ourlets roulés à la cheville sur des Doc Marteens noires 3 œillets, socquettes blanches (maille jersey avec dentelle broderie anglaise), la jeune fille se tient à la barre centrale du bus — ligne 64, direction Place d’Italie. Elle lit un livre d’Hervé Guibert sorti récemment, dont on a parlé chez Pivot l’autre soir.
Il traverse le wagon, coup d’œil à gauche, coup d’œil à droite, comme on passe en revue la troupe ; fin de journée, en bout de ligne, après la bataille, on compte les forces encore vaillantes, vêtements froissés, sacs lourds au pied, hommes et femmes pareils, la mine grise défaite. Et puis, face à lui, un seul encore debout, jean, t-shirt arborant une bouche tirant une langue épaisse. Casque sur les oreilles, sourire aux lèvres, son corps tout entier oscille, sans qu’on sache si c’est au rythme du métro ou de la musique. Campé sur ses jambes, adossé à la barre centrale, il rayonne.
C’est un homme connu, enfin un homme qu’on reconnait parce qu’on a vu sa tête à la télé, si on a la télé. D’habitude, il sourit. Il est droit. son charisme détend les invités et scotche les téléspectateurs. Là, à Roissy, sur une banquette de _Ladurée_, devant un café noir sans sucre ni macaron, sans veste ni cravate, il est piteux. Le buste vers l’avant, les mains entre les cuisses face à sa femme et ses deux enfants, il tremble presque. Elle va partir. Il le sait. Nos regards se croisent. Il baisse les yeux.
Les deux rames sont arrêtées. Depuis l’autre métro, un vieil homme me regarde. J’ai levé les yeux de mon livre. Il les a captés. C’est un homme du désert dont les yeux ont l’immensité et le calme. Il porte une tenue traditionnelle venue avec lui de là-bas. Nous nous regardons. Nous nous aimons immédiatement. Nos yeux se plissent d’un sourire. Les métros démarrent et nous entraînent à l’opposé l’un de l’autre.
Arrêtée sur le trottoir, la main dans celle de sa mère, la petite fille regarde l’homme à côté d’elle. Son visage est tatoué autour d’un X dont les branches se croisent entre les yeux, à la naissance du nez barrée d’un piercing, barre de métal horizontale. D’autres tatouages parcourent le visage, le cou, le crâne, des étoiles, beaucoup. Tous trois attendent que les voitures s’arrêtent pour traverser. L’homme regarde la gamine et lui sourit. Son sourire montre des dents métalliques. La petite fille sourit aussi, d’un sourire d’émerveillement. Le feu passe au vert pour les piétons. Ils s’engagent tous les trois sur la chaussée. La petite demande à sa mère pourquoi le monsieur s’est dessiné sur le visage, si c’est son vrai visage. La mère ressert la main qui tient celle de la fillette, accélère et tire la gamine qui peine à suivre, bras tendu épaule levée, petits pas de course. Ainsi tractée, emportée par la crainte de sa mère,la petite se retourne, sourit, fait un vague signe de la main.
Je suis dans l’autobus 21 à Marseille. Quelques stations plus tard, une jeune dame et sa petite fille montent et se posent à côté de moi. Elles brillent comme des soleils avec leur chaude couleur café au lait. Elles ont les même cheveux blonds ondulés, naturels pour la gamine, œuvre de la coiffeuse pour la maman. Elles sont toutes les deux très soignées avec ce qu’on appelle des accessoires flashee : pochette en perles brillantes et colorées, bracelet de cheville, nœuds et barettes irrisées dans les cheveux. La maman a un gros percing en plastique transparent dans les narines. Toutes les deux très belles, lumineuses. Elle a les yeux rivés sur son Iphone. Elle, très droite, très sage, se raconte des histoires, tout doucement, que pour elle. Sur un signe de la maman, elles descendent à l’arrêt suivant . Il reste dans l’autobus un sillage lumineux comme celui d’une comète.
Ça se passe dans le bus 21 à Marseille, vers neuf heure, ce dimanche. Il n’y a pas foule, on apprécie le bien-être d’un jour férié dans les transports marseillais. Je vais au concert en ville. A l’arrêt suivant, un homme vient s’asseoir à côté de moi sur la double banquette. Je ne l’ai pas vu arriver. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Nous sommes proches et je ne vois de lui qu’un bout de jambe de pantalon, celle qui recouvre le genou droit, en toile grise un peu épaisse. Très vite, cette jambe droite vient vers ma jambe gauche et la contraint de se resserrer vers ma jambe droite et la paroi de l’autobus. Je me manifeste en relevant mon corps, en le tendant. Il resserre ses jambes, une fois, deux fois, trois fois. Puis, il ne prend plus la peine de se contraindre. Je visualise mentalement notre configuration et je pense à une émission de télévision que j’ai vu récemment où une jeune femme évoquait cette façon de faire de certains hommes dans les lieux publics se posant jambes écartées, sans même y penser. Il descend comme moi au terminus de la ligne. Je le vois enfin, de dos. Agé d’une trentaine d’années, il est fort et grand. Il porte un jean étroit descendu sur les fesses, tirebouchonné sur les jambes qui tombe sur des tennis à la mode . Un gros cou et des cheveux rasés.
Dans l’autobus 21 à Marseille, la semaine dernière. Soudain, un cri fuse. Personne ne bronche mais on a tous l’oreille et l’oeil aux aguets. Sans se manifester, on cherche tous la cause de ce dérèglement perturbateur. Rien ne se passe, alors on se relâche . Un autre cri, bref, répété celui-là, hachure le silence. Ça y est, je l’ai repéré. Il fait des mouvements saccadés, incontrôlés. C’est un jeune homme bien habillé, élégant même, à la mode actuelle. L’incident se répète. Je pense impulsivement à la dame assise à côté de lui, à son embarras, à lui, obligé de se mettre tellement en évidence pour sortir du terrible isolement de la maladie. Le lendemain, sur la même ligne, le même jeune homme. Il est assis tout seul sur deux places de l’autre côté de l’allée. Un cri aigu, des jambes qui se désarticulent. Un soixantenaire coiffé d’un bonnet djeun s’assoie à près de lui en essayant de le rassurer. ça paraît le stresser de l’avoir ce monsieur à côté de lui. Il doit avoir besoin de toute la place. Il descend au rond-point. Du bus, on entend encore un cri. Le bus démarre. J’ai les larmes aux yeux de sa souffrance que j’imagine. Il est si beau. Il dit « pardon », il dit « excusez-moi ».
Je repasse sur la place que j’ai traversée tout à l’heure Des bancs, des arbres, autour de l’Eglise, en face de l’hôpital Saint André. La même bande de garçons et filles avec leurs deux ou trois chiens, est agglutinée autour du même banc, occupés seulement d’eux-mêmes , un peu plus saouls ou défoncés qu’il y a deux heures. Une fille au teint pâle, cheveux noirs et bouclés, yeux délavés, joues avachies, paupières rougies, dos voûté, jambes pendantes, toute vêtue de noir, m’interpelle de la moto où elle est assise : vous auriez pas une feuille de papier à rouler, Madame ? Je la dépasse en répondant que je ne fume plus depuis longtemps. Je ne suis pas mécontente d’avoir été ainsi hélée. Faut croire que j’ai encore une tête à fumer des pétards.
Sur les banquettes rouges, dans le hall de gare, sous la carte murale, en tête à tête avec son sac posé à ses côtés, un SDF grommelle. Il ne regarde personne. Une fille blonde, assise par terre, plongée dans son smartphone et son compagnon un jeune black fin, aux dreadlocks courtes lèvent quelquefois la tête vers lui. L’homme se lève, son pantalon descend sur ses hanches, on voit la raie de ses fesses. Il traîne les pieds, l’un après l’autre, jusqu’à la poubelle proche, ouvre son sac, en nettoie l’intérieur. Puis il s’en va, frottant toujours le sol de ses semelles. Où va t-il ? Pourquoi s’est –il levé ? il se met en marche comme le font les animaux, comme tous les êtres vivants, parce que la vie est mouvement et que le contraire est la mort.
Tout le bus profite de sa prise de bec avec Marc. Marc, écoute moi ! Ecoute moi, je te dis Marc ! Marc ! S’il te plaît ! Sa voisine se lève pour changer de place drainant sur son passage l’approbation silencieuse des voyageurs. Une dame murmure gentiment qu’il s’agit d’ une handicapée. Celle-ci change de place aussi, pour s’asseoir derrière le chauffeur et poursuit sa conversation bruyante avec Marc. Enfin elle se lève, emprunte le couloir central du bus, pour gagner la porte de sortie, toujours suspendue à son téléphone. Son petit corps trapu, solide avance avec une puissante détermination, comme un taureau dans l’arène.
Été. Métro, le son, les sons, pas le bruit, le bruissement, le crépitement, le rythme, caisse claire et sombres accords, il ferme les yeux. Les pages du bouquin se referment sur l’index pointé, le clapotis des vagues qui enserrent son île s’éloigne... Il marche lentement à contre-courant, à contre-rythme, les images défilent, se précipitent, les corps en mouvement le bousculent, se frottent, s’éloignent, se rapprochent, s’étirent et se heurtent, se cognent dans un kaléidoscope d’images blessées. Tout se joue sous la surface en un ballet incessant, comme un flux de globules sous la peau, artère sous terre, monde atomisé, globules mouvants violents et flasques, masse multicolore d’êtres de textiles et de cuirs, de visages tendus vers on ne sait quelle obstination, de têtes penchées comme en prière ou en méditation sur quelqu’ écran lumineux, écouteurs aux oreilles, ne plus exister, s’extraire du monde pour mieux se perdre ou se retrouver, se dissoudre dans la masse, se fragmenter dans la multitude connectée... La nasse se resserre, la multitude s’agite, le navire accoste en longue plainte, les portes s’ouvrent. Il entre dans le compartiment bousculé de toutes parts par les têtes baissées trop pressées qui se casent dans les moindres recoins du wagon désormais surchargé. Il semble ne pas y prêter attention. Les portes se referment dans un hurlement de sirènes. Les derniers corps se violentent et se promiscuitent. Pas le temps pour le suivant. Faut pas rater le départ. Lui se tourne légèrement, le corps à présent face à la porte. Il a le visage serein et curieux de celui qui voyage en terre inconnue. Sa taille le distingue des autres voyageurs qui semblent ne l’avoir pas même remarqué. Candide au pays des troglodytes. Est-ce qu’il sourit ? Il a le regard à la fois présent et lointain. On dirait que ses pieds ne touchent pas le sol tremblant de la voiture qui circule à toute vitesse jusqu’à la prochaine station._ « Châtelet-Les-Halles ?... Châtelet-Les-Halles ! » _ Les freins crissent un contre-ut épouvantable. La bousculade est à son comble à l’ouverture des portes. Les corps désenclavés libèrent les odeurs âcres des transpirations angoissées, des vêtements fermentés, des parfums trop volontaires et féroces achetés à bas prix. Il ne descend pas ici. Peu de monde en retour pour la prochaine station. Quelques sièges libérés s’offrent à qui veut les utiliser. Lui reste debout presque immobile et caresse d’un regard l’ensemble du wagon à moitié-vide-moitié-plein, le train démarre. Je remarque à présent sa longue silhouette. Il me fait penser à ce bel acteur Pierre Clémenti : même regard présent-absent , mêmes bouche bien dessinée aux lèvres généreuses, même mystère dans l’élégance, corps fin et longues mains aux attaches à peine noueuses. Un frisson me parcourt le dos. D’où vient-il ? D’où sort-il ? De quelle planète, de quel pays ? Son costume de lin souple, écru léger, sur une chemise à demi-ouverte de lin blanc dénote un certain goût pour le raffinement discret. Ses pieds nus dans de fines sandales de cuir fauve se terminent par de longs orteils magnifiquement alignés. Il n’a pas la valisette du dandy en villégiature ou le bagage du voyageur en transit, pas l’attache-case du travailleur de bureau, pas le sac à provision chargé des victuailles du parisien de fin de semaine de retour chez lui... Rien... _ « Prochaine station ?... »_ Contre-ut en sirène_ « prochaine station ! Attention à la marche en descendant du train »_ Je dois descendre, les portes s’ouvrent, je reprends mon livre, s’il descend, je le suis, je me penche pour agripper ma sacoche, je me relève, personne, je jette un œil dans le wagon, je sors, personne, à gauche, à droite personne, où est-il ? Était-ce un songe ? Je hurle. Aucun son ne sort de ma bouche grande-ouverte. J’ouvre les yeux, personne. Le cœur me bat. Autour de moi le silence du crépuscule. J’ouvre le livre à l’endroit de mon index. Un frisson d’eau sur les galets...
Automne. Métro, ligne, stations, Etoile, rails, suicides, rats, pubs, pisses, pauvres, pue, stations, lignes, radio, cris, les noms, les voix, la voie, les voix, les beaux, les laids, les rails, les rails et la lumière, le bruit, les tremblements et la peur, la ligne et les lignes, les courbes et la peur, les lumières et le feu, le sang, les corps, la foule, sa fille, les gens, les cris et la voix, les voix, la lumière, les rails. Il ne voit pas, ne la voit pas, n’y arrive pas, il dit qu’il n’y arrivera pas.
Hiver. Elle descend une à une les marches du grand escalier. Elle traîne péniblement deux gros sacs d’un autre âge qu’elle dépose tour à tour sur chaque marche franchie pour reprendre son souffle. Elle s’agrippe comme elle peut aux carreaux blancs du mur du métro, elle s’y adosse parfois, puis recommence marche après marche. Sur ses épaules un vieux sac à dos noir aux sangles élimées semble contenir des papiers, des dossiers ? Une autre sangle plus fine la traverse en diagonale, retenant une succession de chemises, de pulls, de gilets, de vestes et de manteaux, jusqu’à un petit sac en simili-cuir, unique indice d’une féminité à laquelle il faut s’accrocher. Elle fait une pause sur ce premier palier. Il y en a trois. Il faut les atteindre. En bas il fait chaud. Escalier interminable, plus grand qu’au Casino de Paris, moins majestueux, tout se perd. Elle souffle, elle pense et lève la tête encapuchonnée. Mes jambes. Ses jambes sont emmaillotées, emmitouflées dans une succession de chaussettes, de bandelettes, de bandages de chiffons. Ses pieds s’enfoncent dans ce qui devaient être des charentaises dépareillées trop grandes, retenues par des ficelles qui s’entrecroisent harmonieusement. Comment peut-elle encore marcher ? Devant elle la vie semble se dérouler en accéléré. Tout résonne sous cette voûte monumentale des millions de pas qui vont et viennent, montent et descendent à toute allure. Elle sait les reconnaître. Pas du riche, pas du pauvre, pas des travailleurs du chantier, pas des secrétaires de bureau, pas nonchalant, pas pressé, pas qui claque et pas feutré, lui revient tout à coup la chanson de Pierre Louki. Mais pas de répit, pas de retard, pas d’attache, d’attachement, pas de regard, pas d’œil, pas d’yeux. Elle les regarde passer, pas pressée, c’est du divertissement, ça vaut bien Tex Avery. Le dos se soulage au mur suintant qui la retient, mais à aucun prix elle ne quitterait ses deux gros sacs, elle semble y tenir plus qu’à sa vie. C’est tout ce qui lui reste. Elle les regarde tour à tour comme si elle leur parlait, puis se décide à reprendre sa descente vers l’Hadès jusqu’au prochain palier. Une marche, puis une autre. Un jeune garçon la bouscule sans la voir en dévalant l’escalier. Elle tient bon. C’est son gros sac en fait qu’il a heurté. Elle a tenu bon, elle n’a pas lâché les anses de son improbable paquetage, que ses doigts noueux serrent depuis le matin même, comme s’il s’agissait d’un trésor à chérir. Encore une marche, puis une autre. Elle voudrait avoir déjà atteint le deuxième palier. Si seulement j’avais des ailes. Elle rêve de se laisser porter par le vent. Elle regarde en bas et n’en voit pas le sol. Tous ces corps multicolores qui s’agitent dans tous les sens, se dépassent, se frôlent et se disputent la priorité. On parle de marée humaine, ça la fait sourire, elle ne sait pas nager, elle ne sait plus rire, elle voudrait en finir. Je vais porter tout le poids de mon corps et de mes souvenirs vers l’avant, la pesanteur fera le reste. Avec un peu de chance elle arrivera en bas avant tout le monde. Ou bien de cet amas informe deux bras tout à coup surgiront, deux mains qui la tiendront par la taille pour la faire tournoyer encore une fois, une dernière fois, comme l’étoile qu’elle fut à l’Opéra Garnier. Ou encore cette marée humaine la portera en triomphe, elle et ses deux gros sacs, comme une rock-star à l’issue d’un ultime concert avant de l’écraser de tout son poids d’indifférence croyant avoir à faire à un tas d’immondice. Elle ne sourit plus. La tête lui tourne. Son corps chavire. Sa vie aussi. Puis, rien.
Gorge de Loup. Tout cela se passe à 20 km/h en 1 min 30. Je vous laisse faire le calcul de la distance parcourue. Je n’ai pas le temps. Mon moment préféré arrive. L’ouverture des portes à la prochaine station. Déjà l’annonce de son nom était pleine de promesses : “Gorge de Loup”. Je suis tendue par l’attente. Je pourrais fournir en électricité nerveuse un quartier entier de la ville. Le salut vient d’entrer par les portes coulissantes. À moins que ce ne soit juste avant la fermeture. Oui, ce pied qui s’interpose à la dernière minute. Cette botte noire qui fait se rouvrir les portes. Suivie d’une deuxième, le pas bien assuré, et qui se dirige vers le milieu de la rame, de part et d’autre du poteau en acier brillant qui maintient le voyageur en équilibre. Les bottes sont dirigées vers moi. Elles sont espacées de quelques centimètres de mes orteils nus dans mes sandales. C’est le début de l’été. Elles sont maculées de boue. Je profite d’une secousse pour avancer imperceptiblement la pointe de mon pied gauche. La botte ne réagit pas. Je ne relève la tête à aucun moment. J’imagine son regard posé sur moi. Je m’imagine en sentir le poids. Dans la vitre, il peut voir ma nuque. Et puis soudain je dégrise d’un coup. Je me sens stupide. Bien sûr qu’il ne me regarde pas, qu’il fixe l’horizon tagué de la galerie de métro, se regarde peut-être ou bien le reflet de Gabrielle d’Estrée. Mais sûrement pas la jeune fille de quatorze ans que je suis. Alors je relève brusquement la tête et mon regard se plante dans sa nuque, à lui. Il s’est retourné pour s’apprêter à sortir à la prochaine station. Je suis prise dans une déferlante de déception. Mais aussi la beauté de cette nuque me serre la gorge. Mon instinct ne m’avait pas trompée. Les bottes sont celles d’un très bel homme. Mais qui ne le serait pas sous les feux de mon désir adolescent ? Pantelante sur mon siège moite, je le laisse partir sans autre au-revoir que son regard croisé une seconde avant que les portes ne s’ouvrent sur d’autres visages qui effaceront le sien et le mien.
Grand Roule. Je parlais avec une amie dans le bus qui nous ramenait du lycée. C’était un vieux modèle sans amortisseurs, avant la rénovation du parc des bus par la TCL, dans les années 2000, et dans la côte abrupte qui va de la Mulatière à Sainte-Foy-lès-Lyon, nous nous agrippions comme des forcenées aux accoudoirs. Nous manquions de basculer en avant à chaque arrêt. Je disais en riant à mon amie que j’avais peur qu’un freinage intempestif la fasse valdinguer dans les bras du jeune homme qui était assis en face d’elle. Il avait des écouteurs sur les oreilles et la peau abîmée par l’acné ou une autre maladie ingrate. Plus je l’observais moins j’arrivais à détacher mes yeux de son visage. Ils y restaient comme collés. Je perdais le fil de ma discussion avec mon amie. Je répondais presque machinalement à ses éclats de rire. J’étais pris au piège de ce visage en face de moi. Ses lèvres bougeaient imperceptiblement ; peut-être fredonnait-il les paroles des chansons que déversait son walkman dans ses oreilles ; mais un moment plus tard, je me rendis compte qu’il n’en avait pas. J’avais dû rêver. Il parlait tout seul. J’essayais de regarder ailleurs, de reprendre pied dans la situation plaisante d’inviter une amie chez moi après les cours, ou de me perdre négligemment dans le paysage de plus en plus verdoyant qui défilait derrière la vitre ; mais celle-ci me renvoyait aussi le reflet de l’intrigant voyageur. Je sentis soudain une sueur glacée au bas de mon dos. C’était l’été et nous portions avec mon amie des robes légères. Il faisait une chaleur de serre dans le bus non climatisé. À travers la vitre, l’inconnu me regardait avec une intensité foudroyante. Et les mouvements de sa bouche semblaient bien être une volonté de proférer quelque chose à mon intention. En vain je tentais de m’extraire de cette image, j’y revenais toujours ; plus aucun son ne parvenait à mon oreille, à part des vibrations très basses dont je n’arrivais pas à identifier la source. Elles se faisait de plus en plus fortes à mesure que l’inconnu me dévisageait. J’essayais sans résultat à me désengluer de ce regard. Mais la moindre tentative provoquait une douleur sourde dans ma poitrine. J’avais l’impression que me détacher de ce regard, de cette bouche, aurait été pour moi aussi douloureux que de m’arracher le cœur. Les vibrations continuaient, de plus en plus fortes, dans des tonalités différentes qui formèrent bientôt une mélodie lancinante et morbide. La bouche maintenant prenait des dimensions insoupçonnées. Elle s’ouvrait de plus en plus et je voyais par intermittences l’émail des dents qui jetait des éclairs. Lorsque je pris conscience que les infrasons que le percevais venaient de là, je sentis une vague d’horreur passer sur moi. J’avais oublié les yeux. Il n’y avait plus qu’une bouche béante et bourdonnante au milieu d’un visage crevassé. Un peu avant l’arrêt du “Grand Roule”, l’inconnu s’est levé brusquement, m’a giflée en me traitant de pute avant de sortir en trombe. Mon amie, stupéfaite, cru avoir rêvé la scène. Moi, j’avais gardé au fond de moi un morceau de sa folie.
Maison-Alfort Alfortville. Elle lisait un roman de Simon de Beauvoir, Une mort si douce. Elle ne le semblait pas, elle, si douce. Une femme forte. La quarantaine bien passée. Une détermination dans les muscles, la manière de ne pas se laisser aller par les mouvements du train, de mener la danse. Pourtant pas de rigidité. Peut-être le titre du roman jouait ce rôle d’atténuer la rigueur apparente de sa manière d’être, en face de moi, ce jour-là. Peut-être est-ce le reflet de l’écriture de Beauvoir sur son visage ou encore le nom même de Simone qui contribua à construire en quelques secondes dans ma tête ce personnage à la fois doux et fort, indépendante, libérée. Perdue dans mes rêveries littéraires, je n’avais pas vu que je m’étais fourvoyée. J’avais pris le RER dans le mauvais sens. Vers le Sud, d’où je venais. Je ne sais pourquoi je paniquai plus que de raison. Plus honnêtement je sais pourquoi, parce que j’étais alors une jeune femme inexpérimentée et soumise à des normes où se perdre dans les jungles suburbaines n’était pas acceptable. Panique donc, sous le regard mi-amusé mi-compatissant de Simone. J’ose lui demander de me guider. Elle prend son rôle sans complaisance feinte. Naturellement. Elle me propose de venir attendre le prochain train chez elle. Elle habite à deux pas. Accepté. Moi je ne trouve pas les mots. Elle ne se force pas Simone. Elle boit son thé avec simplicité. Je regarde à la dérobée son petit appartement de banlieue. Quelques cartes postales d’art. Matisse. Puis je repars, sourire au cœur.
Bord fenêtre, seule, dans le TGV encore à l’arrêt, écouteurs sur mes oreilles prenant tout l’espace et plus, Bashung, une femme s’assied côté couloir. A perte de vue des lacs gelés qu’un jour j’ai juré d’enjamber, J’me dis, une grand-mère, A perte de vue des défilés, des filles à lever, des défis à relever, je ne suis plus seule. Dérangée De mon chagrin. A perte de vue, dodelinent des grues, les pieds dans la boue, qui l’eut cru, qu’un jour nos amours déborderaient Elle sort son iPhone, des revues, un paquet de gâteaux pour enfants, des Prince. Fassent oublier aux ajusteurs la clé Elle feuillette, elle tapote sur le clavier, Plus de boulon pour réparer la brute épaisse, ma pute à cœur ouvert, Le train part. Trop de cuirasser, pas assez d’écrevisses pour une fricassée… Elle commence. Elle ouvre le paquet de gâteaux par le milieu, cela fait scritch. C’est parce que je me suis tournée vers le bruit que j’ai compris. Je n’avais jamais vu ce fonctionnement. Qui attise ma curiosité. Plutôt que m’énerver. J’éteins Bashung. Va-t-elle recommencer ? Je sors un livre. J’avais emmené un livre, au cas où ce serait possible, de lire C’est « Je suis né » de Georges Perec. Stupéfaite, je lis les premières lignes, je suis happée par la page : « Je suis né. * 7.IX.70. Je suis né le 7.3.36. Combien de dizaines, de centaines de fois ai-je écrit cette phrase ? Je n’en sais rien. » Je m’arrête parce qu’elle recommence. Il y a un scritch à l’ouverture, mais aussi à la fermeture de la languette. Un double scritch. (…) Je lis. « Je suis né. On peut par contre s’arrêter dès la date précisée. » Toutes les trois minutes, elle ouvre le ventre du paquet de gâteaux, en tire un, referme le paquet, mange le gâteau longuement en lisant ou tapotant, j’arrête de lire, de rêver, de penser, je ne suis pas même irritée ; cette dame, par son action tranquillement répétitive et infantile, me sort de moi, suspend ma douleur. [* Alain Bashung-Jean Fauque-Alain Bashung, A perte de vue, Barclay, 1994 * Georges Perec, Je suis né, Seuil, 1990, p. 9 à 14].
Tout allait à peu près bien. Le soleil était de plomb. C’était le début des chaleurs de l’été. Je rentrais me mettre à l’abri d’une après-midi d’exposition aux bruits de la ville, à la densité. Je suis passée par la gare. D’abord la passerelle sous le soleil, puis les escalators, puis la deuxième passerelle. J’ai décidé de passer par derrière, par les quais. J’ai entendu, par les hauts parleurs, une phrase que je n’ai d’abord pas comprise. Et je voyais la gare se vider. C’est là que j’ai compris : « Veuillez rester confinés dans le hall de la gare. Nous prions les voyageurs de rester confinés dans le hall de la gare », répété. Parallèlement, j’ai brièvement perçu dans mon champ de vision qu’un TGV était arrêté sur la voie 1. Je continuais à marcher, ralentie, je regardais en arrière tout en avançant, je m’interrogeais, le silence était tombé soudain comme le soleil juste avant la gare, opaque, plein. J’ai vu les pompiers se diriger vers la tête de la rame. Quelqu’un était sous le train. Sous le train à quai. Arrêté. Tout allait à peu près bien avant. A peu près. Vacillante mais ça devait tenir. C’est ce que je pensais. Avant. Avant de choisir de passer par la gare pour aller plus vite et éviter le soleil.
J’allais à la Caf. J’ai pris le bus NA Pictavienne. A la gare. Arrêt Grand-Cerf. Rendez-vous avec une assistante sociale. RSA. Au premier arrêt, une femme est montée, maigre, elle parlait. Elle portait un sac sur son ventre. J’ai pensé qu’elle était enceinte. De façon incertaine. Mon cerveau a tenté discrètement de décrypter la possibilité qu’elle porte dans son sac un enfant sur son ventre, qu’elle lui parle, et qu’elle soit enceinte, (son ventre était rond), pourtant son visage, d’un âge indéterminable, n’était pas si jeune. Quelque chose clochait. Elle parlait : « Mais tais- toi, je t’ai rien fait ! Mais arrête, (fort, adressé à l’assemblée du bus, mais sans regard), je t’ai rien fait, arrête, je t’ai rien fait ! ». Trouble. Peur. Sa peur. Mon cerveau tentait de rassembler les éléments, les séquençait : son âge, rendait une grossesse de moins en moins probable, il s’agissait peut-être plus d’un problème de nutrition. Sa maigreur. J’en ai déduit petit à petit, tentant de rassembler des morceaux épars d’elle, qu’elle était perdue, dans le temps, et dans l’espace. Elle est descendue aussi rapidement qu’elle était montée ; apparition, disparition ; et angoisse interne comme d’une augure.
La ruelle est déserte. Au bas d’ un pont, loin des circuits touristiques bondés de la ville, ce jeune homme noir se tient le corps légèrement penché, le bassin calé sur la pierre. A mon passage il tente quelques mots d’anglais un peu emmêlés mais n’a bien sûr pas besoin de parler car il tend une paume ouverte, et sur son visage un désespoir tatoué me hantera longtemps . Je suis là pour des photos de reflets colorés sur l’eau du canal. Il est encore tôt dans la matinée et la lumière est idéale, j’appuie sur le déclencheur à plusieurs reprises même si mon mental n’est plus en harmonie avec le geste. Déstabilisée et très mal à l’aise, je laisse quelques pièces dans sa main avec le sentiment de n’être pas à ma place.
Sa voix chaude légèrement rocailleuse s’exprime en français , mais avec un léger accent que l’on sait être italien , et elle emplit tout le wagon . Il parle avec application et use de mots recherchés sans fautes de grammaire. De Turin à Lyon, il parlera, parlera à sa jeune voisine de siège qui ne doit pas encore en être remise ! Tous les passagers sont témoins de ce soliloque où on apprend qu’il a vécu une vie assez dissolue en France, en Belgique et autres pays...Le son de la voix se détache de deux rangs derrière moi et me recouvre entièrement ; je tente de lire en me bouchant les oreilles pour échapper à ce flot indécent d’histoire personnelle jusqu’à ce qu’un autre passager excédé lance : mais vous n’avez pas soif pour que nous ayons enfin quelques instants de silence. Arrivée à Lyon, je me lève, me retourne, il me fait face : sa voix était plus belle que l’ombre de son visage.
Dans le train des visages somnolents et vides, quand le jeu des petites rides autour de ses yeux pétillants attirent mon regard. Elle use avec son amie d’un italien rapide où se greffent des expressions qui échappent totalement à ma compréhension. Assise en face de moi dans une diagonale subtile, son regard parfois effleure la surface de mon visage sans oser l’aborder. Tranquillement, dans un français parfait, elle entre dans ma conversation et , emmêlant nos deux langues nous nous racontons abordant avec naturel la vieillesse , notre généalogie, Venise et mille petits détails cachés dans le recoin de nos vies. Une heure trente de voyage avec un regard bienveillant posé sur moi et le désir partagé de faire plus ample connaissance. A Turin, nos chemins se séparent et l’intensité de son regard accompagne mes pas en quête du prochain train.
Le wagon était presque vide lorsque les deux jeunes montèrent à bord. À les voir essoufflés je compris qu’ils avaient grimpé dans le premier wagon sans tenir compte de la classe. De toute évidence ils étaient dans la mauvaise classe. Aussi fussé-je surpris de les voir s’installer tout au bout du wagon. Le contrôleur les ferait surement partir. À mesure que le train avançait, je les surveillais, attendant le moment de leur éviction.
Au comptoir il attendait sa commande. De l’autre côté, elle allait d’une station à une autre réunissant les éléments de sa commande. Seul son visage et ses mains étaient visibles. Elle était voilée et maquillée et elle lui a souri d’un sourire dont la signification aurait dû se perdre dans la clameur du rush de midi. Ces belles mains aux doigts longs et fins. Elle a posé son gobelet sur le plateau et lui a tendu le plateau. Le saisissant il lui a effleuré les doigts.
L’odeur était pestilentielle. Tout le monde attendait la prochaine station espérant que le coupable sorte et que l’air vicié du tunnel vînt remplacer cette puanteur. Elle était passé de narine en narine et de vêtements en vêtements. Désormais elle quittait chacun des corps entassés, s’étant imprégné en eux pour la journée, et flottait attendant que les portes s’ouvrissent et laissassent entrer de nouveaux hôtes.
Avant de m’asseoir à la place libre à côté d’un jeune homme en débardeur-bermuda, smartphone à la main, écouteurs dans les oreilles, j’ai entrevu son visage. Peau mate, teint parfait, longs cheveux noirs brillants, cils incroyablement fournis et recourbés. Tandis que je prends place, le nez fin et droit, les lèvres charnues me rappellent l’immense visage gravé dans la pierre de ce pharaon, si attirant que je suis restée à le contempler longtemps en rêvassant. La rame se remet en marche. Dans un tournant je suis projetée tout contre mon voisin. Ce bref contact avec un corps ferme, musclé et ses éclats brûlants de peau nue électrise ma propre chair. Je pousse un petit cri. Pas de réaction du jeune homme toujours branché. L’écoute en solitaire de sa musique l’a rendu sourd avant de le transformer en statue.
Je ne vois d’abord qu’un vaste chapeau de paille entouré d’un ruban bariolé qui attend à l’arrêt de bus. Je regarde ensuite monter une longue robe à volants tapissée de grosses fleurs aux couleurs criardes, encombrée d’un ample sac à main en bandoulière et de deux volumineux cabas en plastique semblables à ceux dans lesquels les vendeurs à la sauvette entassent leurs bric à brac. Malgré ces bagages elle avance dans l’allée, altière. Les nombreux bracelets de pacotille enserrant les poignets tintinnabulent à chaque pas. Elle vient s’asseoir en face de moi. Dépose ses sacs à mes pieds, relève la tête et me dévisage. Son regard charbonneux, ardent. Mon impuissance à détourner le mien. La couche épaisse de fond de teint craquelée incrustant les rides. Visage en parchemin. Les lèvres trop rouges se mettent à bouger. Ce sont les lèvres du destin, à cet instant j’en suis sûre.
Il est souvent assis sur le banc, bras ballants, station Battant. Ce n’est pas le tram qu’il attend, il ne monte jamais dedans. Il porte, quelque soit le temps, une grosse canadienne avec un col de fourrure. Il a le cheveu gras, la barbe hirsute. Quand il n’est pas prostré il rit tout seul, bruyamment, bouche ouverte, sa grande carcasse prise de soubresauts. Dans ces moments là, plus encore que d’habitude, ceux qui attendent le tram ont tendance à s’éloigner, à créer un espace vide entre eux et lui. Il aime bien aussi taper les passants d’une pièce, d’une cigarette. Ce matin, assis sur le banc, il fume, ou plutôt – j’entends distinctement les bruits de succion – il tète sa cigarette. Goulûment. Les yeux clos. En extase. Impressionnée je le regarde et soudain le bébé apparaît, se révèle littéralement dans ce visage d’homme à la dérive. Je monte dans le tram la vision térébrante encore imprimée sur ma rétine.
Le vieux couple, assis côte à côté, près de la porte du métro, lui, en blouson léger, gris clair, un peu désabusé, comme surpris par une suite de surprises désagréables, elle, tout de beige vêtue, elle porte des anneaux d’oreille en or sous son petit chapeau de paille aux bords rabattus) précise, informée, persistante et presque têtue dans son esprit de contraction. Il dit : « Tous les trois ans, en Guadeloupe, ils ont droit à quarante pour cent de vacances en plus (pause méditative) ils sont gâtés (il tousse un peu, et dans cette petite toux, pointe une forme d’agacement, un soupçon d’envie), ça s’appelle des congés bonifiés.
Elle réplique aussitôt, factuelle : « Bonifié, bonifié… Ils sont plus loin de la métropole donc c’est bonifié pour le temps du transport, pour pouvoir venir voir leur famille en métropole tous les trois ans. Ce n’est pas histoire d’être gâté ou de n’être pas gâté, c’est la convention qui le dit, si le privé avait demandé cela, ils auraient eu la même chose…
Lui, narquois : « Tiens, c’est ça… tu me fais rire…
Elle, haussant le ton, non que le métro fasse plus de bruit, l’on sort de la station en ligne droite, mais c’est qu’elle s’emporte : « Mais les fonctionnaires maintenant c’est pareil, il n’y a plus de privilège, c’est pareil, ils te foutent dehors pareil, content pas content, fonctionnaire, maintenant, tu parles, c’est un titre rien de plus, d’ailleurs regards aux PTT, ils n’ont plus de congés bonifiés, ils enlèvent de plus en plus, ils ratissent, parce qu’ils disent « on paie, donc… » sauf dans l’éducation nationale, il n’y a encore qu’eux qui donnent des congés bonifiés. »
Lui hausse les épaules, il semble capituler mais c’est qu’il change de sujet, il attaque d’un ton aussi las que le sujet précédent : « Tiens tu as vu, le chantier à côté de chez nous, c’est la RATP, ils ont vendu, ils sont en train de faire un immeuble, ils ont déménagé le dépôt à Châtillon ou à Massy.
Elle, soudain courroucée, le corrige promptement : « Mais non, pas du tout, tu te trompes, ils n’ont pas déménagé le dépôt, ils le gardent là où il est, simplement ils le mettent en sous-sol, ils ont bâti au-dessus à la place où il était un espace de logements sociaux pour leurs agents, tu n’as pas vu la brochure qu’ils ont distribué hier dans notre boîte aux lettres ? (Il secoue la tête d’un air de doute) C’est expliqué pourtant. (Il secoue la tête d’un air chagrin, elle s’enflamme encore plus). Mais si tu ne me crois pas tu n’auras qu’à la regarder, de retour à la maison, ils n’ont pas déménagé ce dépôt de bus puisque c’est terminus, c’est en bout de ligne, comment ils feraient sinon ? Non mais dis-moi comment ils feraient s’ils devaient envoyer les bus jusqu’à Châtillon-Montrouge ? »
Deux jeunes filles vêtues de petits tailleurs, avec des chemisiers fleuris et des sandales, elles se passent une petite boite pour se repoudrer le nez, assises côte à côte sur la banquette centrale. L’une dit, avec un petit soupir : « C’était bien cette petite fête, pour revoir tout le monde… j’étais ravie. » L’autre répond : « Oui, c’est toujours bien de reprendre contact, je veux dire de ne pas perdre contact avec les autres, de la promo. ». La première pose une question à propos d’une personne qu’elles ont croisée à cette occasion. La seconde répond, d’un air renseigné, en redressant une barrette qui tient une mèche de cheveux rebelle qu’elle entre dans son chignon en surveillant l’opération dans la vitre du wagon : « Alors oui, elle… Elle est partie au Pérou, mais au Pérou ça n’allait pas ; à Paris ça allait bien, elle était contente de partir faire de l’humanitaire, puis elle est partie là-bas, elle venait de là-bas, mais elle vit chez sa mamie maintenant, là-bas, elle a trouvé un boulot de prof à la faculté, elle dit que c’est du provisoire (l’autre commente et pose une question à propos d’un nommé Tiago) ou la question c’est ça c’est Tiago avec qui elle sortait, alors il lui manquait, puis finalement ils se sont retrouvés et ils se sont mariés (elle se tourne vers l’autre pour mieux se faire entendre, le métro passe par un tunnel bruyant) mais il y a toujours des problèmes pour des histoires de papier, lui il vit à Paris, alors elle aussi elle voudrait revenir à Paris, mais ça, ça n’est pas si facile, sans papier, sans travail ici, et je me demande si lui, tu vois, Tiago, ça ne l’arrange pas un peu qu’elle soit tout là-bas, elle s’accroche un peu, tu vois, elle a des crises d’angoisse, d’ailleurs, ce n’est pas nouveau, déjà quand ils étaient tous les deux, au début, à Paris, elle avait toujours peur qu’il la quitte, on la consolait à chaque fête (l’autre pose une question inaudible à laquelle elle répond) ne m’en parle pas, à chaque fois elle pleure au téléphone (puis elle secoue la tête, comme pour ne pas vouloir en ajouter, se montrer cruelle) mais ça va mieux maintenant (l’autre intervient, semble en douter, elle essuie ses lunettes embuée avec un petit carré de tissu synthétique qu’elle vient de sortir de son étui à lunettes avec un petit miroir où elle vérifie son rouge à lèvres tandis que l’autre poursuit, tout aussi intarissable) si, si, vraiment ça va mieux maintenant… » Elle ajoute, après un petit soupir : « Je suis contente pour elle. » Suite une pause, elles se taisent toutes les deux, les yeux dans le vide, jusqu’au moment où elles se tortillent, un peu gênées de n’avoir rien à se dire. La seconde, plus loquace, plus assurée, reprend : J’étais contente de voir Clothilde, Clothilde ça va mieux maintenant pour elle, mais elle nous a fait à tous très peur, il y a deux ans, elle avait été envoyée en mission humanitaire, elle avait choisi d’aller en Asie, à l’ESSEC, tu sais, tu as vraiment l’éventail complet des destinations, mais elle, mauvaise pioche, pas de chance, elle avait chopé la dengue, elle a été malade l’été… l’été avant que je sois en stage, elle était partie au Cambodge… ou au Laos ? Au Cambodge ou au Laos ? (L’autre pose une question) La dengue… ça se transmet par les moustiques, ce sont différentes espèces de moustiques, il y a une liste de moustiques qui transmettent la dengue. Elle avait été rapatriée. C’était grave parce que ça c’était mis dans son cerveau. (L’autre ouvre de grands yeux, demande si cela laisse des séquelles). Oui, ça laisse des séquelles, en tout cas, elle, elle en est encore marquée, elle a changé de vie. Pendant deux ans, elle ne s’en sortait pas, la dengue ne voulait pas guérir, on était tous très très angoissés pour elle. Bref, je ne sais plus, maintenant en tout cas, elle est complètement rétablie mais elle a fait une dépression, elle a dû être hospitalisée, depuis la dengue, elle a des fragilités, chaque année il y a des moments où elle est sous antidépresseurs, ce sont des moments particuliers de l’année, c’est épisodique, il faut encore faire attention, tu vois, c’est quand même encore un handicap pour elle, par rapport à, tu vois, une vie normale en quelque sorte, mais ça va mieux, ça va mieux pour elle, je suis contente.
C’est à l’aéroport, ils sont assis face au tunnel, au bout du train où la grande fenêtre permet de voir l’horizon s’éloigner, au bout des rails. Ils ont des vêtements de chantier, de gros godillots noirs pour lui, des tennis de toile pour elle, tâchés d’éclaboussures de la même peinture blanche, des sacs à dos, de ceux qu’on garde avec soi en cabine, sur les vols low cost. Il porte une vieille veste de daim roux, et elle une chemisette claire à damiers, presque effacés. Ses cheveux à elle sont très blonds, bouclés comme un enfant, il porte de longues dreadlocks, qui tombent d’un élastique, au sommet du crâne. Ils s’embrassent, se tiennent la main. Il a un bracelet de coquillages blancs, de petites porcelaines, sur une lanière de cuir tressée, et une grosse bague d’argent à l’annulaire. Ils parlent anglais, elle a un accent, lui un anglais très pur, à la fois précis et musical. Ils doivent tous les deux avoir une trentaine d’années, à peine, mais ils se tiennent comme deux enfants, qui découvrent le monde. Ils regardent par la fenêtre les champs de terre où une herbe maigre pousse à peine, comme février en juillet, puis les longues rangées d’immeubles gris, les logements sociaux des banlieues, et au fur et à mesure qu’on avance vers Copenhague, des rues en bonne et due forme. Il lui demande pourquoi elle n’a pas pris de douche aussitôt après le spectacle, puisqu’elle semble n’avoir qu’une idée en tête, foncer prendre une douche, il s’en étonne, elle s’en défend, tout le monde partait dîner, elle ne voulait pas faire attendre, elle n’a pas pris le temps la veille au soir. Il rit un peu, la provoquant, se vante de ne pas avoir pris de douche depuis… il cherche le jour, « Voyons, nous sommes mercredi, mardi, lundi, dimanche… samedi, la dernière douche que j’ai prise c’est samedi. » Ils parlent de Copenhague, des visites qu’ils feront, elle dit que « c’est une toute petite ville », mais pourtant, dans la façon dont ils se tiennent, tous les deux, c’est comme s’ils partaient à la conquête d’un nouveau monde, qui s’ouvre à eux. C’est alors que juste derrière eux, dans leur dos, un homme très brun, en bleu de travail taché d’huile, qui vient de s’asseoir sur les deux sièges mouillés où personne ne s’installait depuis quatre stations, se penche vers eux, et demande à l’homme d’où il vient. Il lui répond : « De Londres, c’est une très grande ville. » « Londres, Londres », soufflant, l’homme derrière eux, se penche de guingois pour leur parler d’une voix qui tremble de passion de la tour de Londres, qu’il aime « plus que tout », et quand l’autre lui demande pourquoi, il répond, et son accent devient très prononcé, grasseyant : « I love how they killed people there », la fille sursaute un peu, écarquille les yeux, et son compagnon reprend, à sa manière, à la fois précise et chantante, comme pour se faire une idée de ce qui vient d’être dit : « You like how they killed people there. » L’autre homme se lance dans un grand discours sur le roi Henri VIII qui tuait toutes ses femmes, et qui d’ailleurs était fou, c’est prouvé, puisqu’il faisait venir un homme en lui demandant une pomme, il le frappait quand il venait avec une pomme verte, en voulant une rouge, quand le même revenait avec une pomme rouge, il le frappait en demandant une verte, et quand l’homme revenait avec une pomme verte et une pomme rouge, il le frappait encore, disant qu’il voulait une seule pomme, pas deux. Alors l’homme lève les mains au ciel en disant qu’il aime Shakespeare. En parlant, l’homme agite ses mains comme deux marionnettes, il rebondit sur son siège comme sur le tape-cul d’une auto-tamponneuse. Non, il n’est jamais allé à Londres, mais ça n’a pas d’importance, il aime l’histoire, il voit le passé. L’autre homme a cessé de l’écouter, fixe le tunnel qui se déroule comme un gouffre, en secouant un peu la tête, comme pour apprécier ce qui vient de se dire, au cours de cette rencontre, il fixe l’espace plongé dans l’ombre qui défile sous ses yeux, et il se fait peu à peu son idée sur ce qui se passe, et la jeune femme se penche vers la fenêtre du quai, à sa gauche.
L’homme dans le train de banlieue : je l’ai vu arriver de loin dans l’allée, maigreur sèche, la peau sans rides tirée sur ses joues creuses rasées de près. Il porte un pantalon bleu qui flotte sur ses jambes, un blouson de toile propre, les yeux sont d’un bleu délavé, le regard en mouvement furetant le sol.
Il s’arrête à côté de mon siège, commence à parler d’une voix profonde, qu’on dit venir de l’intérieur, posée « 51 ans, sort de dialyse, a faim, ses indemnités de handicap sont suspendues, doit faire des démarches pour les rétablir, en attendant dort sur le trottoir avec son duvet » et puis il continue en disant que si nous avons la chance d’avoir une famille qui nous soutient ce n’est pas son cas, il est seul et espère que nous pourrons l’aider. Mon regard se porte au loin, au delà des fenêtres du train, en arrivant à proximité de la gare du nord, on voit le sacré cœur sur la colline. Je repense à la conversation avec Dalila qui me raconte la rentrée en maternelle de son petit fils. A sa question « alors tu es content d’aller à l’école, tu as trouvé un copain » le petit lui répond « oh non mémé, ils sont beaucoup trop ». L’homme a fini de parler, passe dans l’allée sans tendre la main, les voyageurs se figent dans le silence à son passage, le corps tendu comme une digue face aux assauts des mots prononcés, je ne fais aucun geste non plus pour chercher une pièce dans mon sac.
Il entre dans la rame du métro un journal plié à la main, le regard rivé sur la place libre, c’est si rare aux heures dites de pointe, il avait dû la scruter depuis le quai, il avance d’un pas tranquille que le corps raide tendu vers l’avant dément. Face à lui dans l’allée un autre voyageur se dirige, lui, au pas de course vers la même place. Le premier décide alors d’accélérer à son tour, plus près il pense sans doute être prioritaire. La lutte pour avoir une place, une existence sociale, au fond, se mène sur tous les fronts et demande un entrainement constant partout et en tout lieu ; en cet instant je pensais au jeu des chaises musicales.
Sa tenue est soignée, maquillée, coiffée, habits colorés, vaporeux comme si elle se rendait à une cérémonie. Elle ne passe pas inaperçu. Ce qui frappe c’est le décalage, son attitude en conversation au téléphone, elle parle très fort, le ton coléreux au débit de mitraillette, impossible d’attraper un seul mot et se faire une idée du sujet de l’apparente discorde, elle parle dans une langue étrangère mais rien n’est sûr, elle semble à cran prêtre à exploser dans tous les sens du terme. Elle se déploie se répand et occupe deux sièges. Des regards entre les passagers s’échangent, l’accord est tacite sans se dire un mot, il est préférable de faire profil bas. Certains changent de place, je ne bouge pas par gène ou crainte, je sors un livre de mon sac pour me donner une contenance, mais impossible de me concentrer. A l’arrêt suivant une jeune femme le regard centré sur son téléphone, dans son monde elle aussi, s’installe sur la banquette de l’autre côté de l’allée. Elle s’adresse soudain à la passagère d’une voix douce et calme, lui demande si elle veut bien parler plus bas, que ça la dérange. Ce fut comme si la première passagère n’attendait que cela, le déclencheur pour conclure une partition connue d’elle seule. Elle se lève d’un bon, le visage convulsé, criant quelque chose « personne, tu entends ? Personne ne me dit d’arrêter » la main levée avec l’intention évidente de frapper, d’autres passagers se sont précipités pour la retenir, j’ai senti sa robe me frôler, son parfum puissant m’envahir. C’était étrange, le corps de chacune d’elles était bien là dans cette rame et en même temps elles étaient ailleurs, là où le téléphone avait le pouvoir de les maintenir. J’ai souvent entendu dire « il est temps de couper le cordon » mais c’était à une autre époque.
Il déboule dans la rame, ce jeune. Il arpente la travée centrale. Dans une main une cigarette, dans l’autre un livre : « Contre le stress ». Il en déclame un passage. Il se dirige ensuite vers le fond et frappe de son livre le panneau publicitaire affiché là. Les rares sourires se sont enfuis. Au dessus, la ville défile.
Presse sur le quai. Un peu ronde, un peu blonde. Sans bagage, en survêtement vert et violet pastel, tu m’as demandé une cigarette. « Non ». Je t’ai regardé passer et je suis devenu un bourgeois.
Un père et son fils. Le petit, vêtements un peu trop grands, grosses baskets, cagoule de laine sur la broussaille des cheveux. Dents en avant. Il entortille un bout de ficelle et une paille en plastique. Il glousse des petits borborygmes de plaisir. Le père assis à côtés, tête appuyée contre la vitre froide, blouson de cuir rapé, jean troué, vieilles chaussures de chantier, barbe de trois jours, cheveux presque longs. Il a posé un petit sac à dos sur ses genoux.
il sent mauvais il ne prend plus de douche depuis longtemps les gens s’éloignent il descend alors du tram station hôtel de ville ferme les yeux imagine des plages immenses avec des rouleaux de vagues il n’est plus ni homme ni femme encore moins Diogène seulement un fauve errant dans la ville les murs s’écartent et les chambres à coucher deviennent immenses mais le monde à travers la fente de ses pupilles n’est plus que peau de chagrin alors doucement dans les plis de la ville à même le trottoir il rêve d’un lieu ou plutôt d’un homme et soudain le voit se lever dans les allées du marché il l’observe dans les moindres détails la silhouette se retourne plonge son regard dans ses yeux et voilà qu’une chaleur diffuse dans ses veines il devient le rêve ou plutôt le cauchemar de cette forme étrange levée entre deux étals de légumes reviendra peut-être faire la fin de marché quand les moires se seront estompées
assise sur son siège elle a des petits pots de ceux qu’on utilise pour les semis d’horticulture il en sort des feuilles vertes et dodues petits plants d’aromates elle descend à la prochaine station le marché n’est plus loin que va-t-elle donc faire ah rejoindre la camionnette qui vend ses plats du jour street food qu’ils disent maintenant mots venus de ces commerces de trottoir vieux comme le monde parcelles d’occupation de domaine public qu’ils disent aussi à la mairie quand ils passent vérifier le matin en début de marché et comme des plants levés de graines inconnues des morceaux de territoire se glissent là se superposent à même un temps devenu rhizomes aux noms égarés
–
jour de marché le tram est plein ils descendent une station plus loin pour être au plus près des étals est-ce elle que l’on voit ou le poisson soudain qui se dessine à travers le sac en pelure de pomme de terre coiffé de ses branches de céleri si belle nature morte Arcimboldo en promenade ils déambulent dans les travées elle soutient le vieil homme au regard fatigué il claudique et trébuche dans les allées et ses yeux rieurs scrutent les passants quêtant leurs regards observant la vie du marché oreilles ouvertes micros trottoirs sur congénères la vie boîte ne le savez-vous donc pas et entre deux repas qui festoient la vérité des soirs de solitude il n’a plus ni doute ni rêve désormais mais boiterie sans cesse qui martèle jusqu’à sa respiration même le soir quand il se lève pour aller uriner il claudique et le bruit résonne dans sa tête est-ce bien lui se dit-il et soudain derrière la porte l’inconnu s’avance pas feutré mais ferme il lui tend les bras un rire étrange a surgi alors du fond de sa gorge
Le T.E.R. de Briançon à Embrun comme chaque matin. Dans le couloir d’extrémité équipé de strapontins raides et étroits, un homme veut s’asseoir sur un siège qu’il ne peut baisser. Et pour cause : celui-ci est coincé par la fesse droite (énorme) d’une femme obèse. Il insiste. Elle soulève de mauvaise grâce son postérieur. Le siège abaissé, elle étale aussitôt cette dite fesse sur le bord gauche du siège convoité par l’homme. Il s’installe avec peine. Par chance il est mince et courtois. Nous échangeons un sourire complice.
À l’Argentière, monte une femme, la cinquantaine bien enveloppée qui s’installe auprès de l’homme. Le voici encadré par deux opulentes cariatides, on dirait qu’il a rétréci ! La nouvelle arrivée est drapée dans une longue tunique moulante d’où débordent, à demi cachés par un boa de plumes roses, des seins généreux. Roses sont ses sandales à lanières. Elle serre contre elle un sac en plastique aux anses roses qui lui va comme un gant ! Une pyramide de gâteaux croulant sous le sucre et la chantilly lui donne un air de fête ; je l’imagine se léchant les babines devant des choux à la crème dans une pâtisserie.
Et me revient à l’esprit cette jeune femme qui s’est installée en face de moi hier matin. Différente de ces deux-là bien en chair, elle est mince, d’allure sportive, l’air décidé. Elle sort de son sac à dos une serviette de bain et la déploie soigneusement sur son siège avant de s’asseoir. Un vague regard autour d’elle... Sa main droite s’approche de son nez, le caresse, ses doigts s’activent, curant l’intérieur de celui-ci, parfois descendant vers sa bouche, reprenant son travail de fouillement dans la délectation. Les yeux mi-clos, loin du monde et du bruit, enfermée dans un rêve de douceur. Un sourire, un rien mélancolique, éclaire son visage : elle doit descendre, un dernier frôlement à son museau, elle replie sa serviette et s’éloigne.
Elle cultive ses légumes dans des caisses installées sur le parking. Tomates, bettes à cardes, petits pois, salades, haricots, radis noir, oignon, tout serré mais bien en forme. Elle fait les plants en serre dans son jardin. Pas facile d’obtenir l’autorisation, mais c’est beaucoup plus joli, vous ne trouvez pas ? Elle aimerait bien avoir des poules mais les voisins sont réticents. C’est un mouvement mondial conclut-elle. Je les donne bien sûr, sinon j’en aurais beaucoup trop.
Les coquillages que l’on peut trouver dans le sable à marée basse ne sont autorisés au ramassage que les mois en R, vous savez ? Elle n’en mange pas car elle sait qu’ils filtrent toutes les saletés. Elle est contente de la couleur de ses poubelles de tri ; j’aime bien ce vert me dit-elle. Les poules, elle n’en a plus, la commune l’interdit mais elle a le projet d’en élever chez une amie plus loin du rivage dans une autre commune.
Sur son balcon elle a installé deux grands sacs plein de terreau pour faire pousser du persil, de la coriandre et du basilic, des fraises aussi. La coriandre est montée à graine dès les premières chaleurs. Le problème c’est d’empêcher les écureuils d’ accéder à ses trésors. Il y a plein de solutions sur internet mais aucune ne marche et certaines sont très répugnantes à mettre en œuvre. Elle se souvient qu’à Beyrouth on élève des poules sur les balcons et qu’il n’y a pas d’écureuils. A Montréal on cuisine le pigeon au citron, n’est-ce pas Dany ?
L’homme, le teint pâle, dort sur un parapet couvert de carreaux blancs, entre des sièges métalliques bleus et l’escalier permettant d’accéder aux autres lignes de la station République. Il ressemble à ces gisants que l’on croise dans les bas-côtés des églises. Les voyageurs font un détour pour ne pas s’approcher du corps allongé. D’un seul coup, il se lève les yeux exorbités, visage mangé par une barbe hirsute, lance à la volée, balançant les bras de droite à gauche : « C’est dimanche ; faut me laisser tranquille ; c’est dimanche ; j’suis allé à la messe comme tous les dimanches ; je m’repose ; barrez-vous ! Tous ! » Il toise les voyageurs ; fait un pas en avant ; avance vers nous ; change de direction ; moment de stupeur ; il s’approche de la fosse ; mon fils a peur ; lâche un crachat sur les voies avant de retourner religieusement à sa place.
On les repère de loin les endimanchés de province. Ils se déplacent en bande pour la foire de Paris, le salon de l’auto ou celui de l’agriculture (à ne pas confondre avec les supporters sportifs braillards qui envahissent le métro tel une nuée de sauterelles les soirs de match). L’accent et le besoin de tout commenter les trahissent plus que leur façon de pointer du doigt chaque station sur la ligne de métro. Leurs conversations joyeuses offrent une note d’exotisme dans le train-train quotidien du parisien. Chaque fois je les épie, devinant les objectifs de leur visite. Les derniers croisés couvaient du regard leur fille, reçue au baccalauréat et inscrite en histoire à la Sorbonne, cherchant à se rassurer en parcourant le trajet qu’elle devra prendre toute l’année durant entre son logement et les locaux de l’université.
Dans les couloirs de Nation, sur le quai de la ligne 9, une petite fille s’agite dans les jambes de sa mère ; quémande un bonbon ; exige le Smartphone pour jouer à entasser des billes de couleurs ; cherche dans le cabas un paquet de gâteau ; hurle quand sa mère lui arrache des mains ; tire la langue ; glisse entre ses jambes pour former un poids mort ; cogne du pied ; commence à geindre ; fait la grimace ; hésite avant de fouiller à nouveau dans les affaires de sa mère. La femme se baisse et met une fessée. Personne ne cille. Le métro est à quai.
Son corps obstrue l’entrée de la station depuis dix bonnes minutes : je l’avais repérée pendant que je prenais un café au comptoir d’en face. Elle est plongée dans la contemplation du trou noir au bout de l’escalier étroit. Elle tient en équilibre tout au bord de la première marche, sa canne en appui sur la troisième, ses cheveux blancs traçant une ligne bien nette sur son manteau bleu ciel. J’ai peur de la bousculer en me faufilant… Elle se met en branle, ça la surélève comme un diesel, et son corps bascule vers la bouche sombre avec une grâce lourde, dans un mouvement continu qu’elle accompagne du murmure d’un aaaaaahhhhhhhhhhh vertigineux
Le jour où il ne faut pas être en retard, le choix stratégique du trajet est déterminant et, dans ce parcours, les raccourcies connues des seul.e.s vrai.e.s parisien.ne.s font la différence. Mais au tourniquet unique de l’entrée réservée aux passagers munis d’un abonnement, voilà que deux peigne-culs d’un autre âge grippent de tout leur corps cette mécanique bien huilée. Leur ressemblance ne devait pas suffire, ils ont décidés de passer ensemble le portillon, comme d’indissociables siamois et les voilà coincés entre le tourniquet et le battant de la porte. Ils essaient en vain de se retourner pour quémander de l’aide avec leurs petits yeux désemparés… Je glisse mon pass glisse sur la borne pour les désincarcérer. Le bip les inquiète, forcément lentement : tout mouvement est aboli dans l’absence d’espace. L’un des deux recul et bloque la porte tandis que l’autre la pousse. Désespérant. Je renonce. Je suis en retard, je file, Ils y sont probablement encore. Contactez la RATP SVP.
Dernière entrée dans le wagon, je m’adosse à la porte. Un jeune homme me fixe avec une intensité immédiatement désagréable. Les Métamorphoses sont de peu de secours contre son insistance. Je vais m’assoir à la première occasion. Son regard est resté fixé sur la vitre de la porte. Dans le reflet, je vois son visage qui sourit - me sourit ? -. Chaque fois que nous entrons dans une station, le reflet disparaît et il regarde autour de lui, désorienté.
eeeeeeeeeeeH Momo ! – s’lut – Et tu vas ? – oui toi – Eh… ça va. Alors, qu’est-ce tu fais là ? – d’passage toi – Eh ben… j’bosse là. Mais là c’est la pause. Toi aussi ? – nan d’passage L’entrée de l’hypermarché, c’était une espèce de sas. Un mur de vitres, un rempart de vitres même, qui te torréfie quand le soleil donne. Lorsqu’on est entrés, je voyais bien qu’il nous regardait avec insistance, Momo. Mais sans sourire, sans expression. Et avec une drôle d’allure. Plutôt bien mis, avec sa bonne tête, sa raie sur le côté et ses vêtements chics. Mais sans goût. Sa veste et son pantalon du même bleu, du même azur. Et cette coupe slim ! Avec sa grande taille, tu avais l’étrange impression qu’il était taillé en pointe. Et qu’il glissait sur sa mine au lieu de marcher. En plus il piquait. Et puis je déteste quand on me répond et qu’on ne te regarde pas. D’ailleurs il a bien dévisagé Naïs. Il a dû croire qu’on était ensemble. J’imagine ce qu’il aura raconté aux autres ! Et… tu connais pas Naïs ? Naïs, un vieux pote. — Bonjour. – s’lut – Va falloir qu’on y aille Will. — Et la famille, les enfants ? – bien toi – Eh… ça va, ça va. Et… Naïs c’est, c’est l’heure tu dis ? Eh alors… bonjour chez toi – b’jour ‘si Et qu’est-ce qu’on fichait à, dans ce sas ? Devant ce panneau publicitaire pour le dernier Transformers (L’Amant double au verso). En ce moment c’est I am not your negro. Il y avait aussi le banc et la poubelle. On devait gêner les gens qui passaient en caddie. Sur la très grande affiche recouvrant le mur de vitres côté magasin, les portraits des producteurs locaux qui traitent avec l’hypermarché, dans une sorte de sérigraphie. Et les portes, automatiques. Elles allaient et venaient, elles s’ouvraient et se fermaient, se rouvraient se refermaient se rouvraient se refermaient, en geignant en chuintant, s’ouvraient en chouinant.
Son nom ? Je ne sais plus. Mais c’était du côté de la gare, si tu veux. Le feu au bout de cette rue. Il faisait beau. Chaud même. Les vitres étaient grandes ouvertes. Et là, au bout de la rue, au feu, un clodo. Il va d’une voiture à l’autre. Main tendue. Une seule hâte : qu’il passe au vert le feu ! Parce qu’on n’est pas au clair avec ça. Jamais. Mais là, il vient juste de passer au rouge, le feu. Et nous avec. Et on flambe avec lui. D’autant plus qu’on lui refuse ce qu’il demande, le clodo. C’est un revers de main par la fenêtre. C’est la vitre qu’on referme. C’est la tête qu’on tourne de l’autre côté. C’est le feu qu’on fixe sans savoir que ce qu’on voit c’est la couleur de la monnaie qui cliquette. C’est la bonne conscience qui s’ébranle dans le caniveau. Et puis non, c’est le feu qui nous fixe. Et c’est même lui qui remonte trop vite cette rue. Un feu follet. Bien au chaud dans son pantalon de velours côtelé, son pull à grosses mailles et sa chemise à carreaux, sûrement sales et troués ou déchirés — et heureusement vu le temps. Sans te parler des godasses défoncées que je n’ai pas vues. Un feu follet cheveux filasses, barbe inculte. Son visage ? Je ne sais plus. Ou plutôt si : le mien. Enfin pas vraiment. Disons le nôtre. Disons que c’était à nous. Parce que lorsqu’il est arrivé, le clodo, je ne sais pas ce que je lui ai dit, je ne sais plus la tête que j’ai faite, mais lui : lui, le clodo, il me l’a montrée, ma mine, ma gueule : et je les ai vus mes mots sans noms. Ce n’était pas une imitation de ma figure dans la sienne. Mais plutôt du mime. Ou quelque chose comme de la ventriloquie. C’est ça : un visage ventriloque. Du mime à l’estomac pour ainsi dire — et il serait temps qu’on parvienne à dire quelque chose —, peut-être comme on a pu parler de littérature à l’estomac. Bref ! Peut-être la manière des bouquets de nerfs picturaux de Bacon, il m’a tiré le portrait en mon discours insignifiant — eh oui, quelques mots obscurs peuvent couver un discours énorme qui ne dit pas son nom. En quelques traits sur sa gueule, défigurée, il a reconfiguré la carte de ce que signifie, de ce que veut dire, au fond, du fond de nos tripes… ce que chante I AM, tiens, par exemple. Écoute ça pour voir : « Aucun visage ne me regarde/Et sur les quelques pièces que je glane/À la sortie des magasins, après l’office/Le côté face aussi me donne le profil. » Et le sourire justement. Le côté face c’est ça : le sourire du clodo. Rien de cette d’arrogance par quoi « Même sous le soleil on ne fait que vivre sous ton ombre/Perdus dans tes méandres on s’essouffle et nos visions se déforment », chante encore I AM. Au contraire. Il me démonte la gueule, il me refait le portrait du fond de ce que je lui dis — c’est-à-dire rien —, et il achève son œuvre de saltimbanque par un sourire si affable, si humble, et toujours aussi rayonnant malgré le temps — et il en est où d’ailleurs, maintenant, notre homme ? t’en es aujourd’hui hombre, comme dirait l’autre ? —, que le soleil brûlant la façade et le trottoir sur lequel il déambulait, dans le ronflement perpétuel de gaz d’échappement — véritable pot-pourri —, devait de jalousie en verdir. Avait-il donc déjà fait sien ce vœu que Chamoiseau n’avait pas encore formulé : « Fixer plus que jamais l’obscur en déclenchant pour soi, en inventant pour tous, des virgules de lumière. »
Il ne sait pas, au moment où il s’apprête à relater l’événement dans son journal, mais, la chose ainsi faite, il se retrouvera à peu près dans la situation de David Markson (Arrêter d’écrire) se demandant : « Pourquoi Écrivain semble-t-il parfois admirer Ulysse davantage quand il y songe que quand il le lit réellement ? » Pour l’heure, il ne sait pas par où commencer. Par où ? Par le milieu. Mais lequel ? Il y en a tant. Partout. Aïe ! Même, alors, dans une rame de métro ? Cette rame qui roulait à toute berzingue sur sa ligne, dans le noir comme toujours ? Vers où ? Il se le demande encore. Sait-on vraiment où il nous emmène le métro quand, ça y est, les portes viennent de claquer ? quand c’est parti ? quand la carlingue s’ébranle et que ça vous brasse ? quand ça siffle à droite ? et puis ça siffle à gauche ? et non, là ça gémit, ça chouine ici aussi. Et ces espèces de voix, au détour d’une autre ligne que les feux rouges d’une autre rame, déjà faibles, vous font deviner — ces voix que seul l’ensemble Accentus serait capable de reproduire ? Ces voix quand personne, personne oui — il avait jeté un œil dans toute la rame —, ne parle. Quelques lèvres, peut-être, tentent de s’élancer. D’autres s’avancent timidement, s’énoncent en tremblant. Mais rien. On n’entend rien de rien. Et puis à qui s’adresse-t-elle, là-bas au fond, cette bouche désarticulée ? L’autre, en face, ne semble même pas la pressentir. Et un autre : la bouche dans l’oreille (gauche), l’œil par la fenêtre, où l’on ne voit rien. Rien d’autre que soi, brinqueballant. Car dans la rame illuminée — si c’en est encore une, il imagine plutôt un radeau —, chaque vitre est un miroir. Un miroir déformé par la vitesse, les mouvements, les vibrations. Et déformant, dans ces bruits et ces voix en tous genres, illusoires. Et au milieu ? Il y a ce sang… cette goutte de sang qui glisse du haut du nez sur la joue. Il y a aussi ses yeux… non, ses billes sur lesquelles, tout en essuyant cette coulure — doucement, en tamponnant, en tâtonnant mais doucement, à l’aide du petit mouchoir de papier qu’elle a sorti de son sac —, ses yeux à lui ne peuvent s’empêcher de rouler. Dans lesquelles son regard glisse, s’enfonce, insensiblement. Ah zut ! ça coule de l’autre côté maintenant ! — Aïe ! C’est que, de même que la ligne de métro l’est, quand on y pense, de cette comète qu’est la rame, sa main est traversée du branle de la carlingue. C’est qu’il se demande également — et décidément, il s’en demande des choses — si elle aussi elle le regarde. Elle le voit, évidemment, mais est-ce qu’elle le regarde ? Et si elle le regarde, que trouve-t-elle ? qu’y a-t-il à découvrir, dans ses yeux à lui, quand il la regarde elle ? comme ça, par-dessus cette drôle de larme ? (« Ah zut ! ça coule de l’autre côté maintenant ! » — voilà par où il commencera.) Et les autres… le percevaient-ils aussi ? ou du moins le pressentaient-ils ? Parce que, bien sûr, les autres les observaient. Même la vieille dame, le nez sur son écran, l’air absorbé, aura fini par relever la tête — il faut s’en persuader. Et alors, suffit-il d’un coup d’œil, comme ça, sur lui en train d’essuyer son nez à elle, ensanglanté — parce qu’elle s’est pris en pleine figure juste après le tourniquet tripode du portail automatique une de ces portes à deux battants éjectant une à une quand chaque battant glisse d’un côté et de l’autre pour s’ouvrir et se fermer et se refermer sur le battant opposé du même pas cadencé ces billes égarées dans un vieux flipper : les gens — juste un coup d’œil, par-dessus la tablette ou la liseuse, écouteurs intra dans les oreilles (l’index sur la gauche), pour comprendre ce qui se passe, quand eux-mêmes ne le comprenaient pas, et se défiaient — avouons-le — de le savoir ? Mais il y a surtout cette larme, virgule illusoire, qui n’en finit pas de rouler.
Dans le flux des passagers qui descendent, les robes d’été, les sacs Carrefours, les nu-pieds, une décharge ! Mains flexes qui piétinent, tête sortant d’entre les jambes, genoux montés à l’envers, la femme araignée est sortie aujourd’hui. Le choc accélère le disfractionnement de son corps. Je rentre ; ça sonne ; les portes se referment. Est-elle restée dans le wagon ? Que le regard indifférent des voyageurs ; ce désir de ne pas souffrir et de ne pas révéler ce que l’on pense. Je me surprends à la chercher encore sur le quai vide qui s’éloigne.
Je suis un point fixe au milieu des passages, main à la barre. Jupe remontée sous les seins, chemisier d’un vert insolent, chapeau de paille retenue par une ficelle à rôti d’où s’échappe une queue de cheval, je parie sur l’américaine en excursion. La jardinière se retourne, le rouge à lèvres tremblant. Bingo ! Elle se confond en superlatif auprès de la jeune femme qui lui cède son strapontin ; une autre esquisse le même mouvement pour le mari qui refuse ce rappel de l’âge.
Vite une place, je me glisse sur le siège encore chaud. Le bébé est dans sa poussette aussi pleine qu’un caddy ; il émerge des packs de couches et de courses. Son petit corps dodu vêtu d’un simple body, s’agite. Trop de monde, trop chaud, trop de tout. Il se tortille, se laisse fondre en flaque le long du siège pour se libérer de la ceinture de sécurité. La mère le rattrape et le recadre avec un paquet de chips qu’il jette furieux. Il se plisse de colère, sa respiration est suspendue, prend son élan…ça y est, il crie, il braille. La mère l’évente tant qu’elle peut avec un prospectus des dernières promotions, dérivant pendant quelques secondes les milles aiguilles de colères. Il n’est pas dupe de son stratagème. Son jappement qui n’est pas mien, ne m’atteint pas. J’observe cette fureur de fin d’après- midi, irrépressible, je me vois mesurer sur une échelle symbolique le pic de la courbe. Déjà ma station !
On est assises là comme deux cruches. J’ai dit bonjour en entrant dans la salle d’attente, j’ai fait semblant de ne pas la regarder… et puis on a fait semblant de ne pas entendre à travers la cloison la consultation de la femme avant nous. Je pense : « Mais qu’est-ce que c’est que ce cabinet ? Bonjour le secret médical ! Qu’est-ce que j’en ai à faire, moi, du troisième mois de grossesse de Madame Tartempion ? » Soudain, je croise le regard de ma voisine de patience : elle a l’air paniqué. Elle doit se demander si je me souviendrais de sa consultation que je ne vais pas tarder à entendre… a-t-elle une maladie honteuse ? ou est-elle seulement pudique ? Et moi : suis-je le dernier rendez-vous de la journée ? Ou y aura-t-il une autre femme pour essayer de ne pas entendre ma consultation ? La gynécologue ouvre la porte et trouve deux cruches gênées qui s’excuseraient presque de l’avoir fait attendre…
Posée dans le RER, ma boîte entre les genoux. Un jeune homme me demande, avec malice : « Eh M’dame, c’est quoi là-dedans ? Un instrument d’musique ? C’est pas une kalachnikov au moins ? Vous allez pas nous faire sauter ? » Je souris et lui réponds « Non, c’est un violon ». « Ah, la musique ! Moi j’aime la grande musique ! Barry White, vous connaissez ? » Il m’amuse de plus en plus ce drôle de zig qui n’a pas peur de parler à une inconnue, juste pour le plaisir, sans autre enjeu… « Moi je joue plutôt du classique : Bach, Mozart, … » « Ah !! c’est bien… vous n’allez pas nous faire sauter alors… vous vous rendez compte ? Moi j’suis rebeu et j’ai peur quand même… tout le monde a peur ! » Il a élevé la voix, au cas où le reste du wagon clairsemé n’ait pas entendu le début de la conversation. « Ah bah j’descends là. Merci pour la causette, j’aime bien parler musique ». Et les portes se referment pendant que je le regarde marcher sur le quai. On a gardé chacun un sourire amusé. C’est rassurant de croiser des humains auxquels s’identifier.
Calée sur une place côté vitre, chapeau rouge en feutrine piqueté de quelques gouttes de pluie, manteau qu’elle ne prend pas non plus la peine d’enlever, elle fait le dos rond autour du sac sur ses genoux duquel elle a extirpé un crochet de tricot et une boucle de fil orangé. Elle est assise en face de moi et le mouvement de ses mains sec et précis m’empêche de me concentrer sur ma lecture. Je garde la tête baissée mais observe en douce sa dextérité. La main droite pique le crochet dans une boucle, la main gauche - ou plutôt l’index de la main gauche - enroule un fil sur le crochet, et ce dernier se retire adroitement pour former une nouvelle boucle, avant d’aller piquer juste à côté. J’ai fini par relever la tête. Elle regarde tantôt son labeur, tantôt le paysage par la fenêtre, puis répond à mon sourire admiratif avant de replonger dans son activité. Je tente de retourner dans mon bouquin, mais aux caractères imprimés se superposent les images de ma grand-mère crochetant un coussin bleu et rose. Le train berce mes souvenirs et me ramène tendrement à mon enfance pour le reste du voyage.
Belleville. Elle s’est relevée d’un strapontin en esquissant un geste d’excuse que je ne comprends pas. Elle m’adresse un sourire éclatant. Je lui souris aussi, charmée par le rayonnement de son visage. Ses cheveux sombres épais mouvants ondulent au moindre de ses mouvements. Elle porte un pantalon jaune fleuri et des ballerines nacrées. Entre deux stations, nos regards se croisent encore, nous nous sourions à nouveau. A République, le métro se vide, elle peut se rasseoir. Bientôt, je remarque qu’elle masse son ventre d’un geste circulaire qui souligne l’arrondi naissant d’une grossesse récente. Je détourne le regard par discrétion. Rambuteau, elle descend du métro. Nos regards ne se sont plus croisés.
Il se hâte autant qu’il peut en s’appuyant sur une béquille. Avec ses jambes tordues, son dos courbé, une épaule plus haute que l’autre, son visage disgracié, on dirait Quasimodo. Il bataille avec le loquet de la porte du métro qu’il n’arrive pas à soulever de sa main libre. A l’intérieur, une femme se précipite pour l’aider. Elle aussi bataille avec le loquet et réussit à maintenir ouverte la porte alors que la sonnerie retentit. Il finit par entrer dans le métro. Il sourit à la femme. Dents abimées, noircies, c’est pourtant un immense et magnifique sourire à la femme qui lui a ouvert la porte.
Derrière moi, on dirait… oui, des doigts s’enfoncent dans ma chevelure et caressent le haut de mon crâne. Je me retourne. C’est un vieil homme, longs cheveux blanc vif, beau visage, vêtu de broderies en loques. Il laisse mes cheveux et lève ses bras en l’air. Dans une de ses mains, une bouteille de vin ouverte. Il déclame une sorte d’incantation rituelle. Sa voix enfle. J’ai le réflexe de quitter précipitamment mon siège avant qu’il ne commence à asperger la rame presque vide du vin sacré de sa bouteille.
Un corps perdu au milieu d’ autres corps, debout face à la portière du tram ; huit neuf assis dans le tram 2 du soir. Premier arrêt : Jean Lamour. Le jeune homme vacille lève les bras agrippe de ses mains la barre argentée ; il fixe quelque chose que seul il semble voir, ses yeux noirs se ferment à moitié ; sa main gauche glisse brusquement, ses jambes fléchissent il se redresse. Il plaque son dos contre la vitre, ses mains retrouvent le froid de l’ inox, son bras blanc noueux se raidit, il ouvre les yeux, sa main passe rapidement sur son visage. Son visage aux yeux absents sourit.
Elle ouvre le tube presse sur le tube dépose dans le creux de sa main droite un peu de crème, frotte avec la paume la peau hiéroglyphée de sa paume gauche, effectue plusieurs cercles invisibles, s’ arrête tourne la tête vers la vitre ; son visage disparaît. Ses mains sont jointes restent jointes, elle croise ses doigts les décroise, joint de nouveau les mains , découvre ses paumes révèle le dessus de ses mains ; Elle prend le tube de crème le range, pose ses mains sur un sac rouge et lisse comme chacun de ses ongles. Elle tourne son visage vers la vitre, le reflet de son visage s’imprime sur la vitre.
Des corps debout des bras ballants, des mains avec portable, avec sacs plastique pleins, des têtes aux yeux baissés un dos avec sac à dos des dos larges étroits voûtés graciles ; alors les corps ne sont plus que têtes bustes bras, le bas des corps s’ efface ; des bouches fermées des bouches qui parlent avec toutes sortes de voix ; toutes les voix se mélangent ; à l’ arrêt la portière du tram 2 s’ ouvre, mouvement des corps , tentative des corps de chorégraphie lente, des têtes se font face des corps se tournent. Il tient son livre d’une main, le livre se détache de son lecteur, frôle des boucles noires souples.
Il trépigne, passe d’un pied sur l’autre. Devant lui, cette femme qui hésite, tergiverse, pose question sur question au vendeur qui, n’ayant rien d’un technicien, n’a pas toutes les réponses. Lui sait exactement quelle question poser pour avoir une réponse, il la remâche dans sa tête, la prononce pour lui même, se la joue en douce. « Combien de vis dois-je acheter pour monter cette étagère ? » Il s’y voit déjà, étagère montée, bouquins enfin en place. Mais la femme n’en finit pas, minaude, prétend ne pas comprendre : jolie, très jolie....
Elle a pris le chemin qui monte vers le refuge. Elle n’avait pas pensé qu’elle trouverait la neige, encore à cette saison. Devant elle, un groupe de randonneurs, sans âge, mais vieux. Ils trainent, commentent le froid, le blanc, le soleil qui tarde à venir, les animaux qui n’ont pas terminé leur hibernation, les fleurs qu’ils croyaient trouver là - mais non. Le sentier étroit l’empêche de les doubler, elle chantonne, de plus en plus fort, pour qu’ils l’entendent, qu’ils la laissent passer. Le dernier du groupe est un homme svelte, cheveux blancs, chair de poule sous le short. Elle ricane en elle même. Lambins et pas fichus de porter des vêtements adaptés.
Tu n’es pas à ta place. Tu avais réservé le siège 50 en voiture 7 et es montée dans la voiture 5. trop en retard, couru le long du quai. Le train est bondé. Il va te falloir changer de wagon alors que ça ne passe pas, non vraiment pas. Couloir obstrué , dame plus que replète, à bout de souffle. Tu tentes de la pousser un peu, pour qu’elle comprenne. Le contact est moelleux. Elle ne bouge pas, elle ne bougera pas.
Au métro Filles du Calvaire le quai est désert. Seul un homme se tient debout, face à la voie. Il tient sous les aisselles un nourrisson à bout de bras, au dessus des rails. J’arrive dans son dos, je ne peux pas voir son visage. Son attitude muette, son regard qui m’échappe, la chair vive de l’enfant qu’un geste maladroit pourrait tuer et l’incongruité de la situation me sidèrent, je bafouille un « hé, là , hé là ! » mais l’homme ne semble pas m’entendre, il ne se retourne pas. Je m’approche mais n’ose pas le toucher. Il agite un peu le bébé de haut en bas, longtemps, sans dire un mot. Le métro arrive dans trois minutes. J’ai peur. Je cours demander de l’aide. Quand je reviens, accompagnée d’un agent, le quai est vide, le métro passé.
Au bas de l’escalier qui mènent aux correspondances à Nation, au milieu du couloir, la femme est debout. Elle ressemble à une longue bougie dont les hardes formeraient la cire. Elle porte un chignon de traviole, gris, une sorte de gâteau fondu. Grise aussi, entièrement, sa peau, comme si on l’avait peinte. Gris ses longs doigts tentant de retenir les lambeaux des haillons, grise entière cette silhouette lente, dodelinante. On voit une fesse, un morceau d’épaule, les pieds nus. On cherche le visage, le regard étonnamment vivant, on se détourne, on crie à l’intérieur, on a honte de soi et de tous ceux qui passent, on passe nous aussi, mais on tourne la tête pour retrouver le regard, c’est un regard intelligent, on revient sur ses pas, on échange trois mots, on donne mais donner ne sert à rien, c’est prendre qu’il faudrait, tout prendre et tout donner en retour, mais on sait bien qu’on en est incapable, on n’en a plus la force, quelque chose a vieilli. Il est 9 heures du matin, le couloir est étroit et on se laisse emporter par le flot, un homme rabat un pan de sa veste sur son visage, une femme porte son écharpe à hauteur de nez, quelques pièces tintent dans mon dos, je n’ose plus respirer, car la puanteur a jailli et elle est insupportable, elle semble suinter des murs même, descendre et monter tout à la fois dans ce corridor absurde. Le corps de la femme crie et ce cri est une odeur qui vous asphyxie, ce corps semble projeter tout son bouquet de misère, éclaboussant les poumons, les peaux lavées, les costumes et les robes de ceux qui se rendent au travail, comme s’il était le dernier signal d’une bête qui meurt.
Il est assis en face de moi et se tait. De la manière dont il est habillé, de son visage, je ne vois rien. Il vient de me dire une grossièreté, j’ai répliqué, je n’aurais pas dû. Ce que je regarde à l’instant, c’est son regard qui me regarde d’une manière fixe, soutenue. Il y a de la hache dans ces yeux là. Quelque chose que je n’ai encore jamais vu d’aussi près et qui me terrifie instantanément. L’homme attend, il est prêt, je le sais, je sens un extrême danger, la vieille femme indifférente assise à ses côtés n’y changera rien. Je regarde les mains du tueur, posées sur ses genoux, mortellement immobiles. Pas faire un geste. Je sens sur mes paupières la brûlure fixe du regard. Je respire à toutes petites goulées. Le métro arrive à Strasbourg Saint-Denis. Juste avant la fermeture des portes je fais mine d’avoir oublié mon arrêt, saute sur le quai et me fonds dans la foule. Je ne me retourne pas, je cours.
Il imagine la scène... Le recruteur décoche ses flèches empoisonnées aux candidats dont il croit déceler les failles ; il a l’embarras du choix, il sait que dans le vaste vivier à sa disposition il finira de toutes façons par puiser la perle rare... A moins que le poste ne soit déjà pourvu grâce à une recommandation ? Et la série d’entretiens ne serait qu’une mise en scène pour donner l’illusion que le cadre juridique régissant les embauches est respecté ?... Les candidats éconduits et humiliés se gardent en tout cas de protester. On ne sait jamais, le recruteur les a peut-être mis à l’épreuve, il vaut mieux filer doux, ne pas gâcher la plus petite chance ?... Encore deux postulants devant lui et ce sera son tour. J’ai surpris des bribes de conversation, la "boîte" recrute un(e) commercial(e). Je l’observe à la dérobée, je décrypte ses tics nerveux et j’essaie d’imaginer ce qu’il imagine... Je me sens soudain observée moi aussi, et je jette un regard oblique dans la direction du regard que je devine posé sur moi avec insistance… Mais je ne vois dans la salle d’attente commune que des têtes baissées vers un journal ou des yeux perdus dans le vague... Je déplie les jambes, j’agite les bras pour sortir mon téléphone d’une poche, le remettre dans l’autre, je soupire, je ferme les yeux, je cherche une position plus confortable... Jusqu’à ce que s’ouvre une porte qui livre passage à une personne qui cite enfin mon nom… Je la suis et disparais dans le cabinet où j’ai rendez-vous au moment même où le supposé candidat à l’embauche que j’avais remarqué s’engouffre lui aussi dans le bureau de la personne qui détient peut-être les clés de son avenir. A chacun son destin...
Le couperet est tombé. Maladie incurable, pronostic vital lourdement engagé. Le monde des autres recule ou s’efface. Sentiment d’une vitre blindée qui rend brusquement impossible la communication. Les voix parviennent étouffées, les images de visages ou les silhouettes entrevues sont déformées par le prisme d’une monstrueuse barrière optique. Sécession. « Je » cesse d’être « un autre ». Radicale métamorphose que je voudrais repousser de toutes mes forces mais qui s’impose en quelques secondes lourdes comme des larmes de plomb.
L’homme s’est retourné et son regard semble m’interroger à travers une sorte de brouillard. Je ne le vois pas immédiatement. C’est pourtant lui, je le reconnais enfin, l’homme de la salle d’attente !... Il a l’air soucieux, sans doute n’a-t-il pas obtenu le poste qu’il convoitait ?... Il s’approche de moi, me demande si je vais bien. Je prends alors conscience de ma posture, arrêtée au milieu du trottoir, la tête appuyée contre un lampadaire... Je me redresse et lui souris, oui, je vais bien, un peu de fatigue seulement ! Je me remets à marcher, il fait quelques pas avec moi, je le remercie, nous nous séparons, je le regarde s’éloigner, il se retourne encore, nous nous faisons un petit signe, surtout, ne pas se couper des vivants !...
Un sac kraft bistre avec des lettre imprimées en bleu, je joue à la devinette Le… Leriche, Legrand, Lefort, ah c’est un c… lec ? Un sac tout chiffonné et il tient debout, les poignées torsadées légèrement espacées ne laissent rien voir de l’intérieur. Aux pieds d’un jeune homme, protégé entre les deux jambes, le sac est un habitué du transport en commun, il connait les sols par cœur, il s’adapte et reste silencieux. Calme, la tête appuyée sur le rebord de la fenêtre, le jeune homme légèrement barbu, habillé de noir et de bleu, semble un homme sans histoire. Terminus, gare Lille Flandres, ça bouge le sac est soulevé et il se déplie, ah oui, C comme Leclerc drive et un vêtement blanc se fait voir, un pull ? Une veste de sport…
Dimanche midi le tramway a une allure légère. Station Romarin. Une cigarette tourne et retourne entre le pouce et l’index droit. Avec l’index gauche il la tape sur la phalange de l’index droit. Elle danse ; elle est caressée de tout son long. Le petit doigt appuie sur le bout de la cigarette et enfonce délicatement le tabac. Il parait jeune, 17 ans, accompagné d’un copain et ils n’arrêtent pas de parler. Et hop, à la bouche, les lèvres la suçotent, la cigarette. Les mains sont libres, le smartphone sort de la poche du pantalon jean, "C’est quoi le nom exact ?" les mains tapotent à grand vitesse. La cigarette quitte la bouche et reste dans la droite pendant que la gauche s’amuse sur les touches. Station Brossolette, il descend déjà.
Assis, endormi sur la banquette, il se réveille en sursaut à chaque station. Il était déjà là quand je suis montée à La station Victoire ; en face de lui et un peu de côté, façon de ne pas top le dévisager, je ne sais plus regarder d’autres personnes que lui. Vieux, 90 ans sûrement ; des chaussures à larges et épaisses semelles en tissu fourré laine et fermées avec du velcro. Un pantalon prune XXL pas adapté à sa taille, une chemise bleue ciel avec des bandes au point de croix en fil noir et un blouson beige ouvert. Il est là et en même temps ailleurs. Serait-ce son loisir de l’après-midi de vagabonder dans le tramway ? Est-il sorti de la maison de retraite en cachette ? Lille Flandres Terminus, tout le monde descend, il reste assis, une jeune fille lui fait un geste de la main et l’invite à passer devant lui. Un grand sourire, il prend tout son temps pour se relever tout seul et à très petits pas il remonte le quai. Je le veille de loin, il avance doucement et sûrement
En face de moi, alors que le bus redémarre, un petit bout de femme à l’œil pétillent de malice m’interpelle : « Vous aimez la musique ? ». Je mets mon IPhone sur pause et fais glisser les écouteurs de mes oreilles. D’un seul regard elle me jauge et, comme je lève les yeux sur elle, l’ensemble de son corps frêle frétille de satisfaction. La ceinture de sa gabardine en profite pour se dénouer. Les revers du col s’ouvrent et laissent entrevoir un chemiser à fleurs scrupuleusement fermé jusqu’au bouton du haut. Dessus repose un magnifique pendentif qu’une main indélicate se ferait le plaisir d’arracher. Elle s’anime, monologue, s’interroge. Au milieu d’une phrase, elle change de sujet puis réalise qu’elle doit bientôt descendre du bus. A l’arrêt Poirson, elle prend poliment congés.
il dit qu’il ne comptait pas sortir de chez lui aujourd’hui, qu’il voulait être tranquille, que le bus est surchauffé, que ses amis l’ont supplié d’intervenir pendant la réunion, qu’il n’avait rien de plus à dire, que les gens ne sont pas souvent courtois dans le bus, qu’il avait prévu de lire ou bien de regarder la TV, de se laisser aller à cet après-midi morose, que le trajet en bus est long, que ça fait du bien de parler à quelqu’un, que la vie n’est pas toujours celle qu’on attendait, que le chauffeur conduit brusquement, que finalement il devrait prendre le bus dans l’autre sens, s’en retourner chez lui comme si rien n’avait existé, comme si c’était une erreur, comme si finalement le temps ne faisait plus partie de la vie, comme si… arrêt Gambetta, je me lève, la porte s’ouvre, je descends du bus
Il manque la première marche du bus. Jure. Et se rattrape simultanément à la rampe de sa main droite, de l’autre, il tient toujours fermement son smartphone : « peut pas ignorer… attends ! ». Avance dans l’allée, bouscule une femme enceinte : « Pardonnez-moi ! ». « Mais laisse-moi parler ! Je te… ». Nerveux, soufflant dans le vide, il change son portable d’oreille : « peux pas continuer… je… je… ». Son regard se porte sur tout et rien à la fois, sa rétine n’imprime plus le présent. Il se balance d’avant en arrière comme s’il prenait la mesure des mots prononcés. Se redresse, retient sa respiration, lève les yeux au ciel et de dépit met un terme à la conversation. Bloqué dans les embouteillages du soir, le bus émet comme un bruit sourd de soulagement.
Plus tard on le retrouve devant une pinte de Karlsbrau. On ne sait si, ce faisant, il ralentit ou accélère le cours des choses : soixantaine corpulente et bronzée, bien écrasée sur sa selle, tongs aux pieds, bermuda blanc, tee-shirt bleu océan , lunettes parfaitement opaques , il pédale et tend son téléphone comme on tendrait à bout de bras, un bulletin de notes, comme on présenterait son nouveau-né, aux vieilles façades et aux vitrines : Tour Charlemagne, ancienne église St Denis , Fleur en plume … Des pieds, d’une main ou l’inverse, il pousse sur les pédales et tourne, tourne son guidon vers lui-même. Il parle et commente, il mêle sa forte voix italienne aux cris des martinets. Là-bas, quelqu’un répond sous forme de rire. Dans ce pédalage lent et circulaire, il y a comme une ivresse, on le dirait dans une nacelle, un manège, dans une légère ivresse. C’est un matin de plein été, par téléphone interposé, à quelques milliers de kilomètres : une visite commentée de la ville.
Entre temps, il a passé sa sébile en fer blanc, sous nos nez, et lié conversation avec une « vapoteuse » en short, un jeune très occupé par les vitrines…, ou un autre. Tunique jusqu’aux genoux, sandales usagées, longues dreadlocks, il convertit le salut cordial, le bon mot adressé à chacun, en pièces de monnaie. A le voir on penserait qu’il méjuge et se moque, qu’il aurait un problème, on le prendrait pour un pouilleux, un crève-la-faim, mais c’est un inventif à l’intérieur. Le plus fort est cette capacité qu’il a à sauver vos journées monotones. « Oh, Mademoiselle, la bonne nouvelle que voilà !! Un texto qui va changer le monde ou un message d’amour qu’Il vient de vous adresser ? - Ah les hommes sont vraiment surprenants ! ». Il vous sert, telle une image Polaroïd, un koan zen, quelques mots, quelques phrases en miroir et en lien. Il exerce un vieux métier, un métier rare et quasi disparu. Il exerce son art : l’art du bonimenteur.
A la longueur de mon avant-bras, son corps étalé 25X16, immobile, sur le rebord étroit d’une fenêtre avec derrière moult dossiers, papiers pas rangés, petits écrans bleutés. D’un seul trait de fusain, je voudrais en dresser un portrait, être pareil à sa forme alanguie. Soldes en ville, partout beaucoup de monde. Tous sens dehors, tels des fourmis, les hommes les femmes montent et descendent sacs à la main, lèchent des glaces, s’interpellent, pédalent ou glissent en trottinette. On dirait une piste : piste de ski, piste de courses ? Lui ne bouge pas, toujours allongé sur le ventre. Il fait chaud, très chaud, lourd même. Devoir passer ses vacances en ville est une épreuve, j’en conviens. Lui réfléchit. La ville démultiplie les sons, les notes vraies ou fausses, et les voix en tous sens. Lui somnole et ronronne.
Cet homme longiligne sur le bord de la route, casquette sur la tête, lunettes de soleil, la bouche en cul de poule, serré contre le mur d’une maison, entre mur et route, trois tréteaux dans la main gauche et un sac dans la droite. La lumière de l’après-midi dans l’œil, tétanisé, face aux voitures qui abordent le virage, et la chaleur par-dessus.
Celui-ci devant la porte du supermarché, maigre, le visage buriné et scarifié, qui se lève à mon approche et me demande – quelques abricots si vous pouviez m’acheter quelques abricots j’adore ça – et se rassied sans attendre de réponse, mais les yeux levés vers moi, des yeux sombres, avec une lueur dans le fond, où brûle l’espoir d’un fruit.
Bar du duty free. Aéroport de Marseille. Il se dirige vers la porte 10. Coup d’œil sur le baby-foot sur sa droite. D’un coup d’épaule il jette son sac à dos par terre, redresse la table pour que glisse la boule, s’empare de deux tiges, hèle un compagnon qui le suit et l’entraîne dans un match de quelques minutes, concentre. Perd dans un éclat de rire.
Elle est entrée dans la rame presque en courant. Elle a repris son souffle un instant.Elle a levé la tête. Elle m’a regardée la regarder. Elle a baissé la tête. Elle est encore essoufflée. A présent elle ferme les yeux. Les traits de son visage se détendent peu à peu. Je suis assise face à elle. Elle a choisi cette place par hasard. Elle rouvre les yeux. Elle me regarde une seconde fois. Imperceptible sourire.
A cette heure du jour les rues de la villes sont encombrées de voitures et de passants. Je remonte l’artère qui mène vers l’hypercentre. Un homme grand et mince sort à l’instant du bureau de tabac et remonte cette même avenue. Le mine sévère, la mise impeccable, tout occupé par ses pensées. Pensées pour son boulot qui lui prend tout son temps. Pensées pour sa bien-aimée dont c’est bientôt l’anniversaire. Pensées pour ses enfants à l’école à cette heure-ci. Pensées. L’esprit extrait de la réalité, le corps bientôt déconnecté. Je ne l’ai pas vu arriver à ma hauteur. Mes yeux baissés, à la recherche d’un carnet au fond de mon sac. De peu évité.
Si je ne suis pas l’ordre de mes pensées. Si je remonte un peu plus loin dans le temps. Si j’évite de m’attarder sur les détails trop personnels sans importance. Si je parviens à placer le corps dans un état comme d’apesanteur. Je peux retrouver les mots. Je peux lire cette situation comme une texte ininterrompu. Je peux parcourir une seconde fois l’espace qui sépare la rue silencieuse de ce quai de gare encombré. Je peux me souvenir qu’une fois parvenue dans le hall, je me suis arrêtée un instant. Je me suis aperçue que j’étais en avance. J’ai observé les visages, les regards tendus vers l’écran affichant les trains en départ. Un seul regard porté au loin : cette femme. Longue silhouette, les cheveux tirés en arrière, un simple sac – simplicité du voyage. Au loin : l’homme assis jouant du piano. La mélodie m’est restée dans l’oreille tout au long du voyage.
Le feu piéton est au rouge, accompagné de petits bips. De l’autre côté du passage dit clouté mais en fait zébré, un homme attend, immobile, le visage droit sous son chapeau colonial. Le signal vert donné, il s’avance, raide, à petits pas. Je le regarde. Je voudrais lui demander d’où il vient. Lorsque nous nous croisons, je remarque son regard inquiet, celui de quelqu’un qui cherche son chemin, mais avant que je ne pense à lui demander où il va, je suis déjà de l’autre côté.
Les visiteurs indolents piétinent dans la file qui descend vers le musée. Au niveau du « coupe file », un homme s’insère. Il est sale, l’air hagard. Les gens devant se décalent généreusement pour lui faire une large place. Je remonte mon cache col et d’une main, je le maintiens serré sur le nez. Suis-je assez discrète ? Trainant ses chaussures lasses sous ses pieds, l’homme s’avance dans le hall du musée et embarque le reste de la file dans le sillon d’une odeur de trottoirs et de terriers solitaires.
Le bruit de ma fermeture éclair fait se retourner une jeune femme. Dans la bibliothèque, lieu de chuchotis, de frémissements, le moindre bruit est pris pour l’annonce d’un spectacle. Alors je tire ma chaise, aussi légère que possible et je m’avance machinalement vers la droite – j’ai déjà quitté la bibliothèque par la pensée, il me tarde la bouffée d’air sur mon vélo- quand un bruit de frottement me fait tourner la tête. La porte d’un ascenseur s’ouvre. Sur un fond lumineux, la silhouette d’un homme vouté sur un gros cartable en cuir. Il redresse son regard vide et croise le mien : « Je vais au troisième ». Il a l’air d’un petit garçon qui attend dans le couloir que la maîtresse lui dise de rentrer en classe. La porte se referme. Et moi, je vais dehors.
Tellement ce tram est à lui, va me falloir changer de place plutôt que d’entendre comment elle a de trop belles jambes comment il est sûr qu’elle sera à lui demain tellement qu’elle kiffe trop ses tatouages, qu’elle bosse en parfumerie tellement qu’elle sent trop bon la vanille ou jchèpakwa, va falloir que son arrêt soit bientôt là tellement ses baskets swinguent d’excitation et son portable suinte de testostérone tellement c’est gonflant, tellement il est gonflé à mort quand il pense à elle mec, va me falloir changer de place.
Encore un bout de papier à déplier, étaler, repasser du plat de la main sur le genou, puis replier, ranger dans le sac plastique bleu, regarder depuis ses lunettes à verre unique les autres voyageurs, tousser grassement, sortir un nouveau papier à déplier, étaler, repasser sur le même genou, replier, ranger, tousser, regarder, s’absenter dans sa vieillesse en haillons.
Gueule de tueur d’un polar français des années 80, penché de toute sa maigreur sur le couloir central, peau teintée de tâches jaunes chamois, regard ombré par la casquette Mao, tapote un vieux gsm raccommodé trop longuement que pour faire un numéro plausible, se lève d’un coup anguleux qui lui fait toucher le plafond, agrippe de toutes ses phalanges baguées une barre, s’exfiltre du tram dès son arrêt avec on dirait l’intention de dézinguer son prochain.
Corps agglutinés, on se frôle, se presse, se tasse. La magnifique pierre bleue de la bague accroche tout de suite le regard. La main est puissante, ensoleillée, attirante. Elle enserre la barre d’appui verticale du wagon. La peau doit être douce, des légers sillons la parcourent comme autant de chemins à découvrir. Un poignet solide s’échappe d’une veste grise. Freinage brutale, les corps s’entrechoquent, quelques cris. Les doigts ont légèrement bougé pour mieux agripper la barre. Le métro redémarre. La turquoise couleur de ciel et d’eau m’emporte.
Des chaussures comme un appel à la rébellion. Le cuir bleu monte un peu au-dessus de sa cheville, et les larges lacets noirs tels des rubans tombent en cascade. Les talons sont d’une hauteur à vous donner le vertige. Et pourtant, les pieds sembles y être bien installes. Fascinant cette capacité à marcher nonchalamment sur des échasses. Saint Denis Université. Les pieds s’agitent, se fraient un chemin sans écraser ses comparses. Les voilà, frétillants sur le quai. Un pied devant l’autre, l’autre devant l’un, un devant l’autre, l’autre devant...La cheville se tord et un instant le ballet s’arrête. Pas si compétente que ça…faut dire qu’Elle est très jeune.
Juste sous le col de son pull bleu en cachemire, une tache, toute petite tache mais une tache quand même. Une goutte du café de ce matin bu à la vite sur le coin bar de la cuisine ? Son pull était-il déjà taché lorsqu’il l’a enfilé ce matin ? Il se tient bien droit dans son complet veston impeccable et sans un pli. Alors quoi, cette petite tache ? Il tourne son visage rasé de près vers la vitre du wagon, plonge son regard dans le noir du tunnel. Au coin de son œil gauche perle une larme.
Il me fallait rencontrer le face à face. Il me fallait prendre le métro. Sentir la promiscuité me gouverner. Perdre ma contenance solitaire. Monter station Marcel Sembat pour ne pas en sortir avant République. Tâter de la rame qui se remplit et d’autres inconvénients que les miens.
Bloc notes : petit homme en face de moi lisant, les autres le nez dans leur téléphone. À l’affût de quelque chose qui se passe. Mais tout se passe ! À côté du petit homme à grosses baskets qui lit, une femme âgée assoupie. Ne peut rien faire d’autre que fermer ses yeux lasses de tant de jours et de jours. Rêve-t-elle ? Sous de fines rides enfoncées dans les joues, dessous la poudre rose seizième, elle dodeline calmement. J’ai dû emprunter la ligne la plus tranquille du métro parisien. A côté de moi une femme enveloppée dans une signalétique noire et blanche comme dans un poème de Michaud. Mais tout de même, la promiscuité, qui commence à se faire sentir dos aux portes des perclus de solitude sans jamais les en écarter . Ce qui te tue tu le gardes. Une sale drogue, accoutumance. Monter dans ce métro sans avoir rien d’autre à y faire qu’observer le cheminement d’une désintoxication ponctuelle. Rien de spécial en vue. Un grand type me fait un sourire en s’asseyant près de moi. Aucun sdf ni musicien en vue. J’ai trop chaud. J’étouffe. L’homme de grande taille descend à Grands boulevards. Une femme très maigre l’air agitée le remplace à mes côtés. Comment je m’insère là-dedans. Debout devant la barre, très bel homme noir peut-être des Antilles, visage de femme, très mince. Tous les autres blancs de chez blanc-fade. Promiscuité ? Trois personnes autour de moi pianotent toutes sur leur téléphone. Femme baissant la tête, chauve sous de maigres groupes de cheveux distordus, épars. Relayée dans la pièce en train de se jouer par homme sortant son téléphone de sa poche.
« Allo allo une petite pièce », fait une voix du fond du wagon, montée à Bonne Nouvelle, « vous allez me sauver ! » Claironne tout doux la voix ininterrompue tandis qu’avance en dansant léger maigre tatouages, gentil sourire. Tiens, un homme en mouvements dans ce métro à base de forte retenue. Il fait la manche tout en petits pas mots pointus titi parigot, sa marche est une danse, je lui montre en l’élevant ma pièce blanche du bout des doigts, que j’extirpe de ma poche exprès pour ce parcours initiatique. Il me voit je suis visible. C’est lui qui me sauve, lui qui nous sauve. Il prend ma pièce en ébauchant un salut théâtral écourté, on dirait petit bras, et la voix qui repart « merci, merci », suivie d’une avalanche de petits mots inaudibles sans cesse ni suite tandis qu’il s’éloigne en dansant des coudes et traîne pieds et mimant des bisous, se retournant, et encore des bisous lèvres mains mots à mon attention, faisant se retourner vers moi le jeune homme métis assis à mes côtés, dans ses baskets et son jean tout troué. Me souriant lui aussi. Qui a dit que pas de sourire dans le métro parisien ? Lâchez-vos téléphones et allez-y. Ligne 9 entre Marcel Sembat et République aller-retour. Face à face manqué. A l’angle de l’avenue Victor Hugo et de la rue Paul Valéry. Que fait-elle là ? Et moi qui tourne sur moi-même pour repérer ma destination. En retard. La main sur le portefeuille. Les yeux sur les passants. Et le regard qui descend d’un cran. Sur le tas sombre en bas. A un pas de mes pieds. Un béret noir par terre devant elle. « Pardon excusez-moi » dis-je pour stopper un passant. Le tas en bas qui remue, attend, ne fait qu’attendre, à peine bouger. « Oui entendu merci ». Les yeux sombres et trop écartés, les mains ballantes, les vêtements sales et incongrus d’une normalité inattendue. Je glisse la main dans le portefeuille pour prendre toute la monnaie restante ; je ne m’assieds pas dans ma jupe légère à même le bitume en face de sa gueule abandonnée de jeune fille européenne larguée. Je n’entame pas la conversation. Ne lui demande pas ce qui l’a conduite là, cette mouise. L’œil glisse, la main laisse s’écouler les pièces dans le béret, une voix rauque laissant tomber un merci et le corps (le mien) se redressant juste penché pour l’arrivée des pièces saines et sauves dans le béret et non pour le face à face. Quoi sépare nos deux mondes nus ?
Le mouvement dans la diagonale, battement d’éventail rose. Derrière, des paupières se ferment, s’ouvrent ; régulière cadence. Le wagon tangue en diapason, le cou suit son papillonnement.
« Lapsus révélateur, tu vois c’est quand ce que tu dis… » : la suite, mangée par le couloir où tu ne fais que croiser cette conversation matinale. Aussitôt nostalgique des moments où tu ne connaissais pas les mots. Essorer de ton cerveau tout effet de sens, toute association avec le réel pour retrouver l’enchantement de la langue qui se révèle ; tu en connais la valeur aujourd’hui, tu saurais savourer ces rendez-vous uniques, les premières fois.
Elle les scrute l’un après l’autre quand elle rentre. Le wagon est salon ; elle y cherche toujours des visages familiers, comme elle, invités à cette fête qui n’aura pas lieu. Regard périphérique, elle fait confiance au sursaut de cœur lui signifiant la présence qui compte.
On ne meurt qu’une fois ; la première.
A grands renforts de doigts, l’homme à la caboche poupine se cure les naseaux ; les phalanges bloquées sur la fermeture écaillée d’un sac avachi, monolithique la femme ballotte au gré des secousses ; ses yeux dans le vague s’absentent quand ceux de l’homme luisent d’alcool. Deux images du Créateur, deux instants divins en chemin. Deux fois Dieu font Un. Dans le tram, direction centre ville, je m’interrogeais : la femme pyramidale, droite, fière dans la tourmente quotidienne et ce mec aux prises avec le fruit morveux de ses fouilles roulé entre pouce et index, en douce collé sous le siège ; foi de poisson dans un bocal, je n’aurais jamais cru le monde si rond, le temps si long mais je remercie pour l’eau, la nourriture pleuvant sur ma minuscule planète, la vue sur la géante télé, le loto et surtout les reportages mer et marine.
Lorsque minuit sonne au clocher de la terre et qu’Il est plusieurs à rentrer par le trois souvent, Dieu a mal aux pieds. Dans Zagreb qui s’ignore, je fus à la fête aux oiseaux ; quand j’en vins à m’endormir la terre décolla.
On ne meurt qu’une fois ; la dernière.
Gavés de destins en gestation des lombrics électriques filent ; ingestion, digestion, excrétion. Au mur sud du salon, un triptyque de Will Eisner ; un horizon sous le gosier la ville pour ne pas oublier.
Première planche, un grand dessin : le cul d’un métro disparaît dans le gosier lépreux d’une galerie ; dessous, dans une courbe de l’East River, un dépôt de rames, des quais ; derrière, les câbles, les piles du pont de Brooklyn. La seconde planche déroule trois vignettes rectangulaires : six mains en hauteur accrochées aux poignées, à la barre du wagon, six voyageurs en premier plan ; un grand gars dans la trentaine, pensif, paupières baissées, tient un journal ; une ménagère, distraitement, porte contre elle un sac plein de courses ; un petit frisé, genre épicier de quartier, inspecte ses voisins d’un air méfiant ; un fonctionnaire triste et constipé affiche une tronche de bouledogue quand panne d’électricité. Rame dans le noir. Étonnement, suspicion, crainte. La mère de famille serre ses achats puis, de case en case transpire, dégouline d’angoisse. Le malaise s’installe. Le frisé défrise, contrarié, dépité, rageur, abattu, le bouledogue se tasse dans son imper. Une bourgeoise se maitrise plus ou moins mais, coincé entre la black bloquant son colis et le bord de la vignette, un petit hispanique à fine moustache flippe grave. Au fil des dessins, la tension, la parano des passagers monte, investit les esprits, les cœurs pour s’intensifier : à nouveau trois bandeaux oblongs de la largeur de la feuille dont deux sans lumière mais au troisième le courant est rétabli. Bien que redessinée, la sixième case est strictement identique, à la première. Sous les néons les visages, les corps, subitement retrouvent leurs expressions, les positions d’avant la panne, or de ces passagers, un seul n’a montré aucune peur, n’a pas bronché, n’a pas bougé d’un cil, placide, impassible, calme, identique au fil des dessins et celui là m’aurait certainement interpellé toutefois, je n’ai pas encore pris le métro de New-York dans les années 60 et même, dans le noir, l’aurais-je remarqué l’homme au journal ?
Le métro ! Un pote m’a rappelé ce drôle qui trimballait à bout de bras, sous Paris, des cartons de bouquins. Lourds. Le métro, je n’y descends pas souvent et m’y paume. J’y renonce vite ; aucune anecdote piquante, rien, sauf cette amie brièvement saluée, voici longtemps, sur le quai d’en face et qui partait pour je ne sais plus quelle destination lointaine mais s’il me fallait, Jacqueline remonter à ce rêve où nous nous retrouvâmes et de ce rêve remonter la réalité jusqu’à l’origine du pourquoi de ces deux évènements, très vite nous quitterions la chaleur des boyaux de la capitale pour une longue histoire, or sortir du métro mauvais ; dehors ça rince à noyer le Zouave et de Bastille à la Chapelle, de l’Étoile à St Lazare au Père Lachaise, de Bonne-Nouvelle à Concorde, d’escaliers en trottoirs roulants, de flèches en pictogrammes sans rencontrer personne vu que je n’existe pas, voilà que je me retrouve sous les artères de Shanghai ; des yeux suivent la scène mais pas les miens, ceux de Philippe. Philippe Rhamy ; l’auteur séjourne dans la mégapole en compagnie de collègues, tous invités à peindre la ville en mots. Pour lui ça a donné « Béton Armé » quant à moi, lecteur, si le métro frappe à ma porte, inévitablement je revois cette séquence, comme détachée du ciel, sous les dalles de Shanghai. La fille et son numéro à la barre, ressuscités d’entre les lignes par la précision, la concision, l’apesanteur d’un texte. La contorsionniste, le public, le vieil homme mais surtout l’inscription que la femme présente à la fin du show tout ça des yeux l’ont vu et l’écriture l’a transposé, fixé ; pour une heure ou des siècles, elle a tiré de l’oubli d’infimes fragments du monde dans lesquels se lisent sa totalité, son unité et sa grâce.
Chargée de sacs nombreux et volumineux, visiblement en surpoids, elle mange un de ces épis de maïs grillé au-dessus d’un chariot de supermarché qu’elle a acheté avant de descendre dans le métro. Elle regarde un grand plan du réseau RATP ; elle ne porte pas de lunettes, sans doute par coquetterie, elle joue de la longueur de ses bras pour tenter de s’y repérer, avec le mini format, elle ne s’en sortirait pas.
Malgré les averses aujourd’hui sur Paris, il porte des tongs et un boubou estival et moderne, imprimé de formes stylisées, aux teintes très claires. Il met dans la rame, où chacun a le regard vissé à son smartphone ou se précipite qui vers une place libre qui vers la sortie sans un regard pour autrui, un air de légèreté et d’élégance. Quand il descend à son tour, c’est comme si une étincelle de grâce s’éteignait.
Le couloir de la rame est étroit. Chargé d’une sacoche à ordinateur, elle en contient un qui n’a rien de portable, il se précipite vers une place qui se libère bousculant une dame restée debout et dans un grand geste pour s’asseoir m’en aurait donné un coup si je ne m’étais collé à mon voisin de siège. De son parapluie dégoulinant, il éclabousse sa voisine d’en face. Il sort son téléphone portable de la poche gauche de son blouson en jean et appelle quelqu’un pour lui dire qu’il sera en retard à la station Reuilly-Diderot où ils ont rendez-vous. En se dirigeant vers la porte pour descendre, il écrase l’épaule de ma voisine d’en face avec la sacoche. Maladresse ou impolitesse ? Par chance, le temps de ce voyage égoïste dans ce transport en commun a été court.
A l’autre bout de la rame, un vieil homme monte. On s’écarte : c’est qu’il est chargé. Valise bombée à roulettes sur laquelle est juché un gros sac. Je regarde mon sac à dos, souris et parie pour la station Montparnasse-Bienvenüe. J’aime bien les paris. Le vieil homme s’approche, ne peine pas à se frayer un passage : on s’écarte. Il s’assoit en face moi. La valise est élimée, le sac, délavé, déborde de bric et de brac. Le vieil homme a la barbe longue, la chemise usée et décolorée, les mains sales et burinées. Des phrases s’échappent bientôt, incompréhensibles, adressées à un interlocuteur imaginaire. On s’écarte, oui...Je descends à Montparnasse. J’ai perdu mon pari…
Sur le quai, une femme-regard. Enlainée en plein été. Chaussons blancs de gymnastique enserrant des chaussettes rouges de laine. Une tunique de velours. Rouge vif. Des gants de laine. Blancs. Et le plus intrigant, par-dessus tout : ce bonnet, de laine et blanc, comme les gants…. Dehors, il fait 37°. Alerte canicule.
Le regard pétille. Elle sourit, les yeux ailleurs, pas dans la rame en tout cas. Jambes croisées sous une robe de coton imprimé. La jambe droite se balance légèrement en appui sur la jambe gauche, sans doute au rythme d’un air joyeux qu’elle se chante intérieurement. Apprêtée, mais sans excès. Légèrement maquillée. Cheveux négligemment relevés. Longues boucles d’oreilles colorées. Visiblement heureuse. C’est l’été.
F4, 8h30. Casquette grise, lunettes aux verres épais, 30 ans. Il se poste debout à côté de moi, passe son badge sur le lecteur, ça bipe trois fois. Il essaie à nouveau. Bip. Bip. Bip. Le refait. Trois bip. Il me regarde, son regard souhaite de l’aide, une explication. Il recommence, bip bip bip. Il fait pfff plusieurs fois. Il dit très fort « cassé ! C’est cassé ! ». Son regard se perd sur le plancher du bus. Je comprends que en lui aussi, c’est cassé. Il attend quelques temps avant d’aller s’asseoir plus loin. Il tousse très fort puis rie. Il revient plaquer sa carte sur le lecteur, quelques minutes plus tard. Un seul bip. Il s’écrie « ça marche » avec une grande joie. Parfois il n’y a plus, dans nos vies, que ces toutes petites réussites.
F 4, 17h45. Allo ? Allo ? Allo ? Oui c’est moi. Ça va ? Allo. Oui je rentre, là. Allo Tu sais que papi est à l’hosto ? Allo, Tu as entendu ? Tu sais que Papi est à l’hosto ? A l’hôpital. Oui Bah il avait du sang qui sortait de labouche. Oui. Mmm. Je sais pas. Non j’en sais rien. Pourtant c’est ma soeur et elle m’a pas donné son Facebook Non mais tu vois le genre ? Allo ? Le jeune type referme le clapet de son téléphone d’un coup sec, vexé, et regarde, mine de rien, autour de lui, pour vérifier l’absence de témoins à cette petite humiliation que représente le fait de ne pas pouvoir finir une conversation téléphonique. On dirait que c’est plus grave, là, tout de suite, que d’avoir un grand père qui a du sang qui lui sort de la bouche. Il porte des chaussettes Tex Avery : c’est Droopy qui se tient la main appuyée contre un mur. Sa vie m’a éclaboussé, je m’imagine le grand père, la chambre, la chemise de nuit, le visage ridé, les tuyaux dans le nez.
F4, 18h30. Un punk, la quarantaine, monte avec une poussette dans laquelle dort paisiblement un bébé de quelques mois, une fille. Il est agité, nerveux, tremblant. Il manipule la poussette, comme si elle était bourrée d’explosifs. Lunettes de soleil à montures blanches et verres jaunes polarisants qui ne s’accordent pas du tout avec le reste : cheveux rasés sur les côtés, crête, blouson en cuir sans manche, « Antisocial - Nuclear Death terror » en lettres capitales blanches dans le dos, avec masques à gaz dessinés à la main, t-shirt blanc sale , tatouages : une étoile d’araignée sur le coude, un as de pique sur l’avant bras, les lettres PUNK sur chaque doigt de la main, un coeur qui palpite sur un biceps, jean noir serré sur ses jambes trop maigres, sneakers adidas blanc et noir. Il est voûté, pas sûr de lui. On dirait qu’il est déguisé ou qu’il a décidé de devenir punk la semaine dernière. Un punk des campagnes, un punk pas très crédible. Il est accompagné d’une femme qui n’est visiblement pas la mère du bébé. En bougeant dans tous les sens, tous les clous de son gilet viennent à tour à tour cliqueter et tinter contre la barre du bus. La femme qui l’accompagne, assise pas loin, le regarde s’affairer avec la poussette et s’en amuse : « Mais c’est quoi tout ce trafic que tu fais ! » On se regarde toutes les deux, en souriant. Encouragée , elle éclate de rire en disant « Mais c’est dingue ! » Le type n’en profite pas pour se détendre, reste silencieux et appuie alors fébrilement sur le frein de la poussette pour bloquer enfin cet engin de malheur. Il est en sueur.
Des papillons dans les oreilles on dirait. Ce sont des poils et on ne voit que ça. Bien rasé pourtant. Mais il est vrai que le rasage n’implique pas forcément la netteté des oreilles qui elles ont choisi de rester floues. La serviette sous l’aile, les yeux sursautant comme à la recherche du verbe et de sa conséquence. Mais rien ne se passe, hormis le tremblement sec de la main posée sur le strapontin replié.
Les sacs à dos du troupeau de louveteaux s’écrasent contre leurs propriétaires qui s’entassent autour de la poussette. En-dessus, coincés entre les fesses du bébé et les petites roulettes, une bouteille d’eau gazeuse, un sac de litière végétale, le livre d’un auteur à succès, à la couverture froissée. Je ne suis pas le seul à être sensiblement gêné par le couteau suisse planté dans le melon.
Le gamin gratte sa main droite couverte de TippEx avec la lame d’une paire de ciseaux jaunes qu’il tient dans l’autre main. Il en met partout sur le siège où il est assis. La vieille dame debout en face de lui fronce les sourcils. Elle lui dit quelque chose qui est noyé dans le brouillard. Il lui jette un dernier coup d’œil puis se lève et traverse le wagon en regardant par terre. Il lève la tête au moment de passer devant moi. Je crois qu’il va me parler mais je me trompe. Il prend place un peu plus loin, devant la vitre avant du métro automatique.
C’est d’abord le chien à ses pieds – muet terrible, indifférent –, oui, c’est lui d’abord qu’on voit : le type assis qui le tient d’une main lui ressemble, pareillement indifférent, superbe même, de l’autre côté de nos vies ; il parle doucement à l’homme qui l’accompagne, lui dit ne t’inquiète pas, mais l’autre, désespéré hurle : vite, maintenant, allez, alors le type, immenses cheveux noirs noués au-dessus de la tête, inhale longuement la pipe en plastique, et doucement, va la tendre à son jeune compagnon désespéré, et les yeux ailleurs, lui dira prends en nous regardant dans les yeux, nous qui à l’opposé, observerons la scène de terreur, immobiles jusqu’à ce qu’ils descendent de la rame aux Arts et Métiers ligne trois et qu’ils nous laissent avec le caillou de krach, dans ce dernier métro qui nous emporte loin de notre station qu’on aura manquée pour toujours.
C’est peut-être l’image de ses mains, rongées jusqu’au sang, que je possède comme un talisman qui me sert à distance pour recomposer tout le corps, les bras tremblés, les épaules et les cheveux perdus sur le visage secoué, la jeune fille qui pleure pleure pleure devant tout le monde et personne ne semble l’avoir aperçue, dix-huit heures sur la ligne treize est une foule ramassée sur elle, et dix ans plus tard je me raconte sa légende lentement pour moi, comme je me la suis racontée pendant les deux stations que je partage avec elle, à deux mètres d’elle, moi tâchant de rester debout, et elle, assise à même le sol et pleurant, pleurant et hurlant même, comment le savoir dans le hurlement du métro, et je me dis que peut-être parmi tous les lieux du monde où elle voulait être seule pour pleurer, elle avait choisi la ligne treize pour la solitude de cette foule, tous avec la musique dans les oreilles ou le portable sous les yeux, et personne auprès d’elle, elle qui pleure à se briser ; quand je sortirai du métro à la Fourche, elle pleurera encore, visage enfoui sous les mains en sang.
C’est à la fin du jour le plus long de ma vie – et pourtant il n’est pas si tard, la ligne deux est remplie comme chaque soir et je suis si vide de la folie du jour comme je l’appellerai plus tard, ce jour commencé à l’aube et que je pressens s’achever (et avec lui une partie de ma vie), j’échoue sur ce soir comme sur une pierre, tout depuis le matin a fait signe vers moi comme une prophétie, une malédiction, et oh ! que Montmartre paraît loin : au moment de sortir Place de Clichy, mais vers où, je lève les yeux et un type devant moi descend aussi qui me regarde fixement, lentement, terriblement, boucle à l’oreille gauche, casque de cheveux noirs, violence calme du regard, je voudrais le laisser passer, mais non, il attend, il ne sourit pas ; je me dis : c’est un autre signe, son visage que je connais – mais impossible de le reconnaître –, et ce n’est qu’en haut des marches, au moment où je me retourne pour le voir de nouveau que je sais : c’était lui ; soudain évidemment disparu, évanoui dans la ville. C’est bien vrai alors que nous sommes seuls, et je me souviens de ses mots qui scelleront ce jour : Nous n’avons fait que fuir / Nous cogner dans les angles / Nous n’avons fait que fuir / Et sur la longue route / Des chiens resplendissants / Deviennent nos alliés.
Silence. Bruit. Ouvert. Fermé. Seule. Étouffer. Où regarder pour ne pas être vue ? Ne pas être là, dans ce wagon, poser la tête lasse contre la vitre, sale. Je suis sortie du travail à la bonne heure, il y a du monde et le monde se se presse, je n’existe plus, comme elle, en face, fatigue. Elle, moi, nous ne sommes plus rien. Mais lui, il est beau, il est jeune, il est beau, il est plein de cette vigueur. Ce qui m’a quitté, ce qui n’a jamais été là.
S’engouffrer dans le métro, ne pas quitter la saleté, les mains poisseuses, la promiscuité, la crasse quand la peau de mes jambes touchent le strapontin. Maintenant, il n’y a plus que des vacanciers, des vacanciers chaussés de baskets confortables : un jeune homme et une jeune fille, ils ne couchent pas ensemble, non, ils voudraient bien mais rien n’est fait, je le sais, je le vois. Les pieds nus dans mes jolies sandales, les pieds nus qui touchent presque le sol goudronné du quai, le quai qui grouille de rats, j’en vois un, là, embrasse-moi, il fait si chaud. Il n’y a qu’en été que ma peau frôle le tissu qui t’habille, les secousses du wagon.
La ville te manque-t-elle ? A cette question, je ne peux pas répondre. L’homme parle pour être entendu. Il parle fort. La ville me permet de fuir sa voix. Mais je n’aime plus Paris, même si, tu vois, cet instant précis, quand je descends les marches, qu’un souffle de vent vif me saisit au moment où je prends mon ticket, cet instant-là, me manque. Ce qui me manque aussi, voir la ville défiler, la 6. Mais la 2, je ne l’ai pas prise depuis longtemps. Pourquoi ? Je ne sais pas, la 6 surtout. Ce qui me manque, c’est de pouvoir fuir cette voix, ce sont ces deux minutes de répit, fuir les hommes, ne plus les voir ne plus les entendre, j’aime ce que la ville me donne.
Un homme à l’allure distinguée vient d’échapper son ticket. Il plonge son regard dans une marre de pieds, puis pour rester debout, être digne, il s’accroche à une barre métallique. Il parait désemparé. J’imagine qu’il a peur d’être contrôlé. Une main plus petite que sa grande main se pose alors sur la sienne. Je me demande s’il va se dégager de cette petite main. Non, il relève simplement le visage puis ses yeux sourient à ceux d’une petite fille qu’un homme tient dans ses bras.
Il n’y a pas de place assise. Une jeune femme tient un livre. Un marque page dépasse légèrement de la tranche. Son champ visuel lui confirme qu’il n’y a pas de place assise. Elle a été propulsée à l’arrière du wagon par une équipe de rugby à la victoire joyeuse. Ils ont la tête de leur nuit blanche. Elle se retrouve face à un géant, qui la toise avec dans le regard un peu de convoitise pour sa jeune et belle chair fraîche. Vous lisez ? Elle ne répond pas, mais spontanément elle lui montre son livre. Il ne dit rien. Il ouvre alors son sac à dos, remue un short, un maillot, des chaussettes, une bouteille d’eau, et enfin il en extirpe un livre. Le même que celui qu’elle tient à la main. Ils ne disent rien. Elle lui tend son marque page.
Une femme d’un certain âge dit à la petite fille assise à côté d’elle : « Nous descendrons à la Station Notre Dame ». La petite-fille lui demande : « Mamie, Notre Dame elle est rien qu’à nous ou elle est aux autres aussi ? » Je souris. Ma voisine me dit doucement « elle est jolie ».
Des dizaines d’enfants dans le parc pour la représentation d’une pièce. D’un coup, je vois ce petit bonhomme qui se détache du lot et passe devant moi en courant et en criant : « non ! ». Va-et-vient de regards entre la foule d’enfants identiques avec leurs dossards multicolores et l’enfant déserteur. Essayer de trouver la mère en cherchant se visage grimaçant de celle qui ne trouve plus son enfant. Ce corps crispé, inquiet d’avoir entendu les pires histoires d’horreur. Le cauchemar ultime de l’enfant évaporé. Une éducatrice arrête l’enfant dans sa course et le somme de retourner dans son groupe. Le calme revient. #parcFrancoisPerrault
Je fais souvent ce jeu où j’essaie de compter le nombre de personnes dans mon champ de vision, qui ont le nez dans un écran ou encore, le nombre de lecteurs. Un autre flagrant délit de lecture. Que lis-tu ? Comment le déduire à partir d’une phrase ou d’un nom de personnage ? Me tordre le cou pour voir ta quatrième de couverture. Je finis par entrapercevoir que c’est Amin Malouf qui t’accompagne et ça me fait chaud au cœur. J’aime cet auteur. Nous sommes sœurs de lectures. Avant de sortir, je te glisse à l’oreille : « moi aussi ! ». #stationDiberville
Je l’observais en me demandant s’il était un arbre qui ressemble à un personnage ou un humain semblable à un arbre. Cette étrange impression de croisement au détour de chaque grimace d’écorce, creux, déracinement, branches comme des bras ouverts (ou bras ouverts comme des branches). Que le temps de rencontrer sa lumière, comme un appel, avant de continuer chacun nos chemins à travers les lignes horizontales et verticales et les reflets colorés de la Verrière de Marcelle Ferron. #stationChampsDeMars
Avec son bleu de travail, son visage buriné de montagnard et son accent catalan quand il s’adresse à celle que je crois sa fille, il porte un regard pénétrant sur les voyageurs de la rame, prêt à descendre à chaque arrêt ; il se tasse de plus en plus contre la banquette dont elle a relevé les sièges à cette heure de pointe. Il ne peut décidément pas se fondre dans la foule pourtant cosmopolite, son énorme valise verte, tenue par une sangle élimée, se heurte constamment aux jambes de ceux qui s’isolent dans la musique de leur smartphone.
Elle tient fébrilement un cabas à pois blanc où s’entassent des denrées enveloppées du papier chic des boutiques d’épicerie fine, elle a posé un sac à pain en plastique blanc sur le siège côté vitre. A tout moment, elle le serre contre elle comme si l’odeur ne suffisait pas à prouver qu’ils sont bien là, les deux grands pains bios du marché Raspail. Un vieil homme vêtu d’une saharienne beige l’attend sur le quai porte d’Italie, je n’ai pas le temps de lui rappeler qu’elle a oublié son pain, ils échangent un baiser digne de Doisneau .
Elle regarde avec insistance le petit griffon bichon qu’elle voudrait caresser ; lui recule comme effrayé par ses nombreuses bagues dorées. Malgré ses difficultés d’élocution , on comprend qu’elle a rendez-vous chez le médecin à quatre heures pour se faire ôter une écharde à la main gauche. Son bermuda bleu ciel et son t-shirt à petits motifs fleuris paraissent désuets comme les énormes montures rouges de ses lunettes de soleil. Son accompagnatrice l’a laissée engager le dialogue avec les passagers bienveillants qui l’entourent.
La femme monte toujours au même arrêt à côté du supermarché, essoufflée et déjà suante, même si encore et pour peu, le parfum cache encore l’odeur âpre d’un corps échauffé, un corps dont on ne reconnaît plus les contours parce que bouffés par une chemise qui croit –naïve qu’elle est – pouvoir donner le change et sauver la dignité de la personne qu’elle recouvre ; le sac besace aide la chemise à dessiner le réel et se désole de ne pas grossir aussi vite et fort que sa propriétaire ; de minuscules écouteurs coulent des oreilles comme deux larmes craignant à tout instant l’écrasement par la main potelé ; les pupilles dans les yeux fouillent l’espace du car et avisent le siège voisin du mien, elle fraie chemin et s’installe, compresse par les plis de ses chairs mon pauvre corps qui hurle contre ma négligence : avoir laissé un siège vide à mes côtés.
Tout le monde s’est réjouit : on a vu la belle bleue, verte ou rouge, le bouquet final et on est ressortit vivant ; la garde sillonnait parmi les corps allongés sur les copeaux, l’hélicoptère veillait dans les airs ; on est ressortit guidé par le flux, bien orienté, le métro est gratuit, les directions de stations écrites en noires sur fond jaune et visible du haut de chaque station ; oh ! Immortaliser la foule sur fond de pancartes inhabituelles – améliorer l’angle de prise de vue, reculer, bousculer la personne qui gêne, se reculer encore, saisir l’instant – la femme ne s’est pas vu heurter l’armes d’un de ces CRS rassurants, et souriant de cet inconscience ; au même moment, Nice sombre dans l’horreur.
Temps grisâtre sur Paris en cette mi-décembre, s’en retourner vite à la voiture qui nous ramène au tiède de la banlieue ; voir clignoter les ailes rouges et se rappeler le choix du CE de valoriser la culture scintillante du Moulin Rouge ; en face une colonne Morris abrite une femme indienne et ses deux petits enfants, garçon et fille, qui organisent cartons et tissus pour traverser le froid de la nuit descendante, d’une manière très paisible, comme évidente ; souvenir du Brésil, avec sa pauvreté côtoyant la richesse dans une indifférence totale.
Je monte dans la rame et suis comme attiré par cette jeune fille assise sur ce fauteuil orange, emblème des années 80. Penchée sur ses cours, elle ne lève même pas la tête alors que je m’assois en face d’elle. Je lis en même temps qu’elle parce que déchiffrer à l’envers ne me pose aucune difficulté. J’essaie de deviner de quelle matière il s’agit. Pensif, je tente de construire son histoire, sa fac, ses projets.
Bus bondé, journée épuisante. Elle a besoin de monter maintenant mémère avec son caniche !
— Monsieur, j’ai une carte prioritaire, c’est ma place, dit-elle en me plaquant sa carte sous les yeux.
Choqué par son manque d’amabilité, je la dévisage, me lève sans sourire et finit mon trajet debout. Même pas le plaisir de lui avoir cédé ma place.
— Bonjour Messieurs-dames ! Contrôle des billets s’il vous plaît !
Je plonge la main dans ma poche droite pour préparer ma carte d’abonnement. Les deux voyageurs qui me font face échangent un regard déçu et résigné. Je les fixe. Ils tournent la tête vers moi, haussent les sourcils et leurs moues m’annoncent que leur trajet va bientôt s’arrêter.
L’épaule droite appuie contre la vitre du wagon, équilibre acquis pour permettre à la tête de pencher sans trop de cahots. Une chemise effet jean, les manches roulées jusqu’au coude, moule le biceps avantageux. Le visage est serein. Il se repose vraiment, pourtant on ne croit pas qu’il dorme assez profondément pour se soustraire au bourdon mécanique, aux éclats de voix qui ricochent dans le wagon. Il échappe peut-être simplement à la lumière acide. L’usage voudrait qu’on pose le regard ailleurs que sur cette intimité des yeux clos, cette présence pleine à soi, sans s’attarder sur les cheveux ras, la peau foncée, les traits réguliers, la carrure. Au bas du pantalon en vrai jean, des chaussures passe partout, pas de sac — sans doute l’incontournable dans les poches. Les bijoux ne semblent pas occasionnels, une large montre blanche au poignet gauche, légèrement écaillée, sur l’autre, une gourmette en métal brossé, un bracelet de cuir tressé. Sur les genoux, son livre épais est resté entrouvert, la tranche gondolée par une ancienne humidité, le papier grisâtre. Un livre précieux par son usure même ? Il me semblait, tout à l’heure, le consulter plutôt que le lire. On sait qu’au terminus on lui toucherait le bras s’il était tombé au delà de la somnolence. Ça ne m’aurait pas déplu de prendre cette responsabilité.
Juste avant de parvenir à sa hauteur, je perçois la légère déviation du flot qui impose à la marche son rythme, on va le contourner juste avant de s’engager dans l’escalier d’accès au quai, le regard note, au-delà de lui, derrière la vitre, l’arrivée du train, déjà le crissement des freins, il tire sa jambe hors de son pantalon. Je l’ai dépassé, suis sur la première marche de l’escalier. Je me faufile dans l’autre sens. Il est maintenant sur un genou, il enveloppe sa prothèse d’un tissu sombre, la pose sur une grande valise, cherche dans un autre sac. L’acrobatique quotidien. Préparatifs. Autour, le flot continue d’enregistrer son occupation de l’espace au sol. Il n’a pas besoin d’aide, il ajoute quelque chose, son visage est large, ses lèvres charnues, une repousse de barbe. Je distingue son timbre grave mais n’entends pas. Idiote. Je le revois un autre jour au même endroit.
Il pleut une concentration insensée de gouttes fines, les essuie-glace font sursauter le tracé complexe des voies qui ne cessent de se resserrer et se déporter. L’attention tendue vers ces lignes au sol, déchiffrer, confirmer avec les flèches suspendues, anticiper les trajectoires. Un type jaillit au carrefour, il lance chaque pas énorme sur le bitume comme s’il gravissait des rochers et rebondit, les bras dansants. Grisonnant, maigre, un jean gris sur ses longues jambes élastiques, une doudoune noire luisante de pluie et les mains libres, les yeux regardent droit vers quelle immensité, il ne cèdera rien à la planitude de la ville étriquée qui ne fait que passer sous ses pieds.
[3] Jacques de Turenne
[4] Marion Lafage
[5] Jérémy Ejyerm
[6] Milène T.
[7] Cécile Camatte.
[9] Didier Austry
[14] Philippe Sahuc
[15] Françoise Durif
[16] Annick Nay
[17] NatLab
[19] Vanessa Morisset
[23] Marie Barthélémy
[24] Béatrice Dumont
[25] Alex Fern
[26] Marie Michel
[27] Anne Klippstiehl
[30] Véronique Séléné
[32] Felismina
[35] Christiane Deligny
[38] Emmanuelle Cordoliani
[39] Will
[40] H. B.
[41] Géraldine B.
[42] M.
[43] ana nb
[44] B F
[45] Claire Ernzen
[47] Odile Cambronne
[48] Dominique Paillard
[49] Sméraldine
[51] MagEsc
[52] Anouk Sullivan
[54] Isabel Jaunet-Perrotte
[55] Cat Lesaffre
[57] Laurent Schaffter
[59] Émilie Marot
[60] Émilie B.
[66] Christiane Mandin
[67] Nicole Begzadian
[69] Valérie Louys
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne et dernière modification le 26 juin 2017
merci aux 3200 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page

