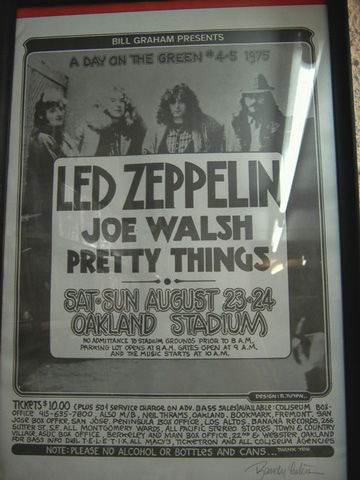
« ce ne peut être que la fin du monde, en avançant »
Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie : c’est Arthur Rimbaud qui invente le rock en littérature.
Comme l’irruption des tambours dans l’enregistrement de In the light à Headley Grange – aphorisme de John Bonham : « Be loud… Jouer fort. »
Écrire lourd, comme Bonham joue lourd, faire un gros livre, où on ait le temps de s’installer, et y convoquer les tambours de la langue. Ne pas simplifier la langue, ne pas se la jouer argot ou popu . Laisser à la grammaire le soin de faire surgir les silhouettes, d’interroger sur les êtres.
Oh, Baby, it’s cryin’ time, Oh, Baby, I got to fly.
Got to try to find a way, Got to try to get away,
On a devant soi les interviews, la masse des témoignages, des photographies existent par milliers (on les a même tout nus – du moins, Robert Plant, exhibant son anatomie, et il l’a généreuse–, ou le même jouant au football, ou Jimmy Page et lui-même traînant leur sac à dos au Maroc, on les a vus en transe sur la scène comme au repos verre en main : mille, deux mille, des milliers de photographies disponibles, mais jamais celles qu’on voudrait). On réécoute les musiques. Il faut décortiquer les carapaces, ouvrir les silences, pour approcher ce qui tiendrait de ce qui tous nous relie : les hasards et le destin, l’arbitraire où parfois on se jette sans savoir ni pourquoi on le fait, et qui rétrospectivement s’avère nous avoir révélé à nous-mêmes. Cette tâche, la littérature y a trouvé depuis toujours son essence ou son terrain, parce que ce qui va d’un être à l’autre c’est le langage, et que sa fonction est d’ouvrir le langage, d’en faire diffracter les transparences, et qu’alors, renvoyant à celui qui l’énonce, elle laisse un instant à cru ou à nu ce vieux mystère humain, qui nous fait marcher avant.
Et ce que Rimbaud fait surgir en trois mots, Départ pour le bruit neuf…, nous faut-il l’entendre dans :
Going, going to Chicago... Going to Chicago...
Sorry but I can’t take you...
Going down... going down now... going down...
Que la littérature aboie, si elle veut s’en prendre au rock, pourquoi pas. Ou rugir comme lui, Plant, ou gémir comme on tire un archet de violon sur les six cordes d’une Gibson Les Paul, ou fasse entendre dans le soubassement des mots les lignes rauques d’une basse mais quoi, dans la langue, rendrait le pied droit et les cymbales d’un John Bonham ? Je n’y crois pas, à l’écriture rock : mon instrument est aussi vieux que le leur, corde frottée ou pincée, ou la voix, ou la percussion, seulement la langue n’a affinité qu’avec la sculpture.
Said there ain’t no use in crying. Cause it will only, only drive you mad
Does it hurt to hear them lying ? Was this the only world you had ?
Ce qu’elle peut et doit, la langue, c’est chercher l’homme. Ils nous donnent peu, pour les rejoindre. Paradoxe avec les quatre musiciens du Led Zeppelin, qui ont dressés une forteresse autour de leurs secrets. Comme le sculpteur tâchant d’attraper la nuque ou le dos du modèle, leur façon à distance de chercher la proportion entre le pouce et l’index. Vieux métier, comme le leur.
Un coup de ton doigt sur le tambour décharge tous les sons et commence la nouvelle harmonie. J’ai le fac-simile des Illuminations d’Arthur Rimbaud où cette phrase est copiée de sa main, sans rature. C’est un texte de cinq paragraphes, chaque paragraphe formant proposition complète, sans aucun lien possible avec ce qui le précède ou le suit, sauf ce tutoiement (ton doigt, puis les enfants te montrent, puis au milieu : Ta tête se détourne, le nouvel amour ! Ta tête se retourne ; le nouvel amour ! Ainsi sont venus aussi à la littérature les tambours.
Chez Rimbaud, si on commente on rabaisse tout : on manque ce à quoi, précisément, la phrase s’est arrachée : « Silence au raisonneur », c’est l’injonction d’Une Saison en enfer. Est-ce que le rock peut prétendre venir à ses rivages avec ce qu’il chante :
Talkin’ ’bout love
Talkin’ ’bout love
Talkin’ ’bout love
Oh, I can’t stop talkin’ about love.
Une littérature qui mimerait le rock s’effondrerait sous ses clichés. Pour Led Zeppelin, rien que des visages de gamin, tout lisses (même l’année où porteront la barbe, en 1971 : des gamins qui voudraient se vieillir).
On approche le bloc, on le mesure. On va le tailler, parce qu’il y a, dedans, ces profils, et ce qui doit bien nous enseigner, si on s’est autrefois reconnu dans ces musiques, qu’elles nous ont chacun formés. Peu importe l’ordre ou bien de mêler les noms et les dates. Leur musique se présente d’abord comme masse. On a affaire au compact, au non divisible. Il faut laisser les éléments s’organiser depuis leur propre loi, et comme dans la mémoire ils s’organisent.
Bloc ? Bloc brut d’expérience humaine aux limites. Quatre types de vingt ans poussés à bout, mais précisément à l’endroit du plus grand désordre du monde, où se rejoignent les lignes de fracture. Et l’un y restera épinglé, mort bouffi dans du vomi.
Je regarde des photos récentes des Zeppelin réunis : les cheveux blancs de Jimmy Page sur un visage rond, ou John Paul Jones affichant ce sourire un peu satisfait, et Plant les cheveux encore longs, mais chaque bouteille bue une ride creusée : et soi-même ? John Bonham, en disparaissant à trente-deux ans, appartient lui seul pour toujours à l’adolescence, comme Rimbaud lui-même, via son départ.
Trying to find, trying to find where I’ve been.
On est debout face au bloc, on a tendu la main, on en éprouve la surface, et son propre visage aussi. Des visages de vingt ans, sous sa propre peau aussi.
Led Zeppelin : le seul groupe dont, à réécouter les disques connus par cœur, il m’arrive si souvent de n’écouter que la batterie. Le mystère de cet appui en avant, du double coup de pédale sur la caisse basse (pourquoi dire « grosse caisse » quand eux disent bass drum ?), et même ce mime parfois de la voix, dans les dégringolades des toms, ou surtout cette manière de laisser le temps ouvert. Comme si lui harassant les trois autres, John Bonham. Les marteaux du dieu, Hammers Of The God, chante Robert Plant dans Immigrant Song, ou bien ce chien noir, Black Dog, aux trousses de Jimmy Page et ses guitares, ou Trampled Under Foot, foulé aux pieds, pour ce qui le batteur qui les sous-tend, et No quarter, pas de quartier, pour John Paul Jones, artisan aux claviers sur les disques, écrasant les notes de basse sur la scène : rien que de très primaire, juste le quatuor (comme on dit en lutherie : « les instruments du quatuor », mais ce ne sont pas les mêmes).
Nous venons des pays de neige et de glace
Du soleil de minuit le printemps souffle brûlant
Le marteau des dieux conduit notre navire aux nouvelles rives
Pour combattre les hordes qui hurlent et crient : Valhalla, nous voilà
Mieux vaudrait pour toi finir et reconstruire tes ruines
Que gagne la paix, gagne la confiance malgré tout ce que tu as perdu
Rien à voir avec Rimbaud, c’est Robert Plant pour Immigrant song, « chant d’un immigrant », début de l’album III, écrit au retour d’une virée en Islande, concert, ballade et retour : les Anglais savent que ces peuples des mers, là-haut, tiennent de la même migration qu’eux-mêmes :
So now you’d better stop and rebuild all your ruins,
For peace and trust can win the day despite of all your losing.
Sur scène, dès 1972, le moment où Page et Jones encadrent Plant sur des tabourets, un capteur scotché près du chevalet de la Martin D 45 pour Page, et une mandoline Gibson à volutes pour Jones, puis voilà Bonham qui complète à l’arrière en ne jouant que des pieds, grosse caisse et charleston qu’il étouffe de la main gauche, attrape ensuite un tambourin de la main droite, mais c’est plutôt pour résister au démon des baguettes démultiplicatrices : sa façon d’être « acoustique » dans Bron-Yr-Aur Stomp ; c’est de se limiter sur l’énorme batterie au seul jeu de pieds (et donc, par rapport au même morceau en concert trois ans plus tard, être passé aux castagnettes : chaque morceau, si compliqué qu’il soit, on le garde identique à lui-même et construit une fois pour toutes : qui souhaiterait que change quoi que ce soit aux cinq riffs successifs du solo de Heartbreaker ?).
Ailleurs, dans Rimbaud, encore les tambours : Une école de tambour faite par les anges.
Et John Bonham : « Pourquoi j’aime jouer ? Sur scène, tu es au-dessus du vide, tu joues sur le vide. »
Et comment on peut sur eux construire une vie, quand bien même elle sera tellement plus brève que la mienne. Vomir inconscient après trop de vodka, cela m’est arrivé pourtant aussi : ou bien est-ce même à cause de ça ? On n’entre dans un récit que lorsqu’il rouvre vos plaies personnelles. On n’écrit jamais sur les autres, on ne peut écrire que de soi.
Si la littérature a besoin des tambours du rock, c’est pour les vies qu’elle lui permet de dire, ou que le monde tel qu’il est nous force à dire, et que c’est encore sur soi-même que cela nous renseigne, pour l’excès justement qui nous a délaissés, les a pris eux et nous a seulement concédé d’en faire nos miroirs.
Light, light, light, in the light
Light, light, light, in the light, ooh, yeah
Light, light, light, in the light
Il n’y a pas de littérature rock. Il y a entrer, avec la littérature aussi, dans les principales secousses du monde, et chercher. Et tant pis si les fissures vous contaminent.
Ce ne peut être que la fin du monde, en avançant : c’est ce qu’il disait, déjà, Rimbaud.
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne et dernière modification le 30 juin 2013
merci aux 906 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page

