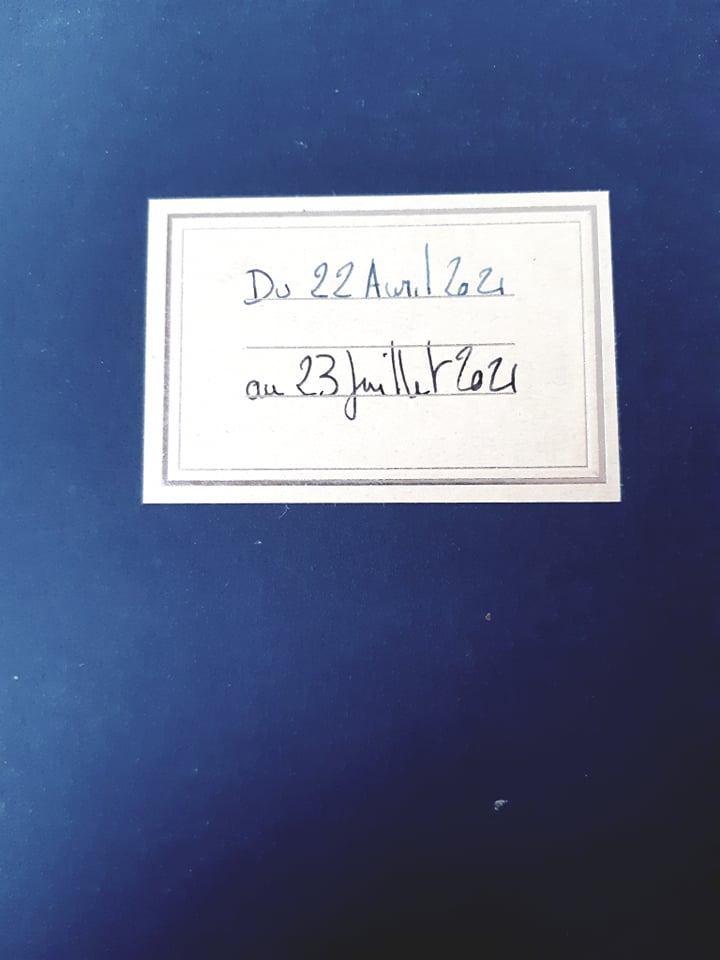
Dimanche : La rue comme à Ostende. Magasin de gaufres et de glaces à l’angle. Pavage moche. Le soleil (trop). C’est drôle : c’est une belle journée, mais cette ressemblance fait un affreux décalcomanie de ce qui n’était pourtant qu’un léger malaise, à Ostende. Là-bas aussi c’était une belle journée. Ce n’est donc pas la question de ce qui e passe, mais bien d’où, d’où ça se passe. Les enseignes toutes également insipides qu’on croise dans toute l’Europe piétonnière agacent. Mais ce n’est ça. Le mal vient de plus loin. La structure des rues reconstruites sans Perret et sans esprit. Pas un fantôme pour errer dans ces couloirs glacés même quand la sueur coule dans le dos tellement il fait lourd. On ne traîne pas.
Sur un banc, je fais mes révélations sur l’avancée du Sérail. Vie de geek dans un univers monolinguiste de 175 pages. J’ai l’impression de découvrir des secrets dans mon propre texte. Quelqu’une d’autre doit écrire la nuit, quand je m’endors sur la montagne de graines à trier avant l’aube.
En repassant dans le coin d’Ostende, une femme entrevue beugle, jean coupé flottant sur son corps d’os, les fesses maculées d’excrément. Jeune et sans âge. Le crack. 20 min d’effet maximum.
Lundi : La maison est vide pour 36 h. Je n’ai pas de téléphone. Tout peut arriver. C’est aussi ce que disait la pianiste Irène Haïtoff, qu’on appelait « la veuve Mozart » : j’ai 93 ans et je suis vierge, mais je prends le métro, tout peut encore arriver. J’ai l’impression qu’elle m’a rendu visite. Je range la théière.
Dehors Madame Godot attend sous la pluie, près de la grille du passage, hoody jaune fluo et béquilles. Elle ne crie pas à l’adresse de son frère. Elle doit sentir que personne ne peut l’entendre sous ce déluge. Elle est de dos, mais je peux sentir une forme de perplexité. C’est seulement en écrivant ces lignes que je m’aperçois que je ne lui ai pas proposé d’entrer.
Mardi : Acheter le premier tome d’une série de Shimazaki, c’est mettre un pied dans l’enfer du jeu à Macao.
Mercredi : Théo est mort. Fermeture de nos points de vente dès 15 h. C’est un ordre national. L’atmosphère est très douce dans la boutique de Valenciennes. Les employé.es peinent à se sentir affligé.es. C’est si loin, l’échelle nationale.
Jeudi : Je ne dors jamais l’après-midi. Ni dans les trains. Ou alors dix minutes, « à la petite cuillère ». Je lis dans la grande lumière de la chambre. Le silence est moelleux comme ces gros édredons en duvet d’oie que j’utilisais à l’adolescence comme oreiller dévoreur. Je suis allongée sur le côté avec Zakuro, le tome deux, une fumeuse d’opium. Je me réveille dans la même position, deux heures plus tard, le livre dans la main, ouvert un chapitre plus tard.
Vendredi : Place Saint Nicolas, il y a une fille qui parle trop. Les cheveux coupés ras, blond peroxydé, percée de toutes parts. Peut-être pour ça qu’autant de paroles sort d’elle. La parle, elle essaie tous les trous avant de sortir par la bouche. Elle pollue, je n’ai plus l’habitude du bruit. Je voudrais prendre un café en paix comme la femme de Stéphan Eicher. Elle parle sans s’arrêter à un type roux qui l’écoute vraiment. Elle est connue dans ce pub. Le serveur lui touche le crâne en disant quelque chose d’affectueux. Je la regarde mieux. Je pense à La Blague du Viol. Je pense qu’elle est jeune. Je pense que les femmes sont du côté de la parole. Elle a des yeux bleus et un survêtement. Je me souviens que je suis du côté des femmes et de celui des mômes. Même si je suis aussi un professeur de province qui dit cinématographe. Au moment où je lâche, elle s’arrête et le type roux prend la parole plus tranquillement.
Samedi : Les courses le soir. Un plaisir de connoisseur. À la caisse, un type accompagné de trois sacs d’engrais et deux packs d’eau semble avoir mal pris d’arriver après nous à la caisse. J’étais déjà engagée et A. suivait avec le caddie. Le gars ne m’avait pas vue. A. m’explique ça alors que nous rangeons les provisions dans le coffre. Sa mère a été obligée de lui dire de se calmer, précise-t-il. Ce n’était pas sa mère, c’était sa femme ou sa sœur. Comment peut-on voir si bien certaines choses et pas d’autres ?
Dimanche : Marcher autour du lac. Aller là-bas en voiture et puis faire tout le tour. Voir les cormorans qui sèchent, les cygnes gras comme des pavlovas prendre leur envol en défiant les lois de la gravité. Entendre tous les répons des marais et des bois. Frissonner en se disant pour la centième fois : c’est une mine effondrée. Avoir le vertige au pied du chevalet Ledoux. Sourire en disant pour la centième fois : ton arrière-grand-père à la mine et toi à l’aquarelle et au fusain. Marcher d’un bon pas, chacun à son rythme. Prendre un café avec les libellules. Y penser tout le matin. Ne pas le faire l’après-midi. Comme si j’y étais.
est ce que nous sommes tou.tes e quête d’échos dans nos journaux ? reste que je n’ai jamais pu/su faire la sieste, et si je cède je le paye cher… sinon la place Saint Nicolas dont tu parles c’est celle que je crois ?
Le journal c’est la chambre d’échos par excellence. Place Saint Nicolas, à Valenciennes.
j’irais bien « Prendre un café avec les libellules. » et lire l’entièreté de tes carnets merci
C’est OK pour le café, Cécile, si tu passes par le Nord. Pour l’entièreté des carnets, c’est sûr que non. Mais ta curiosité les honore et moi avec !
Rétroliens : #L9 | Féérie perpétuelle – Tiers Livre, explorations écriture
Rétroliens : #L9 | Féérie perpétuelle 2 – Tiers Livre, explorations écriture