#8- Reconstitution – Le voyage obligé
Des camions militaires qui se suivent comme des chenilles processionnaires sur une route sèche et caillouteuse — presque une piste — ils quittent une ville dont le nom berbère signifie « plaine gorgée d’eau » — Louis-Napoléon Bonaparte donne un autre nom à cette ville — les camions roulent à la vitesse des camions militaires des années 40 vers une autre ville, l’autre ville où a été construit un camp — un camp d’accueil si on peut dire, un camp d’internement — Louis-Napoléon Bonaparte signe les décrets avec une plume d’oie qu’il trempe dans l’encre noire — les nomades arabes portent des savates — le camp de Bedeau doit son nom au général Marie-Alphonse Bedeau 1804/1863 — c’est une traversée de 90 km qui ondule entre plaines et collines — le camion sursaute en continu — le paysage défile à l’envers, à l’arrière du camion — les collines sont vertes sur fond de poussière — ça sent le pin et l’eucalyptus — jusqu’au camp — le camp est l’œuvre de l’armée française coloniale — parcours incertain — ils sont plus d’une centaine entassés dans des camions militaires qui se suivent à la queue leu leu sur une route abîmée par le vent et la sécheresse — l’armée française coloniale n’a pas encore bétonné la route — c’est une piste qui relie ce que fut un village à un autre village — le village d’où il vient est une ville coloniale — la légion a construit une forteresse pour accueillir ses bataillons — les colons habitent la place forte — les indigènes ailleurs dans des quartiers où pourrissent des viandes écorchées — un homme tousse ou bien c’est toi — l’air abîmé par des routes de terre — des femmes portent des cabas, elles fléchissent sous le poids des sacs, sous la lourdeur du ciel et du désespoir, elles regardent partir les hommes — un parcours cahoteux caillouteux — un sale voyage obligé — « la Marseillaise » est remplacée par « Maréchal nous voilà »—des espadrilles, il fait très chaud le cuir de la peau fait semelle — des copains on s’en fait solidaires dans ces cas-là — on n’est pourtant pas des chiens — un gourde en fer blanc un stylo un crayon le carnet dans la poche — c’est tape-cul ça la route — le gouvernement de Vichy fait la chasse aux juifs dans les territoires coloniaux — je ne suis pas une indigène mais je suis ce convoi infâme sur cette route poussiéreuse qui fait tousser les hommes — je suis ton invisible —
#7- Le tout petit voyage – Les petits voyages de fin de semaine

Jamais nous ne passions nos fins de semaine à Paris.
Dès le vendredi, ma mère rassemble les affaires, vêtements et victuailles pour nous 5.
Le samedi nous embarquons. Nous allons parcourir quarante kilomètres, je vais vivre mon cauchemar hebdomadaire, peut-être mes dernières heures.
– L’ascenseur : deux tours pour descendre du troisième étage au sous-sol. Mes frères, mon père l’empruntent d’abord, ils emmènent quelques sacs (les sacs, ça énerve mon père). Le chien, ma mère, et moi attendons le renvoi de l’ascenseur. J’intègre ce qu’est ma place au féminin, les gars d’abord.
– Le garage au sous-sol : la 404, est garée au sous-sol dans un garage à porte basculante dont mon père a la clé. Il se gare toujours en marche avant, le coffre est donc accessible le samedi matin.
– La manœuvre : complexe et délicate. L’immeuble est construit sur le principe de l’optimisation : un maximum d’emplacements dans un minimum d’espace. Il faut jouer serré pour sortir du garage. D’autant que la lumière est intermittente. Allumés, les phares éclairent le mur du garage. Mon père a 3 minutes pour braquer. Un des frères aide à la manœuvre, l’autre rallume la lumière.
– Mon frère aîné s’installe à l’avant. Privilège de l’âge et du sexe. Mais on dit que c’est la place du mort. Il prend le chien à ses pieds.
– Sortir de Paris : on accède à la Porte d’Italie en empruntant le boulevard Brune ( mon père préfère passer par l’avenue Brancion que par le boulevard Saint-Jacques). Le ciel est gris. On croit qu’il fait gris. C’est déjà pollué mais je ne le sais pas.
– Nous gagnons la nationale 7 après une succession d’arrêts et de démarrages liés aux embouteillages, à la multitude des feux, aux freinages de dernière minute. Le ton monte dans la voiture avant même d’avoir atteint la Porte d’Italie. On s’énerve. Il n’y a rien de fluide dans ces voyages de fin de semaine. Charles Trenet a chanté « On est heureux nationale 7 ». Route mythique, route des vacances, moi, le samedi matin, je me demande si je ne vis pas le dernier jour de ma vie.
– Mon père conduit comme il gère son travail : dans l’urgence, l’agacement, l’impatience. Il fonce. Les bourgs se succèdent plus ou moins rapidement. Le Kremlin-Bicêtre, Orly, (le plus beau passage, à cause des avions qui volent très bas au-dessus de la route. Je vois leur ventre bombé, je voudrais être dedans), Villejuif, Juvisy, Savigny, Viry, Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronne, une succession de villes en Y. J’ai le nez sur mes chaussures. À Corbeil Essonne, on quitte la N7, on s’engage sur une autre route, une route à trois voies bordée de platanes, ces assassins au garde à vous, responsables dit-on, de tant d’accidents. Les moucherons / essuie-glaces/ platanes/ double/la ligne jaune/ Klaxon/les moucherons/ platanes /double/ essuie-glaces /platanes/ connard. Il appuie sur le champignon mon père, il double et se rabat en queue de poisson. Ligne jaune continue ou pas, obstacle en face ou pas, pas de temps à perdre. Personne ne dit ou ne contredit.
– Le destin décide que j’arrive saine et sauve à destination.
– Le dimanche soir, je m’en retournerai à Paris avec la même appréhension. Dans la voiture, selon les saison, ça sent pommes, les fleurs. Ça sent toujours l’angoisse. La circulation est plus dense qu’à l’aller. La perception de l’espace est altérée par les éclairs successifs et éblouissants des phares venant d’en face. Jen’ai toujours pas fait mes devoirs.
- Je conduis. J’ai une voiture. Je me sens en sécurité dans mon véhicule.
- Le samedi, je reste chez moi.
- Mes petits voyages, je les fais, si possible, en semaine.
- J’utilise autant que je peux les transports en commun.
- Il n’y a plus de moucherons sur les routes de campagne.
- Je n’aime pas doubler les camions.
#6- Qui raconte à qui – On brouillonne
On s’arrête. On regarde. On écoute. On se souvient. Il passe en soi des paysages.
- La rue où j’ai eu peur /Une agression. Ça se passait sous un pont, au-dessous d’une route qui fait le tour de la ville. C’est un endroit sombre et puant. Une bande de voyous, des couteaux. J’ai été plus fort qu’eux. Et toi où étais-tu ?
- La rue, les pelures poisseuses d’oranges et de grenades et ce marché qui porte ton nom/ Des rues en terre battue. Un marché porte mon nom ? C’est dans une autre ville. Reprends la carte. C’est dans une autre ville, dans un autre pays. Vas-y.
- La rue, la boutique où tu as marchandé des bijoux, tu ne parlais pas leur langue. Les bijoux, des pierres bleues. Leur nom ? / J’ai été accueilli, je ne parlais pas la langue c’est vrai. Je me suis fait comprendre je crois. Aigues-marines ou lapis-lazuli ? Je ne sais plus, ça n’a pas d’importance. Mais ce n’était pas avec toi.
- La rivière, les bords de cette rivière et les gens sur un banc. / Ils attendaient, il faisait chaud. Ce n’est pas toi sur la photo.
- Les bords du fleuve, ce fleuve large qui force le regard au-delà des trottoirs, ce fleuve qui charrie de sombres histoires. / Ce fleuve je l’ai perdu, je crois je l’ai rêvé. C’est le tien. Je ne l’ai pas traversé. Ou alors…
- Ou alors ? Ou alors que des mots. Tout est faux.
On a tout mélangé. On a rêvé des paysages. On a fait de drôles de voyages. On a tout mélangé.
#5- Hommage à Nicolas Bouvier – Notes
Le jardin des plantes
Comparable à celui que nous connaissons chez nous. Nous ne pouvons pas nous empêcher de comparer les deux jardins. Nous cherchons les espèces rares, nous disons que celui-ci est plus vert, plus grand, moins bien dessiné, mieux traité que l’autre, tiens là pareil. Nous sommes empêchés (pourquoi ?) de le regarder simplement en tant que tel, de l’explorer dans ce qu’il est. Il faut que l’autre jardin, celui que nous connaissons, s’intercale dans cette exploration.
La gare
En chantier. Dans mon carnet de voyage, j’ai noté « travaux monstrueux à la gare. Impossible de boire un café. Les deux distributeurs sont en panne ». Je me souviens de pelleteuses et de bruits de chantier. Tu as dit j’espère que ce sera plus calme après.
Le café du commerce
Même ici, il y a un café du commerce. J’ai noté dans mon carnet « un jour j’irai boire un café dans tous les cafés du commerce de France et d’ailleurs ».
Le chemin du bord de l’eau
Nous avons vu un renard mort couché dans le fossé. Chemin sec et ombragé à une certaine distance du centre de la ville ( j’ai du mal à évaluer). Tu t’étonnes de voir ici un renard.
Le marché aux fleurs
C’est un marché permanent. Il y a beaucoup de monde. Dans mon carnet je relis « nous avons du mal à avancer. Nous voulons tout acheter. Nous ne savons pas le nom des fleurs. Les robes des femmes sont comme ces fleurs ».
Le silence
Dans cette église, juste nos pas que l’on voudrait discrets. Tu regardes la vieille dame qui prie et je ne sais pas si tu es attendri, étonné ou troublé. Tu dis tout bas c’est fou cette ressemblance. Je ne sais pas de qui tu parles.
L’odeur persistante du benzène
A la station de taxis, ça empeste. Nous sortons des kleenex de nos poches. Nous les maintenons sur le nez. Nous avons l’impression de nous empoisonner. J’écris dans mon carnet « la couleur de nos poumons doit être bien aussi noire que la fumée qui s’échappe des pots d’échappement « .
Le chat
Un chat dans un arbre en plein cœur de la ville. Il est posté là-haut, il observe. Tu dis ce chat-là on dirait qu’il médite. Nous le regardons longuement. Nous ne savons plus qui regarde qui, ni quoi. Nous oublions les bruits de la ville, les pas des passants. J’écris «nous n’oublierons jamais ce chat qui nous fascine ».
#4- Halte sur cosmoroute – La couleur des joues
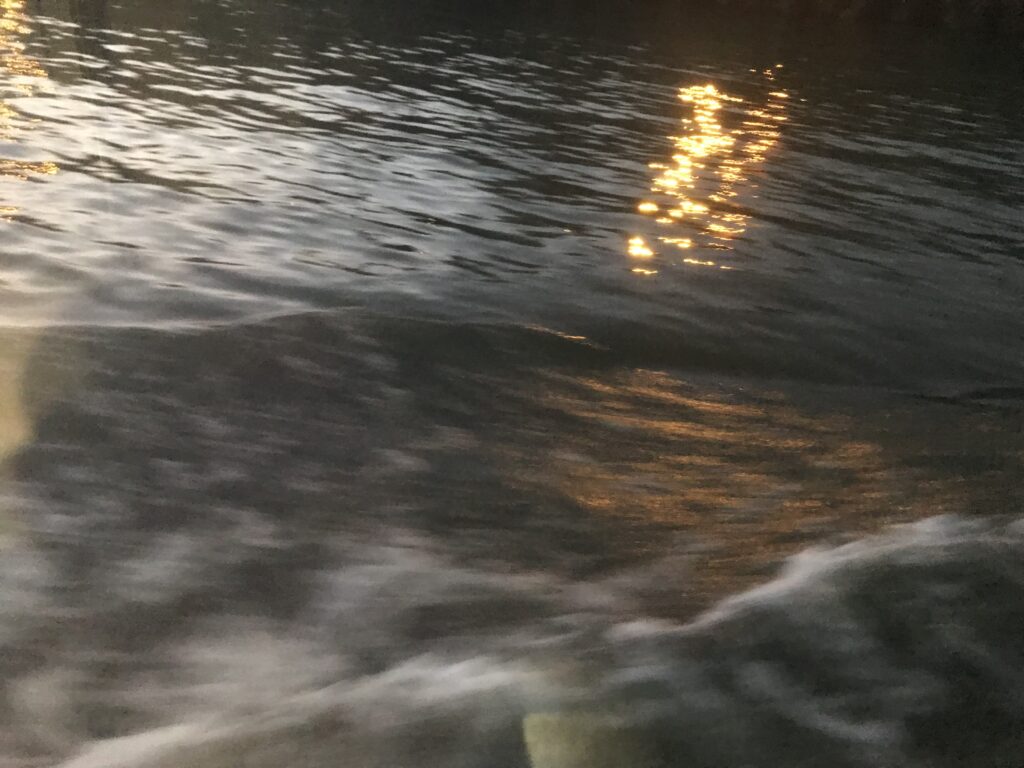
On attend le bateau. Un bateau-bus, un petit bateau qui fait la traversée du fleuve à heures régulières. Nous sommes quelques-uns à patienter sur le ponton. Nous sommes au raz du fleuve et nous pourrions presque toucher l’eau du doigt. Quand on est là à attendre un bateau, on regarde l’eau, les mouvements de l’eau, les morceaux de bois qui flottent, les cormorans (ils sont nombreux), les saletés rejetées par je ne sais quelle usine ( une sorte de mousse qu’on pourrait confondre avec des morceaux de glace), les autres bateaux ( ça circule un peu sur le fleuve), on regarde l’horizon, on guette, on regarde nos montres. J’ai rangé mes deux mains dans mes poches, je tape mes pieds sur le ponton. J’ai froid. Mes oreilles brûlent et piquent. Je sais que mes joues sont rouges. Plus tard tu me dis tes joues sont rouges. Je sais la couleur de mes joues depuis l’intérieur de mes joues. Et je pense à ça en regardant la surface de l’eau, je pense aux couleurs qu’on produit sur nos peaux quand le soleil se lève, quand il se couche, quand il y a du vent, de la pluie. Je pense à ça avec toi en attendant le bateau.
On attend le bus qui nous conduira dans la ville. Nous sommes debout, les rares bancs sont tous occupés. Tu souris sous le soleil et je ne sais pas pourquoi. Nos valises à nos pieds nous regardons passer les gens, les oiseaux, les voitures. Quand on attend un bus dans un pays où le soleil est généreux, on cherche l’ombre, on cligne des yeux. (j’avais bêtement laissé mes lunettes de soleil dans ma valise, je n’envisageais pas de l’ouvrir devant tout le monde). Ton teeshirt bleu corail flotte un peu sur tes hanches. C’est comme si le vent chatouilleux tentait de jouer avec ton équilibre. Tes deux pieds bien ancrés sur le bitume, tu parais solide mais moi je sais combien tu es fragile. Tes joues déjà brunes sont encore plus tannées par le soleil. On cuit ici. Ça manque d’eau.
#3- Michaud, l’impossible retour – Rester au bord
Il y avait des gens embarqués, il fallait faire la queue si on voulait traverser (on pouvait traverser), il fallait une carte quand même, il fallait des repères, il fallait être à l’heure, les bateaux, il n’y en avait pas tout le temps, on avait envie de tout voir, on avait envie de respirer à fond, on voulait ne rien rater mais il fallait de bonnes chaussures, être chaussés au mieux pour marcher sans se blesser les pieds, on voulait aussi prendre le temps, tout voir et prendre le temps, faire vite lentement si c’est possible et les gens continuaient d’avoir des choses urgentes à faire, il y a eu un mariage, et des gens qui posaient devant l’église, des gens qui ajustaient leurs tenues et qui riaient, une pose comme on en voit dans tous les pays du monde quand des gens se marient joyeusement, il y a eu des Klaxons, il fallait de frayer un passage pour traverser la place, on voulait s’en sortir de la noce, c’était joyeux mais pas maintenant, il fallait qu’on avance si on voulait tout voir, il fallait bousculer la foule.
Mais on est restés là, à attendre, fascinés qu’on était devant la scène.
Il y avait des gens sur le banc au bord de la rivière, il fallait se faire une place si on voulait s’asseoir, les gens se promenaient sur le chemin, d’autres, accrochés à leur téléphone portable comme on voit dans tant de pays dans le monde, allaient et venaient, c’était un jour sans travail, une sorte de dimanche d’été, il y avait des enfants qui lançaient des cailloux dans l’eau, qui faisaient des ricochets avec des cailloux comme dans tous les pays du monde, les gens font des ricochets dans l’eau, on pensait (sans doute ensemble au même moment ) à ces cailloux qui se prennent pour des oiseaux, pour des cormorans qui frôlent si joliment la surface d’une eau, on voulait être un oiseau nous aussi, on l’a pensé bien sûr, on sait que quelqu’un qui regarde un caillou atterrir à la surface de l’eau voudrait bien être un oiseau, on pense tous à voler quelques instants seulement et toi tu n’as rien dit, on est restés assis en silence.
On ne pouvait pas parler fascinés qu’on étaient par ces cailloux qui volent.
#2 – Arrivée dans la ville – Vers où va le courant
J’arrive un matin dans la ville. Les rues sont larges, la circulation est intense. Klaxons, moteurs incessants. Une ville qui n’aspire pas à se taire. Les gens vont et viennent et marchent plus vite que moi. Ils ont l’air d’avoir quelque chose d’urgent à faire. Je sens que je freine le rythme des passants. Je regarde peu le sol (du bitume), je suis attirée par ce qu’il y a à hauteur de mes yeux, ou bien plus haut encore. Je marche et longe des immeubles imposants. Je traverse en direction du fleuve. Présence de l’eau et de la pierre, une pierre blanche et friable qui bâtit les façades. Le fleuve, sans violence apparente, charrie du sable et la vase. Des pans d’histoires sur les façades, mascarons sculptés qui racontent un passé colonial peu glorieux.
Les grands fleuves charrient aussi des cadavres.
Je t’emmène avec moi. Je découvre ta ville en regardant tes yeux. Nous prenons un café au café du commerce. On fait danser nos petites cuillères dans nos tasses de porcelaine. On boit un verre d’eau fraîche. On parle de tout et de rien. Comme par timidité. Les rues sont bordées de palmiers, de cocotiers, enfin je ne sais pas trop, c’est exotique. Je te dis ça, c’est exotique et tu ne dis rien. Tu dis que ça a changé. Je ne comprends pas tout ce qui se raconte autour de nous, je cherche un sens. On fait quelques pas sous les cocotiers en ouvrant grand les yeux, on dit pardon aux gens dans lesquels on se cogne. Tu m’emmènes le long de ta rivière. Elle est brune, terreuse, bordée d’arbres. On s’assoie sur un banc.
On a dû regarder l’eau et le courant
#1-LA NUIT D’AVANT peut être un jour
Le vent bouscule les arbres morts, la pénombre s’étire comme un linge opaque suspendu aux néons, on dirait qu’il va bientôt pleuvoir, il n’est pas tard, j’ai le temps d’y penser à cette traversée et déjà des parfums de cannelle, comme si j’étais là-bas et là-bas tu n’y seras pas, je me souviens de t’en avoir parlé et ça t’a mis très en colère, tu as dit que non tu n’irais plus jamais plus là-bas et tu as jeté ta serviette sur la table, on était à table, bousculé la chaise c’est elle qui a eu mal, et tu es parti en claquant la porte fais chier entre les dents, et moi là comme deux ronds de flan, elle dure longtemps la traversée, il n’est pas tard, je regarde les heures, le vent continue de broncher, je ne dormirai pas, je m’étrangle avec des questions, c’est comme si je n’avais plus hâte, le moment où il fera nuit, le moment où le soleil va se lever, je n’aurai pas dormi, je dormirai dans les couchettes d’un train comme on en fait plus, pendant que des avions ratissent le ciel, ça me rappelle une chanson, un dimanche à Orly, car dormir dans un train rend la nuit d’avant tout autant excitante et j’y vais maintenant la traversée sera longue et je rembobine le film qui n’a jamais existé tout comme cette impatience à dormir dans un train, la nuit d’avant est un jour à rallonge, la nuit réveille parfois des émotions fragiles, nos valises en disent long, ma valise est légère il fait doux maintenant je ne dormirai pas, les camions engouffrés dans le cul d’un ferry, et les trains dans les gares, ça fait beaucoup de bruit.
PROLOGUE
Là-bas si j’y suis
+ Une rue de Bedeau, 40 degrés, pas d’ombre, esquinté mes semelles sur les cailloux brutaux et entendu ta voix ruminer sa colère.
+ Un trottoir rue Lord Byron, brouhaha des vendeurs ambulants, marché sur des pelures poisseuses d’oranges et de grenades.
+ Sous un palmier à Cannes, à vous voir tous les deux vous donner rendez-vous sous un soleil de plomb.
+ Une ile aux Kerguelen, pleuré de tout, du vent et de la pluie et de la solitude, à se demander pourquoi.
+ La Passion-Clipperton, tu parles d’une passion ! des crabes rouges qui boufferaient père et mère, une ile qui pue la vase où il n’y a rien à faire.
+ Les comptoirs. Chandernagor et Pondichéry, déjà partie avec les mots.
+ Un temple à Java, dansé aux pieds d’un bouddha.
+ Bornéo, nagé avec des tortues dans une eau transparente.
+ Kazhan, bu de la vodka, fumé une cigarette et jeté mon mégot dans la Volga.
+ La Tour Eiffel, 3ème étage, sans vertige, regardé loin devant.
J’y suis
+ En RDA, le mur, on s’est perdu à Berlin-Est
+ À Bombay, je t’ai regardé jouer les séducteurs
+ Au Piton de la Fournaise à l’aube, la lune, ça doit être comme ça.
+ À Venise, « Fable de Venise » en main, sillonné les ruelles sur les traces de Corto Maltese.
+ À Istanbul, nuit blanche, un chien nous a suivi sur les bords du Bosphore.
+ À Saint-Malo, fallait sortir la tête par la fenêtre pour voir quelques bateaux.
+ À Saint-Ouen, la construction du périphérique devant l’immeuble et les nerfs à deux doigts de lâcher à cause des bruits de chantier.
+ À Neuchâtel, j’avais le bras dans le plâtre mais je pouvais marcher.
+ À Vienne à minuit, pour la nouvelle année, des jeunes gens se jetaient dans le Danube.
+ À Catane, un homme m’a donné une plante grasse.
Très joli ce « là-bas si j’y suis » et « j’y suis ».
C’est vraiment intéressant comment ces courts fragments nous racontent une vie, avec sa singularité. Une peu comme une autobiographie fragmentaire. Il y a le lieu, mais surtout l’intériorité du personnage.
merci de nous emmener, Sylvia, en ces voyages sensibles et emplis d’émotion, merci.
Merci Gwenn, parfois les voyages immobiles nous emmènent loin !
il y a toujours les gens
il y a toujours la fascination
il y a rester au bord
Merci Brigitte, « rester au bord » colle mieux à ma #3, je vous le vole !
beau rythme de ce texte avec le retour aux notes et le tu et j’ai aimé lire à voix haute « nous n’oublierons jamais ce chat qui nous fascine »
Merci Isabelle. Touchée par par cette lecture à voix haute, ce que je pratique plutôt dans ma tête. Je suis sensible à la musique des douze pieds et quand ils arrivent sans que je les invite, je les accueille avec plaisir !
n’ai pas lu à voix haute (il y avait du Bach en bruit de fond) mais aimé les étapes et la mystérieuse ressemblance
Heureuse d’être revenue pour vous lire. Découvrir vos textes en lien avec les propositions 6 et 7 et ce que vous en avez fait, un régal. Merci !
Merci Françoise, fidèle lectrice !
#7 revenir vers toi Sylvia avec cette expérience périlleuse de la conduite dans la capitale
je retiens le comportement énervé du père (ah ah il n’est pas le seul à foncer…) et l’adorable petite phrase de chute « je n’ai toujours pas fait mes devoirs »
Laisser le destin décider, oui bien sûr… alors bon voyage !
Merci Françoise pour ton retour. Comme toi, je voyage, je voyage et je n’ai pas fait le tour des textes en ligne. Je reviens vers cette manne précieuse dès que possible !