Je cours après lui, je le perds, je le retrouve. Il m’échappe, me piège. Je marche en sandales dans cette capitale légionnaire dont les rues ont été pensées d’équerre. Les pâtés de maison sont tristement alignés comme des dominos sur une table. Pas moyen de trouver la courbe. L’atmosphère est sèche et terreuse, sans fantaisie aucune. Quittant l’école Voltaire rue Saint Augustin, j’emprunte le chemin le plus court, celui qu’il a pu prendre pour passer devant l’étude d’un avocat célèbre dont il lit (déjà ) les comptes-rendus d’affaires dans le journal du jour. Je traverse la rue Lisbonne puis le boulevard de la République que j’emprunte en ayant fait un quart de tour sur ma gauche et que je traverse en vitesse. Sa rue à lui est parallèle à la rue Gambetta. Les maisons de ville ne dépassent pas les 2 étages. Les rez-de-chaussée sont occupés par des boutiques dont les auvents sont baissés assez bas. Ils battent par saccades comme des voiles sous les à-coups de la levêche. Face au marché couvert, le numéro 8, à peine visible. Un 8 grossièrement tracé à la peinture blanche sur un carreau de céramique. Je regarde ce 8 sans chercher à comprendre.
#2- la place du fils
Une rue en terre battue. À force de marcher dans cette poussière, les semelles des sandales sont tannées. Les cuirs sont luisants et lustrés. On accède au logement par une porte attenante à la mercerie. Le paillasson, très usé a perdu ses couleurs. Au sol des carreaux de ciment dans une tonalité de gris et de noir. Les mêmes dans l’escalier. Ils forment des motifs géométriques, une répétition sans fin d’étoiles et de volutes. Mêmes carreaux dans l’escalier. L’appartement se situe au deuxième étage – à moins que ne soit au premier. Une entrée minuscule dans laquelle sont alignées deux ou trois paires de sandales. Un porte-manteau cloué au mur. Une pièce qui sert de cuisine, salon, salle à manger, de chambre pour la mère qui dort sur le sofa, mais aussi de passage pour accéder aux deux autres pièces et à un toit terrasse où sèche continuellement du linge. Posée sur la table, une théière en cuivre. La première chambre avec deux lits, pour les jumeaux, une fille et un garçon mais les jumeaux sont les jumeaux, ça forme un tout. Ça ne se sépare pas. L’autre chambre pour le fils aîné. Déjà investi de la puissance paternelle, il dispose d’un espace pour lui tout seul. Dans sa chambre, derrière un épais rideau de laine, le cabinet de toilette. Il a 12 ans. Monté sur un petit tabouret, il se regarde devant la glace. Déjà, il enduit ses cheveux de Gomina.
#01bis – en avant
Souvenir d’un texte étrange qui court sur les parallèles de mon cahier. Souvenir d’un vertige et d’une échappée, d’une ouverture de quelque chose vers quelque chose qui me devance.
#01 – L’obéissance des mains
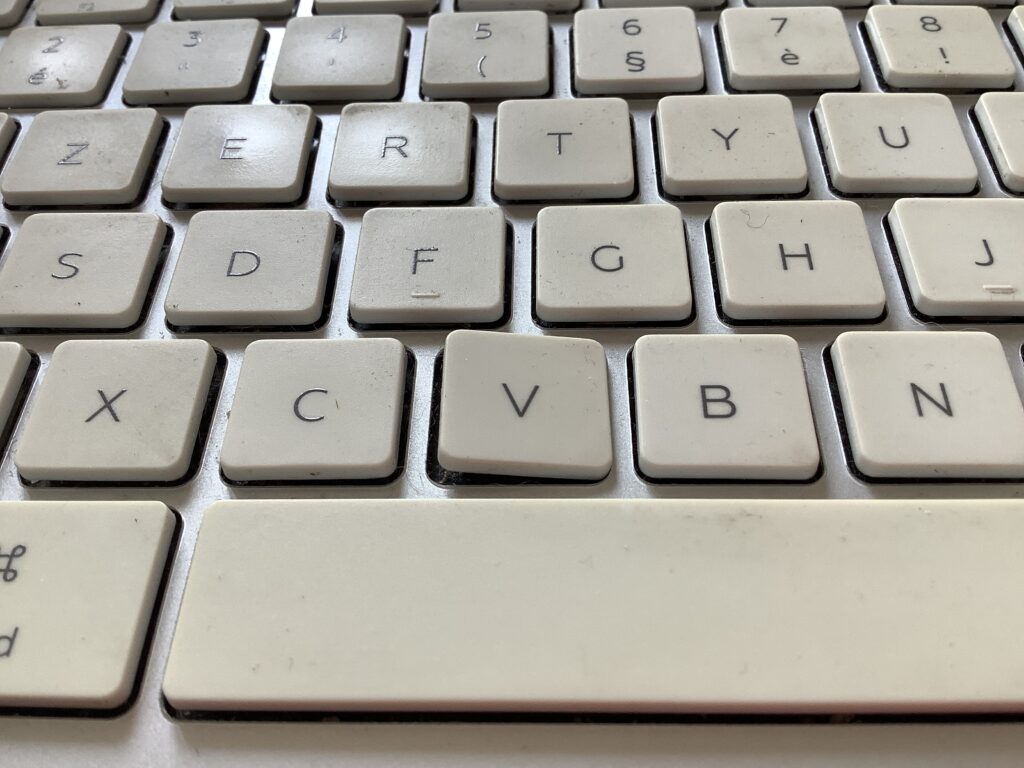
Ce ne sont pas les mains qui décident. Les mains ne commandent pas. Les mains ne pensent pas. Les mains attendent. Quand les mains s’emballent dans un élan incontrôlable, c’est que la pensée dit oui, elle ouvre les vannes. Les mains saisissent le petit carnet, le stylo ou s’en vont pianoter sur un clavier fatigué dont une lettre, le V, n’est pas loin de s’envoler. Les mains redoutent la lettre V mais la pensée insiste, persiste. Et les mains obéissent.
On lutte, on bataille, avec une touche, avec une phrase. On attend aussi. On paresse, on libère les mains.
Et l’on s’en va marcher pour faire du vide et le remplir. On longera un ru ridicule, on déambulera dans la ville. On oubliera le paysage, ou on s’en nourrira.
On ne quitte pas le petit carnet et on note des phases, des mots. On achète un autre carnet. On oublie son stylo. On écrit debout, en marchant. On sait qu’on a besoin d’un cadre mais les limites sont perméables. On n’est pas dupe. On écrit dans la solitude, de l’intérieur de soi mais jamais isolé. On écrit assis sur une chaise, dans l’inconfort quand ça fait trop longtemps. On n’écrit pas dans la colère mais on peut écrire la colère. On écrit au repos ou dans l’effervescence. On écrit sur des feuilles volantes, sur des brouillons. On entasse des feuilles de papier qui peuvent servir encore et on écrit au dos. On écrit en lisant. On écrit ou on n’écrit rien. On pense ou on s’endort.
Les mains patientent. Elles attendent le signal.
#00 – Ligne de fuite

J’étais une vieille ado. J’attendais quelque chose. Je ne savais pas que c’était un livre, je ne savais pas que c’était ce roman. Je ne saurais dire ni comment ni par qui il m’est tombé entre les mains. C’est pas rien ça un roman qui surgit dans la vie d’une vieille ado en quête de quelque chose, un roman qui va venir taper pile poil au bon endroit, tout juste au bon moment.
Je l’ai dévoré avec l’avidité d’une ogresse. Tout collait parfaitement. Il racontait ce que je voulais entendre, ce que je souhaitais nécessairement entendre. J’ai souligné des phrases au stylo, j’ai coché des paragraphes au feutre rouge, j’ai écorné des pages. J’ai salopé l’objet parce que je vivais intensément les mots de ce roman.
Il m’a suivi partout.
Il y a peu de temps, j’ai retrouvé ce livre, et redécouvert les traces que j’y avais laissées. Une couverture très abîmée, des pages qui ont pris, et pour l’éternité, l’odeur et la couleur des fumées des cigarettes. Il a vieilli comme moi.
J’ai d’abord relu les passages énergiquement cochés, des passages sur la liberté d’être, d’agir, sur le désir de sensations violentes. J’avais même écrit un poème sur la première page. Il me revient une scène où je suis enfermée dans cette lecture, hermétique au monde extérieur dans un climat tendu.
J’ai considéré cet objet avec la tendresse d’un adulte retrouvant au fond d’un carton, un vieux jouet de son enfance.
Puis j’ai racheté ce livre l’an dernier et je l’ai relu en entier. Les pages sont propres et sentent le neuf. La couverture est une reproduction d’un portrait d’Oppenheimer. L’autre représentait une sorte de construction complexe où l’on voit la silhouette d’un homme qui semble chercher son chemin dans ce dédale de lignes de fuites.
Ce ne sont pas les mêmes traductions. Je replonge et compare les deux versions. «Fureur» pour l’un, «rage» pour l’autre, «flux éternel et poignant» pour l’un, «mouvement et déferlement perpétuels douloureux» pour l’autre.
Je fais des allers-retours d’un livre à l’autre pensant trouver plus que des mots, tentant de réveiller quelque chose qui, (je le sais), a pris fin.