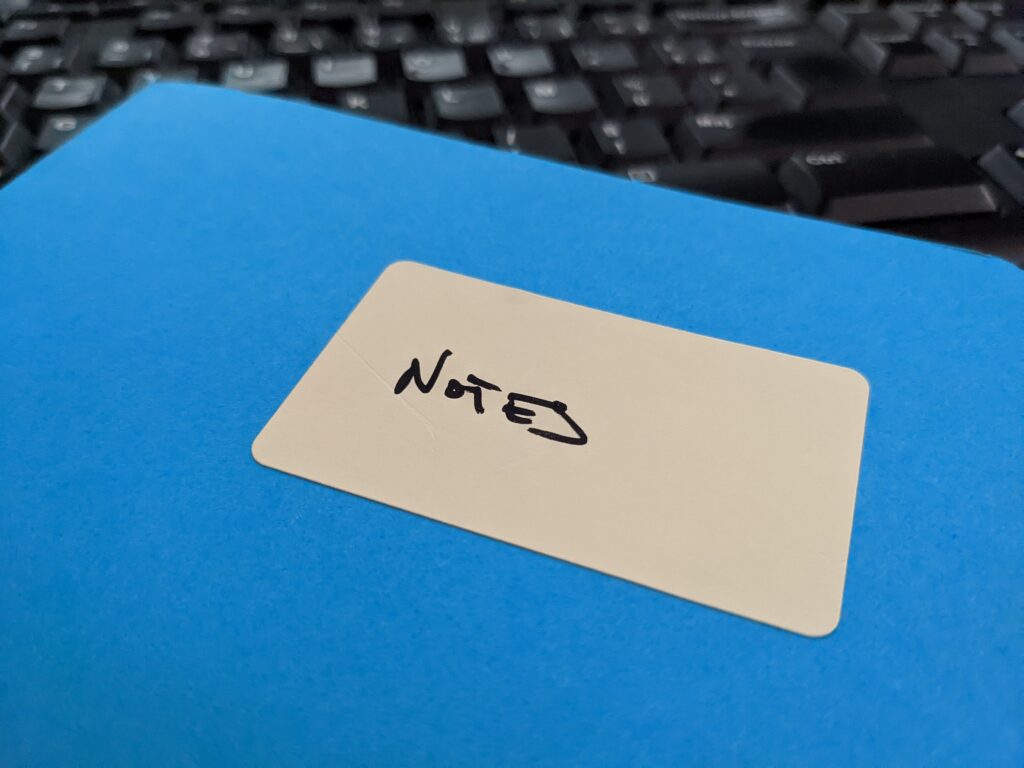
J’écris juste avant de m’endormir, que mon rêve le plus récurrent comporte des obstacles nombreux qui m’empêchent de commencer ce que je dois faire, en général DÉMARRER une formation ou un accompagnement collectif… je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d’une succession d’empêchements tous plus envahissants les uns que les autres, et en réalité assez minimes (pas de papier, pas de salle, trop de retardataires, pas de liste…), mais qui m’empêchent de faire ce que je veux faire, de COMMENCER à faire ce que j’ai prévu. J’ai fait ce rêve de nombreuses fois, sur le matin, avant d’aller travailler. Et, chose étonnante, quand quelque empêchement se produit dans la réalité (ex : je dois travailler avec un groupe et nous n’avons pas de salle – ça m’est arrivé il n’y a pas longtemps) je suis parfaitement détendue et je prends ça de très loin… tout l’inverse dans le rêve, où je m’agite pour rien devant les empêchements qui s’accumulent… un effet paradoxal du rêve ?
Dans la nuit qui a suivi ce paragraphe j’ai fait un rêve où je n’avais pas le temps de chercher à regarder mes mains, je cherchais mon chemin, je ne trouvais pas et il ne fallait pas traîner. Finalement, je fais toujours des rêves AFFAIRÉS, des rêves avec OBSTACLES.
Elle est retrouvée – quoi ? – L’éternité. – C’est la mer allée avec le soleil et avec eux la possibilité de défaire le langage, de se défaire un peu du sens, de jouer, d’être libre, d’écrire des choses qui ne coïncident pas avec la syntaxe ordinaire, des choses qui sont belles qui ne sont pas le langage courant, habituel, opératoire, des choses qui ont leur balancement propre, des choses qui ont autre chose. C’est une grande béance qui s’ouvre avec Rimbaud quand j’ai quatorze ans, que je ne cesse d’élargir depuis.
La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur, auréole du temps, berceau nocturne et sûr, et si je ne sais plus tout ce que j’ai vécu, c’est que tes yeux ne m’ont pas toujours vu… en troisième, découverte concomitante de la poésie et de l’amour concret, et l’instantanée mise à distance de l’un par l’autre – il me semble avoir été saisie au même moment par la conscience double, paradoxale, de la magnificence parfaite du poème et du fait que le poète en faisait quand même un peu trop, rapport à ce que je vivais moi, amoureusement, de bien plus trivial ; avec le recul d’aujourd’hui je dirais que c’était un signe du temps, déjà, que l’idéal de pureté qu’on trouve dans les textes d’Eluard est à l’image de ce qu’on regarde aujourd’hui de la seconde guerre mondiale, son lointain horizon de clarté, l’engagement plein et entier qui se détache avec une sorte de netteté, d’évidence vibrionnante depuis notre présent noir et brouillé, où les idéaux systématiquement paraissent défaits par le réel. Alors qu’en fait, rien n’était simple probablement, ni en amour ni en guerre, mais on savait/voulait encore faire comme si ?
Pas vraiment de routine, ça change tous les jours ou presque. C’est sûr que le téléphone au réveil c’est presque tous les matins : Facebook, la Une du Monde, les mails Juliette Cortese (les seuls qui ont droit de notification directe sur mon téléphone), les mails pro, les mails perso, les messages des copines sur Messenger et sur Signal. Lire quoi ? Le journal, les poèmes sur Facebook, parfois des citations d’auteurs, des extraits plus ou moins longs, des photos de pages de livres, les lettres à Kafka de Marie-Philippe Joncheray, les longs textes en prose de Milène Tournier, les récits absurdes de Pierre Barrault, les histoires souvent drôles de Fabien Drouet. Tout ça, ça remplit tous les creux, se niche dans les pauses, les moments d’attente, les entre-deux, les feux rouges trop longs, les rendez-vous qui n’arrivent pas, les déjeuners en solo. Et le soir, c’est les messages, les longs échanges, entre la tisane et le brossage des dents, juste avant le sommeil, le plus souvent avec Caroline Diaz, avec Nathanaëlle Quoirez, parfois Gracia Bejjani, Daniel Bourrion, Gwen Denieul, ou Milène, encore. C’est de l’écriture oui, et c’est du lien, mais un lien lointain, un peu douloureux, parce qu’on n’est pas en présence, qu’on le sera pas avant un moment, et jamais assez pour ce qu’on a à se dire. Les livres ? Ils prennent la place qui reste, c’est-à-dire un peu le soir, surtout dans les périodes où je décide de laisser le téléphone dans mon bureau, pour débarrasser mon coucher de la foule numérique. Avant, c’était pas comme ça, je pouvais lire des heures d’affilée. Maintenant, le plus souvent, la lecture est entrecoupée, je reprends le téléphone, cette attraction pour les messages, les notifications… Comment c’est venu au juste ?
Il y a eu le premier mail, vers 1998. Le premier site internet, dans les cours d’IUFM de 1999-2000. Le premier téléphone mobile, 2001, mon installation à Paris, les SMS dans nos vies. Le sursaut la première fois qu’une bulle de chat s’était ouverte sur mon ordi, vers 2002. Le premier smartphone a dû coïncider presque avec l’ouverture du blog, ou alors c’était juste avant, 2008, le premier Samsung ? 2010, le blog. La première liseuse, en février 2012, a fait l’objet d’un billet un peu ridicule, j’étais fan de Murakami. Entre temps, j’ai partagé des textes, beaucoup de textes, sur un site belge, Oniris.be, où tout le monde pouvait lire et commenter, une chouette expérience, plein de rencontres, j’y ai passé un temps fou, à lire et à commenter des textes. Ensuite il y a eu l’engagement dans le premier roman, entièrement planifié dans YWriter, un logiciel d’écriture : découpage en chapitres, scènes, fiches lieux, fiches personnages… J’écrivais sur ordi portable, dans le salon de notre appartement, un casque fermé sur les oreilles pour m’isoler du bruit des enfants, petits. Pas vraiment lu Virginia Woolf, pas encore la place pour un lieu à soi, mais déjà du temps consacré. Arrêt à la première moitié du roman pour reprendre des études et changer de métier, une pause de six ans sans écriture (sans écriture créative mais beaucoup d’académique) jusqu’à la formation ateliers d’écriture et la rencontre virtuelle avec les ateliers de François, en 2018. Jamais repris ce roman à moitié écrit, il a pris ses distances, et moi je l’ai laissé dans une vieille version d’YWriter. Les enfants ont grandi, moi aussi, je ne suis plus si fan de Murakami.
Aujourd’hui j’écris sur un carnet bleu, glissé dans mon sac depuis 35 jours, et en parallèle dans un Doc intitulé CARNET BLEU sous Drive, j’écris quotidiennement sur Google Keep dans mon téléphone, j’écris parfois à la voix, en conduisant sur l’autoroute, parfois à l’enregistreur, en marchant dans la rue. Je filme, à la main ou au stabilisateur, en pensant qu’un jour ces images rencontreront un texte, je filme et je monte pour d’autres, des images pour les vases communicants, j’écris sur les images des autres. Je fais des photos quotidiennes en me demandant quelle est ma sensation du monde aujourd’hui, la phrase au plus près de ma sensation du monde, et j’ai une idée de plus en plus précise de ce que ça va devenir. La #31 m’a donné grosse envie de podcast, à voir si ça rentre dans l’emploi de mon temps. Il me reste à créer un site internet pour remplacer le blog, ramasser tout ça au même endroit, les publications les textes les vidéos les sons… C’est pas ça qui va réduire le nombre de notifications, mais c’est une façon de se plier au monde en dépliant l’intérieur de soi, forger son expansion dans l’accélération forcée, un mode de survie.
Ça m’arrive tout le temps. Perdre les noms, mélanger les gens, les artistes, les auteurs, les films, les morceaux de musique, même et surtout ceux qui comptent le plus. Je pourrai jamais dire que c’est en vieillissant, parce qu’à dix-neuf ans déjà, en hypokhâgne, un jour de colle, j’avais réussi à faire croire, tout involontairement, au prof, en tête à tête, qu’il y avait ce livre d’Umberto Eco, mais si, vous voyez bien, ah, bon sang, je me souviens plus du titre, et de lui raconter par le menu une pièce de Luigi Pirandello… Me suis rendue compte de ma méprise le lendemain, faisant la vaisselle ou me brossant les dents, la honte bleue légère et l’amusement quand même, le pauvre s’était vraiment interrogé sur sa propre culture – un livre non su du grand auteur – et moi j’avais la petite fierté de mon aplomb avec un savoir fragmentaire, embrouillé, erroné, un savoir inventé sans conscience ni ruine de l’âme, une fiction de savoir nullement délibérée, et pour ça efficace. Et puis j’ai quitté précipitamment à la fin de l’année, c’était pas trop un endroit pour les gens comme moi qui ont sans le savoir de l’invention à la place de la connaissance, mais ça je l’ai compris bien plus tard.
Ça m’a tellement fait rire. Le couple, on les avait croisés à 6h54 sur le parking de la clinique, eux en voiture, nous à pied. La femme m’avait sourit à travers le pare-brise parce qu’elle voulait passer là où justement on marchait, mais ne voulait pas nous écraser. Puis, dans la salle d’attente, les voilà qui arrivent, prennent le ticket, c’est le numéro six, s’asseyent à côté de moi. Et là, ils échangent des mots, badins, rien de tendu ni rien, parlent comme on parle un peu pour rien dans l’innocence vide des salles d’attente – pourquoi j’y préfère être seule – quand soudain, je la vois, pince à épiler en action, tirer sur les poils de sourcils de son homme, et lui qui se fâche un peu, mais encore bien gentiment pour le bruit que ça ferait si c’était à moi qu’on faisait ça. Il dit des trucs comme non mais là c’est bon ça va arrête, tu vois ça, tu me… et si ça ne tenait qu’à moi je mettrais des tas de trucs vulgaires là-derrière, mais ils les a pas dits, ça ne tient pas qu’à moi, ou si, faudrait les retrouver, les vrais mots, les avoir notés sur l’instant.
Ça ferait un beau texte pour une Milène Tournier, avec sa classe incroyable elle tisserait là-dessus Une rencontre par jour, elle nous dirait la tendresse en fait dans les yeux de la femme, son épileuse sollicitude et comment l’homme interrogerait Milène, « elle fait tout le temps ça, vous aussi, vous faites ça à votre homme ? » Et que Milène serait embêtée, à ne pas forcément répondre mais penser que elle non mais par contre les melons, elle les évidait pas pareil que lui. Est-ce que ça aurait quelque chose à voir, avec essayer de rendre son homme plus beau, avec les poils retirés aux bons endroits, avec aussi l’intrusion que moi j’y trouve sur le corps de l’autre, si je me mets à la place de l’homme ? Moi je rigolerais en baleine, j’en dirais quelques gros mots en la racontant, l’histoire ; Milène elle en ferait sa cuisine de tendre avec des ponts en poils de sourcils jetés entre les gens, entre les histoires. Et elle y comprendrait quelque chose que personne n’y comprend, et qui est pourtant clair, une fois dit.
Un relâchement de toute la tête. Amollir les os du crâne. Sur l’expiration, aplatir à l’intérieur son cerveau. Sentir l’intelligence qui se contracte, se réfugie dans un coin, laisse place. Ou qui tombe, en noix vide, le bruit du caillou au fond du grand puits. Ouvrir le grand puits bleu de la mémoire, espacer les espaces de crâne, aplanir le temps. Voilà, mettre toute la chronologie en un seul point. Dans la noix vide de l’intelligence. Tout le temps en même temps, c’est à ce prix, le grand rien.
Et puis, avancer par glissement vers ce qui vient. Pas un point lumineux à l’horizon, des bouffées plutôt, rafales, trous d’air non, les simples vents réguliers. Un souffle au visage qui traverse la tête, fait rouler la noix vide, pousse les mots les phrases, envoie le rythme surtout. Prendre ça dans la tête et l’écrire sans une pensée, comme une activité manuelle, un macramé de langage.
Est-ce qu’elle le saura, qu’elle est morte ? Est-ce qu’on sait quand on est mort ? Tu t’endors tranquille au bloc, le plongeon très doux de l’anesthésie, et après tu te réveilles même pas quand on te met dans une boîte en bois garnie de tissu satin bleu pâle, tu te réveilles même pas sous la dalle de marbre, tu te réveilles plus, tu sais plus rien. Ne sachant pas qu’elle est morte, la morte repose bien tranquille et sans plus de préoccupation, rien.
Permettez-moi de trouver bizarre qu’un homme meure en chutant de son vélo bleu le long de la station de tram – la roue dans le rail ça pardonne pas, ça tout le monde le sait – et pourtant il meurt – sa tête vient heurter le bord du quai du tram – et il meurt – permettez moi de trouver bien étrange qu’on puisse mourir comme ça dans la ville sans que personne le sache sauf peut-être quoi, les cinq personnes qui étaient là ce jour-là et qui se sont occupées du Monsieur – appeler les secours, se mettre en retard, en parler, etc – et encore, ont-ils ont-elles su la suite, la mort, ont-il ont-elles appris dans le journal que non, les secours le retard les paroles n’avaient pas suffit à le garder en vie ? On devrait avoir un système d’alerte, la mort aussi inaperçue ça n’est pas possible, ça ne se peut pas, imaginez le Monsieur c’est un ami à vous ?
Oui je l’ai dit c’est vrai mais j’aurais préféré ne pas. Oui je l’ai dit c’est vrai et en le disant je savais que ça n’allait pas. Que ce n’était pas ça qu’il fallait dire. Pas comme ça. Pas ce mot, un autre. Pas ce ton-là. Je l’ai entendu tomber dans ton oreille, le mot, avec le ton pourtant gentil, en arrivant dans ton oreille j’ai entendu ça a fait un bling un peu aigu, dissonant, un bling bleu foncé moche, le genre de bling qui agace, qui énerve, le bling du mot mal tombé dans l’oreille, du mot mal reçu, mal pris, mal mis, chiffonné. Mes mots mal accueillis j’aurais préféré ne pas, c’est toujours comme ça, spécialiste des regrets de dire.
Il faut se mettre la tête comme ça dans la position de tête horizontale c’est-à-dire avec maximum d’écartement de crâne en largeur mais sans que ça se voie – l’écartement discret pour aérer juste assez et l’écartement suffisamment bon – ni trop ni trop peu – seulement ce qu’il faut pour espacer les pensées les agiter d’un petit mouvement de presque sans savoir un léger hochement latéral presque pas délibéré juste à la frontière de la décision et dans l’ignorance quasi complète de cette presque décision hop passer la main à travers le cerveau – ses espaces – et tirer le premier fil venu la pensée qui entre en résonance avec l’image qu’on va faire dans l’accroupissement hop l’image avec la pensée ensemble disent la tonalité globale de l’intérieur la couleur bleue du dedans comme une chaise métallique.
Je me regarde m’accroupir plusieurs fois par jour, plusieurs fois par jour je me regarde ressentir la tension dans les cuisses, cet inconfort des genoux pliés trop longtemps, je me regarde regarder depuis autre part ce que pensent ce que voient les autres, je me regarde tous les jours chercher le bon cadrage pencher le téléphone choper le plan, jouer des obliquités et des diagonales à ras du sol sans traîner et pourtant essayer encore, une autre prise, l’autre jour encore accroupie derrière la chaise bleue métallique, je me regardais prendre en photo les gouttes nettes les gouttes floues les gouttes rondes habillées costume brillant, délimitées par une petite magie, une pluie plastique, une verrerie d’eau se regardant elle-même, et mon reflet.
La chaise en métal bleu, en lames de métal bleu, si on s’accroupit devant après la pluie, on voit, on peut voir, au premier plan la granulosité de la peinture bleue sur le métal, les gouttes très nettes et pleines avec leurs bourrelets, et au deuxième plan les gouttes arrondies toujours mais floues, les reflets du soleil sur les lames qui point de fuite, et au troisième plan au fond si on concentre ses yeux sur le premier plan on voit, on ne voit pas mais on voit, flou, la terrasse le jardin le rosier les lauriers sans roses, la séparation verte du voisin.
– enfin j’irai partir au dehors du corps – enfin je n’embêterai plus personne – ne ferai plus inflammation – ne causerai plus douleur aiguë – diffuse – irradiante autour – loin jusqu’aux genoux – ne donnerai plus d’envies de m’arracher – ne contracterai plus cruellement – ne vomirai plus caillots de sang par le bas – ne me gonflerai plus à intervalles de mois – puis de semaines – finissons les bleus – enfin le repos – du guerrier et de la guerrière – enfin nous serons sans regret – de nous séparer – elle et moi –
| ma valise mon corps ma tête dans leur marche mesurée ruissellent | sur le sol bleu lisse où l’heure est à la cohue | l’invraisemblable cohue du soir de semaine | devant tant de foule bruissante nous tournons autour sans désarticuler | pour ne pas désarticuler devant tant de foule tournons roulons vibrons les roulettes sur le sol lisse de la petite valise | à pas mesurés le corps la tête et tout ce que je | dilué dans le vaste de l’espace | le lisse et le bruissant granuleux de la foule entassée dans le vaste de l’espace | je | pas perdue | je oubliée | dilué conscience de moi dans grand lit du monde |
Combien de pas pour me rendre à la salle de bain, combien de gouttes accumulées en ruisseau coulant sur ma peau sous la douche, combien d’aller-retours dans l’escalier, combien de degrés l’eau pour le thé, combien de minutes à gratter le pare-brise pour faire le trou dans le givre bleu et voir la route, combien de journalistes entendus à la radio sur le chemin, combien de voitures croisées et leurs phares, combien la salade achetée vite fait avant d’arriver, combien de minutes d’avance, combien de fois on nous dit de remettre nos masques dans la journée ?
Dans la rue droite qui mène au métro Mermoz-Pinel, dans le froid humide de novembre, sous le ciel qui n’est plus jamais bleu, dans l’air immobile de ce jour, dans la ville qu’on partage avec les oiseaux, dans le ronronnement régulier de ma valise à roulettes, dans l’espace du dehors et dans mon corps chaud qui marche, j’ai cueilli, avec ma main propre, un morceau d’une feuille sur une plante qu’on avait plantée là, au bord du trottoir, pour décorer et respirer mieux. La feuille froissée dans ma poche dégage une odeur citronnée, d’herbe coupée et de sel.
Dans le métro aux sièges rouges striés verticalement bleu foncé, il est assis au milieu d’eux, le tronc forme un angle aigu avec les membres inférieurs, le visage déjà ridé, et se penche dans une imprécation vers tour à tour chaque voisin, les visages répondent fermés ou affligés ou condescendent un sourire, jusqu’à ce que quelqu’un, debout au milieu, sorte enfin le portefeuille, et la pièce accrochant la lumière va dans sa main fermée.
Un moelleux à la châtaigne et un thé, s’il vous plaît. Vous avez quoi, comme thé ? Venez là, au bout. Ils sont ici, voyez ? Ok… je peux voir celui-là, là, le bleu, Prince Wladimir, c’est du thé noir ou vert ? Pfff, aucune idée, tenez, le voilà. Ah, oui, ok, celui-là, très bien. Je vous règle maintenant ? Oh oui, ce sera fait.
Posez vos fesses là, sur le bleu, allongez-vous, la tête ici. Vous savez qu’on vous remplit le vagin avec un gel d’échographie ? Voilà. Vous l’insérez comme un tampon et moi j’appuie, sur la seringue. Super, on vous attache maintenant, le casque antibruit, la pompe d’appel dans votre main, ça va durer quinze minutes à peu près.
C’est lorsque le sujet ne peut plus rien créer à partir de sa propre souffrance, ni parvenir à l’oublier ou à s’en distraire grâce à ses défenses, que celle-ci devient pathogène. La souffrance désigne ainsi des états infrapathologiques qui font partie de la normalité, au point que l’on puisse parler de « normalité souffrante ».
J’ai écrit dans le train, au carnet bleu, à l’encre bleue, sur les pages blanches oubliées entre deux dessins ratés. J’ai écrit alors que le travail laissait si peu de place à l’écriture, pestant avec moi-même contre ma propre incapacité à organiser le temps de façon à pouvoir tout faire. J’ai écrit dans le TGV qui remuait, placide et calme ; j’avais pris en première classe, comme une vieille bourgeoise s’autorise à craindre la fatigue.
Ce samedi 26 novembre 2022, j’observe et mets à la discussion :
D’abord, l’intérêt de laisser ouverts les regards d’assainissement des eaux usées et de favoriser leur écoulement progressif sur la rue : cela favorise effectivement le lien social, la parole entre voisins, la fraternité.
Ensuite, la nécessité d’instaurer un Jour du Déménagement, à l’occasion duquel, sans préparation, la population du village laisserait vacants ses domiciles pour aller vivre dans les appartements du Quartier de la Mosson, rues d’Uppsala, de Bologne et d’Oxford, dont la population viendrait, elle, habiter les maisons de village, pavillons et villas ; cela pour une durée indéterminée.
Enfin, l’urgence d’une amélioration logicielle de la plateforme Uber selon deux grands axes : 1. réorienter les livreurs de plats préparés de leur destination d’origine vers toute personne souffrant de la faim dans la ville 2. réorganiser la circulation des VTC pour donner aux personnes âgées et à toutes celles dont la mobilité est restreinte un mode de déplacement correspondant à leur situation et à leurs besoins ; les utilisateurs habituels prendront les transports en commun.
La veste noire en synthétique motif panthère dorée, le polo noir du serveur griffé au nom de la brasserie porté près du corps ou non selon la corpulence, le pull à grosses mailles beige gris de la dame, le jean bleu clair et large avec les baskets blanches de jeune, le chemisier très fleuri à manches bouffantes porté avec des cheveux bouclés attachés, les bottines à talons en cuir caramel, les larges manches de mon propre gilet noir vaste doux et chaud sans bouton, la doudoune noire sans manche à stries matelassées horizontales quoique verticales plus serrées sur les flancs, le haut noir près du corps qui laisse voir l’empreinte de soutien-gorge dans la chair, l’imperméable mastic suspendu inhabité sur le dossier d’une haute chaise, le jean bleu jean les plis au niveau des hanches quand la personne est assise, les sneakers en cuir camel avec semelle caoutchouc ou PVC blanc, le pull angora rose très pâle à rayures blanches sauf une dorée à paillettes, la grosse surchemise bucheronne en polaire moutonnante blanche à fines rayures horizontales anthracite et verticales bleu-gris clair, la robe pull mauve à côtes verticales dessinant la silhouette, le gilet à capuche bleu très sombre avec un lacet fantaisie bleu et blanc, la veste de sport gris souris avec au col une poche pour la capuche fermée par une fermeture Eclair couleur saumon, le gilet noir en polaire sans manche avec l’écusson rouge AUTO PIÈCES RF, le vaste pull marin blanc à rayures bleues foncées accessoirisé d’un foulard gris clair ou crème, le pull en laine blanche avec un foulard bleu à rayures bleues foncées, les baskets noires et blanches type Converse à semelles compensées, les épaules lointaines d’une chemise noire et blanche motif léopard.
c’est coûteux d’être en colère | moi, mon réflexe, c’est d’aller dans mon bureau | quand quelque chose me morfond c’est essentiel dans ma tête, j’arrive pas à en sortir | Christelle a dit qu’elle se sentait mal, la boule au ventre en venant | moi je pensais qu’elles allaient bien, mais en fait non | comment je fais pour savoir qui vient ? | il y a rien qui s’est passé | faudrait voir si quelque chose pourrait faire un déclic, pour enlever le blocage | oh, moi j’en ai plein, des comme ça | j’ai ma rectocolite qui s’est réveillée | entre elles c’est compliqué | je me sens très mélangée | on a besoin d’un parent qui nous dit quoi faire | je préférerais parler d’autre chose que de ce qui fâche | faut toujours aller les chercher | point de vue estomac, je galère un peu | elles savent pas réellement ce qu’on fait nous | la situation n’est pas tenable | elle, elle est plus proche du secrétariat | j’ose pas lui dire que, c’est pas que j’y arrive pas mais j’ai pas le temps | personne ne se rend compte de l’impact | je l’aime bien, elle est sympa et hyper réactive | les choses vont devoir bouger | nous nos suivis sont plus difficiles | quelque chose me tombe dessus | personne n’a répondu à notre demande | on a dit ça et personne n’a dit un seul mot | elles n’ont même pas accusé réception | elles se coordonnent pas | je suis encore moins sereine que la dernière fois | ça pourrait très bien fonctionner ! | Émilie elle savait que quand Pascale était là, elle me sollicitait pas autant | je ne comprends pas pourquoi on fait attendre dix-sept personnes ! | si ça fonctionne pas, ça contrarie tout le monde ! | comment ça va se passer ensuite ? | plein de petites choses qui se sont rajoutées | tout le monde est sous pression | moi je suis découragée aussi | on est tous un peu perdues | je devrais essayer de trouver quelque chose qui me convienne, trouver une organisation à laquelle me rattacher pour pouvoir tout faire, y compris ce qui n’est pas régulier | pourquoi on bosse ? | pas plus | que le lien se poursuive | serrer les liens entre nous | j’étais visée et c’était très très injuste | il y a que Carole qui a pris la parole | parfois c’est rideau baissé, point | qu’est-ce qu’on fait là, tous ? | j’avais dit que si on nous séparait physiquement, ça allait créer du mal-être | à l’époque on se posait une question, on cherchait partout, maintenant on a plus aucune réflexion personnelle, on est exécutants presque | moi je ferme la porte des fois | on a pas le droit de positionner les gens nous-mêmes, alors j’ai donné mes dispo | les gens ont plus de besoins et les orientations sont plus difficiles | Laetitia m’a dit c’est bien de monter, comme ça tu vois ce qu’elles font | je préférerais parler d’autre chose que ce qui fâche | j’ai dit je sais pas ce qu’elles font, Laurence l’a mal pris | maintenant plus personne ne parle |
Au moment où la femme m’appelle par mon nom, je ne sais au juste où elle se situe, je ne suis pas sûre, me lève sans savoir et ramasse dans l’incertitude mon sac et ma veste, pour partir à sa recherche dans un couloir bleu flou ; ma quête, je sais qu’elle aboutira puisqu’on m’appelle, m’a fait perdre ce que je pensais l’instant d’avant.
Les feuilles, aux arbres, étaient soudain pétrifiées par la lueur lavée qui jaillissait d’un grand nuage bleu anthracite, les rayons retombaient en flot transparent comme si toute la lumière s’était déchargée, au travers du nuage, de ce qui jusque-là l’obscurcissait, l’alourdissait ; elle bondissait légère, sa dernière vie avant l’orage, et coulait son or sur les feuilles.
Avant l’aplat de l’encre, avant le bleu du contraste qui dessine sur la page, avant les mots dits en mots, les entrechoquements de la phrase, avant que naisse une forme, avant que ne poigne ombre ou trace d’une parole, avant que le langage fasse sa cuisine et coule au dehors, il y a un frémissement de tête, quelques ruminations, un lâcher de la rampe à laquelle on se tient le reste du temps, quitter le discernement du raisonnable pour en accepter le déplacement, décadrer, viser, enfin écrire : un laisser venir.
Je ne sais pas si l’idée d’écrire est venue avant la quatrième. Était-ce d’ailleurs une idée spéciale ? Mon père écrivait des chansons, ma mère des poèmes, des articles, moi des rédactions dans les petits cahiers de l’école. Non, c’est le geste, qui est venu. Au collège, un jeudi midi, à treize ans, on va à l’atelier d’écriture avec Céline et Christelle. C’est là qu’est venu le geste gratuit de l’écriture : une ouverture, une béance, un bleu pour toujours.
Pendant que je lis Tandis que j’agonise, de Faulkner, je me demande si Je serai jamais morte, de Fabien Drouet.
Pendant que je lis Tandis que j’agonise, de William Faulkner, je me demande si je vais survivre à mon Covid de moi-même.
Tandis que j’agonise, un cercueil, et dedans une mère qui attire les busards.
Tandis que j’agonise, William, tu écris des phrases folles avec tes yeux de bois.
Tandis que j’agonise, mes pieds refroidissent et il fait soleil.
Tandis que j’agonise, je lis, j’agonise, je ressens tout de tout.
Tandis que j’agonise tout le monde parle parle et parle et tout devient bleu.
Il aurait mieux valu ne pas s’attarder sur nos petites défaites, les renoncements discrets dans le silence de coton bleu, les aubes où l’on abandonne avant que le jour soit même né, ne pas regarder en face les dénis, les manques, les refus, ne pas voir les têtes détournées, les visages refermés, les poings remis dans les poches et les mascarades pour se raconter qu’on avait choisi, alors qu’on s’était seulement laissé faire.
François Heude Anna Geyser Lola Lanouar Xavier Vertrébal Arnaud Kuzpiek Olivia Thé Jacques Carnot Paula Carpe Marguerite Visage Vardaman Joseph Paul Piquet-Clicquot Nestor Crabe Roger Pol-Laurençin Trevor Champignon Gustave Malivernes Javier Vie Lyv-Victoria Seighor Anna Bloute Jean Pauldeau Hugues Cétamol Jean-François Coppé Michel Durand Mélanie Bernardin Françoise Alberti Guillaume Semprun Jean-Christophe Diem Bertrand Ibañez-Kouakou David Palavas Jeanne Duval Lise Dujardin Gaspard Jardinier Franck Ovalon-Bleuve
| Un nez qui s’élance vers les autres, à la rencontre, et dessus deux yeux marron chatoyants, un sourire à fossettes, des boucles brunes, impression de vivacité | Cheveux emmêlés, propres, blond virant au sel avec le temps, les joues barbues, et des yeux qu’on dirait bleus et espiègles, la bouche aimable appelant au moins la conversation | Le nez porcin, les yeux myopes façon taupe, la peau rose et grasse, la bouche pulpeuse ou dédaigneuse selon le regard qu’on porte |
Personne n’a vu dans la fenêtre remonter les pétales du grand cerisier, et le vent passer vertical.
Personne n’a vu dans la fenêtre le ventre d’un nuage traverser le ciel en oiseau énorme.
Personne n’a vu qu’au bas de la fenêtre et dans le flou des nuages, l’appareil photo ne savait plus faire, et que j’aimais ça.
Personne n’a vu la musique sortir de l’enceinte, et pourtant c’était doux, un bleu tendre.
Personne n’a vu que tu étais parti, que tu étais revenu.
Personne n’a vu les mains de la mère dans les cheveux d’un autre homme.
Personne n’a vu derrière les rideaux, personne n’a su.
Personne n’a vu ce qu’il y avait dans la voiture.
Personne n’a vu que le salon s’était vidé.
Personne n’a vu la valse, la note perdue sur le tapis.
Jour triste de pluie, on donne aux ciels des prénoms.
Huit heures : Jean-Paul, un ciel gris clair, nu, à vaguelettes plus sombres, attend la pluie.
Neuf heures quarante-cinq : Jean-Dominique, ciel gris sel, mou, à grosses moustaches poivre, crache une pluie bien liquide.
Dix heures quarante : Jean-François, ciel qui tonne au cœur, l’éclair me sursaute.
Onze heures trente : Jean-Jacques, ciel ardoise assis sur un ciel laiteux, air calme, pacifique.
Treize heures : Jean-Pascal, ciel gris opaque, ses yeux bleus fermés qu’on dirait pour toujours, et à peine trois reflets des lumières du salon dans la vitre lui donnent meilleure mine.
Quatorze heures quarante-quatre : Jean-Baptiste, les lueurs en transparence derrière tes nuages blancs, ça pique les yeux.
Quinze heures vingt-cinq : Jean-Pierre, un ciel qui court plus vite que ses nuages est-il un bon ciel ?
Seize heures trente-deux : Jean-Michel, ciel bouché comme un homme qui ne veut rien entendre.
ll va bientôt faire nuit, je pars travailler. Quelqu’un pour déboucher les oreilles du monde ?
Ce n’est pas un mot, ce n’est pas une phrase, c’est un brouhaha. On ne nous a pas tellement proposé de bonbons. Pesanteur du dormir, si tu passes la nuit à écouter le langage inarticulé du sommeil, est-ce que tu dors, ou est-ce que tu performes ? Le bruissement d’un fils qui se couche, s’entrouvrir aux sons qui voudraient se cacher, et les questions viennent se nicher dans les paupières. Demeure une bribe de rêve. Un lieu où faire des vidéos, des machines, un film à reprendre, et puis : « on ne nous a pas tellement proposé de bonbons ». Ce n’est pas un mot, ce n’est pas une phrase, c’est un brouhaha où surnagent, morceaux de rêve me tombent des yeux, phrases fracassées aux règles de la pierre. Ma torpeur est un vaste garage.
On aurait pu voir, dans la nuit tombante, dans la lumière descendante, alors que les grands platanes sages fermaient leurs yeux d’arbres, tandis que le bleu du ciel tournait à l’orange définitif de la nuit, on aurait pu voir, parce qu’on était un samedi, qu’il y avait deux mariées au parc : d’abord la voiture noire luisante, décorée de rubans, garée sur les pavés devant l’entrée du parc, et derrière elle une mariée jeune, beige et un peu large, à la grille, dans sa robe pleine de lustre téléphonait, derrière elle l’attendait sa traîne patiente ; ensuite, tandis que des invités marchaient en fantômes dans les feuilles noires du parc, tandis qu’un haut et mince photographe vêtu d’un élégant costume et de chaussures de marche rangeait dans l’ombre son matériel, tandis qu’on portait sa traîne écarlate et longue de tissus fripé – papillote chiffon frisé – une mariée plus âgée tournait vers moi un visage un peu peint, me souriait d’un air de fillette heureuse tandis que son mari, bedonnant dans son gilet de cérémonie, la hélait d’une voix grave, oh, chérie !
Les deux femmes étaient les mariées d’un jour ou de deux, reprendraient lundi leur vie d’ordinaire. Il n’y avait plus de sauvagerie ; novembre, le village et la nuit avaient tout calmé, tout adouci.
Il aurait fallu traverser la vitre, devenir une goutte, une lumière diffractée, un éclat fugace, chatoiement d’arc-en-ciel, la petite brillance, il aurait fallu deviner, traverser plus vite, être la vitesse, et disponible, l’ubiquité désolante et tellement moderne, être à la fois vacant et preste, libre et fulgurant, il fallait être tout, bleu et vieux, l’aube et le soir, le blé et l’herbe, exempt et se dévouer, maugréer et jouir, s’émanciper de ce qui nous faisait genre commun et y être en plein sous peine d’élimination. On en mourait, certains.
Santorin, printemps deux mille trois, l’excursion au cratère, deux jeunes femmes japnaises en tongs sur le volcan. Puis on nage, dans le beu, du bateau jusqu’aux eaux chaudes. Au retour, l’eau refroidissant et la fatigue, l’une des deux touristes japonaises commence à couler remonter couler remonter. Du bateau, tandis qu’on se hèle et qu’on envoie la bouée rouge à celle qui se noie, l’autre la prend en photo. La légende ? Souvenir des vacances en Méditerranée.
Les gens n’arrivaient pas. On évoquait la grève, on se comptait, on attendait. On respirait le silence, l’odeur des croissants chauds. On en profitait, de l’oisiveté, pour regarder les petits écrans et goûter les rayons d’un froid soleil d’octobre. J’avais envie de commencer, un peu mal au ventre. L’occasion d’écrire au carnet bleu.
déjà de la continuité
aimé lire les 3 à la suite…
Merci Françoise !
quelle jolie idée ces prénoms (vais tenter d’amadouer le ciel le cas échéant en m’en servant)
Merci ! J’espère bien que ça va marcher, chère Brigitte !
L’ensemble est superbe… des éclairs de langue dans chaque proposition. Plaisir de vous lire.
Grand merci Anh Mat !
bon sont pas là mais tant pis
si les rencontrez les trois croqués souriez leur de ma part
Les voilà les voilà ! Merci Brigitte de vos présences !
J’aime que les ciels se fassent portraits ou, mieux, visages (lumières quoi)
un bien intense dessous, je vais dormir avec, entre ciel bleu et laisser venir, deux fragments de temps qui se répondent,
que j’aime cette description de l’avant
Un plaisir de te lire! J’aime beaucoup la série des pendant/tandis que j’agonise, son rythme et ses images. Et merci pour la dédicace
J’ai un peu lâché ces derniers jours, vais tenter de reprendre le fil…
Mais oui reviens ! Et merci pour ton passage ici !
arriver à écrire vraiment dans cette description des 20 sans en rester à l’énumération – bravo
Par chance j’ai déjeuné dans une vaste brasserie ce jour là : rien d’autre à faire que regarder le défilé, écrire,… (et manger des lasagnes ;-))
J’approuve toutes les propositions de la 17! Une lecture bien agréable que votre carnet, j’aime beaucoup aussi les prénoms pour les ciels de jours de pluie.
Grand merci pour votre passage, Isabelle !
tout en fluidité, on lit comme on prendrait le thé dans un canapé douillet en compagnie d’une bonne amie, un délice d’y revenir de temps à autre…
vivement demain !
C’est beau de lire les jours qui passent comme vous les écrivez !
Merci Line merci !
oh Juliette nous nous rejoignons presque dans l’action (mais vous y mettez plus de poésie)
Brigitte, c’est une blague ? Le geste de déplacer une feuille morte pour résister au monde, si ce n’est pas de la poésie…!
Beaucoup de plaisir à lire, rencontrer ton carnet, une voix qui dit comme près de l’oreille dans une intimité poreuse. Les propositions se mêlent à ton cheminement personnel jusqu’à passer en retrait. C’est fort.
#28 Présence pregnante de cette chaise bleue rencontrée dans les notes précédentes qui passe là dans la tête, forme une pensée très incarnée, sensation à mi-corps. Bonne suite. Si tu peux, un petit signe de lecture du commentaire, sinon crainte d’avoir dit quelque chose pas adapté, de froiser…
Oh Nolwenn merci ! Et grandement désolée oui, répondre à ton dernier commentaire était toujours dans mes choses à faire, mais argh en ce moment le temps me coince vraiment rude. En tout cas c’est d’un grand soutien ces commentaires, précieux et essentiel pour tenir sur la publication. Rien d’inadapté ou de froissant, bien au contraire : une joie à tous les coups ! Alors merci, merci, merci. Et toute affligée de ne pas trouver le temps de lire ton carnet, mais ça viendra, ça va arriver, sûr !
Le corps prends de la place dans ce carnet mais quand il s’accroupit pour voir des gouttes, c’est beau. La chaise bleue, le carnet bleu et tout le bleu du carnet aussi. (et j’aime beaucoup les pendant que)
Oui, le corps prend de la place… et pas que dans le carnet d’ailleurs Merci pour les bleus !
Merci pour les bleus !
la chaise en métal bleu comme repère et le bleu encore qui revient dans cette #28 qui me retient quelque instant
belle l’image de la main qui balaie une seconde l’intérieur du cerveau
salut Juliette
Merci Françoise ! Ah oui le mode d’emploi c’est vraiment celui-là, hein, que j’utilise chaque jour ! L’effort à faire pour l’écartement du cerveau, un peu dur au début, mais on s’habitue
t’es trop forte, tu veux pas venir passer Noël en famille avec nous ? ça mettrait l’ambiance !
Hahaha ! Mais enfin !? Je ne sais pas pourquoi tu dis ça ni comment je dois le prendre, arf !!! Bon en tout cas pour ce qui est d’ambiancer les familles, ça peut se faire mais c’est payant ! Et cher !
elle a pt’être le bouton la sinistre mais moi elle me les file – tout plein – les boutons !
Haha, oui, pareil Jacques, boutons partagés !
quel beau grand rien ! — merci !
Grand merci ! De grand rien !
Juliette, t’as éclaté la 34 !!! où veux tu qu’on aille maintenant, trainer nos guêtres et arracher nos poils disgracieux, moi je dis c’est pas du jeu, c’était Corteseland cette 34, on n’a plus qu’à se faire des petits pois en boite, oui c’est ça une boite avec des petits pois dedans par dessus le marché, c’est la seule solution la seule bonne solution,
Haha, grand merci Catherine, ton message me fait beaucoup rire ! Bienvenue à Corteseland, et bon appétit ! :-p
là par exemple, Juliette, quoi lire après des bribes de votre carnet ? ça vaut un livre de la médiathèque, non ? alors j’aurais lu vos mots aujourd’hui. enfin des mots, des vrais mots. merci !
Merci ! On s’est croisées ce soir :-)
La terre est bleue comme une orange merci de faire surgir Eluard dans la courbe de tes yeux. Jusqu’à vous lire il n’était pas présent. C’est fait.
C’est comme les vieux tubes qu’on se remet dans la tête !