La machine imposante prend place dans le bureau, coincée sous la fenêtre entre le radiateur et la porte. Une sculpture de plastique et d’acier, indécise et laide. Une compression d’où émergent dans un grand désordre un écran, des poignées, des repose-pieds, un rail, un siège étroit, un enrouleur. Zack la déloge de son lieu de repos et la déplie. L’objet est allongé, inerte, éteint. Dehors, par la fenêtre, le grand chêne est encore d’ombres, une bise matinale fait frissonner ses feuilles, l’aube s’étire. Zack s’assoit sur la tablette étroite, la douleur dans ses ischions lui rappelle les exercices de la veille, et ceux de l’avant-veille et du jour d’avant. Zack a mal aux fesses tout le temps. Il enfile ses pieds sous les lanières des repose-pieds. Il fléchit ses jambes pour se rapprocher du gros enrouleur caché sous une coque en plastique et saisit la double-poignée. Premier mouvement, l’appareil de torture ronronne, un bip retentit et l’écran s’allume, des chiffres apparaissent. Zack bâille tandis que du téléphone portable connecté à une radio en ligne, Cat Stevens/Yussuf Islam égrène les premières mesures de « Where do the children play ».
Tirer sur les bras, pousser sur les jambes. Les épaules se plaignent, les mollets grincent. Les premiers coups de rames appartiennent encore à la nuit, les premiers souffles surgissent des limbes, les premières sensations se réveillent. Les muscles du haut du dos pianotent sous la peau une musique sourde. Dans la bouche, le goût du café trop vite avalé. Zack se demande où il en était. Il en était là, il ramait et il laissait son corps rêver. Il le laisse aller, il le laisse retrouver son univers de liberté. Les muscles s’évadent lentement sous les impulsions des mouvements sans cesse répétés. Tirer-pousser, dos bien droit et tête haute, puis pousser-lâcher, fléchir les jambes, laisser la sangle accrochée à la poignée s’enrouler dans le coeur de la machine.
Prendre le rythme. Inspiration en tendant les jambes, la poitrine s’ouvre comme un livre et les bras ramènent l’espace empoigné. Expiration en pliant les jambes, le corps se referme comme une coquille et couve les souvenirs qui traînent par là. Dehors, la frondaison du chêne accueille les premiers rayons de soleil. Le coeur joue encore une timide partition. La machine respire en grinçant, la sangle se déroule et s’enroule pendant que sur le rail, le siège alléretourne en suivant la mesure. La machine râle sa mauvaise humeur mécanique, se gonfle et se dégonfle en imposant son rythme lancinant au corps de Zack. À la radio, KD Lang chante The air that I breathe. Zack entend les phrases s’échapper du téléphone. Il n’imprime pas, les mots s’envolent derrière la plainte de la machine.
Fermer les yeux, s’abandonner. Il y a des rameurs qui ont l’air de voler, de planer au-dessus de la surface de l’eau comme des libellules. Sans montrer aucune souffrance, comme s’ils étaient l’air et l’eau en même temps. D’un seul mouvement de bras, l’eau défile sous leur esquif sans même une éclaboussure. Il y en a d’autres qui ont l’air de creuser, de manier des pelles qui fouillent la terre pour déterrer un trésor imaginaire dans les tréfonds du sol. Ils creusent, ils piochent, ils luttent avec violence contre les éléments, la terre, l’eau, l’air jusqu’à aiguiser leur mental comme un rasoir que rien n’arrête. Et puis, il y a les rameurs immobiles qui ferment les yeux. Zack et sa machine ne font plus qu’un, une sorte d’androïde animé par une pensée mécanique, porté par la répétition du geste, rythmée par les battements de la machine, par les bruits du souffle, par la mesure du coeur qui cogne de plus en plus fort dans les tempes. Entre deux dépliages, Zack reconnaît Modoc de Steve Morse avec son intro de guitare folk, le chêne s’illumine à l’extérieur, quelques gouttes de sueur perlent sur son front.
Avancer sans bouger, maintenir l’allure, ne pas faiblir. Sous les coups de rames, voyager immobile dans le même décor. Le radiateur, la porte, le mur avec sa photo encadrée d’un père marin qui n’a jamais ramé et d’une mère femme de marin qui n’a jamais bougé, la chaise confortable que le chat a choisie pour passer ses nuits, le meuble vestige d’un héritage familial sur lequel les feuilles de compte, les factures, les lettres de réclamation, les procès-verbaux font piles, les rayonnages de dossiers rangés par couleurs, rangés par douleurs. Les coups de rames de Zack emportent tout le décor dans la même aspiration. Ramer et emporter l’espace avec soi, explorer l’envers. Sarah McLachlan chante l’ailleurs, Elsewhere, I love the time and inbetween the calm inside me in the space where I can breathe. J’aime le temps et dans les silences le calme en moi dans l’espace où je peux respirer. Le soleil avale les dernières ombres, la transpiration trace les premiers contours d’une mappemonde sur le tee-shirt usé, la respiration s’accélère derrière la bouche grande ouverte.
Survivre à l’effort. Sur l’écran de la machine, des caractères mystérieux défilent 35.43, 1015, 460. Time, strokes, cals. 189 watts. 32 ppm. La mesure de l’ailleurs à quelques unités près. Penny Lane est dans les oreilles et les yeux des Beatles, là sous le ciel bleu de la banlieue, Penny Lane is in my ears and in my eyes, there beneath the blue suburban skies. Les muscles des bras, les triceps, ceux des épaules, les mollets, les cuisses, les fessiers… tout brûle. Tirer sur les bras et pousser sur les jambes, emplir d’air jusqu’à éclater ses poumons et se vider jusqu’au dernier souffle, et répéter le même geste et répéter et répéter. Tirer-pousser. Jusqu’au bout, à fond, tenir, souffrir, tenir. Souffrir. Et tout lâcher.
S’effondrer. Abandonner. Mourir. Zack libère ses pieds des lanières et les pose sur le sol. Il prend sa tête entre les mains, l’eau coule de son front, de ses joues, de ses yeux, de son cou, de son dos, de ses bras, de ses mains. Le tee-shirt est un seul et immense continent. Les poumons incendiés, le souffle en souffrance. Le coeur. Zack se laisse aller, incapable. La rivière chargée d’écume porte les stigmates de la cascade franchie et reprend son cours épuisée. Inoffensive. Neil Young murmure les dégâts causés par la drogue. Every junkie’s like a settin’ sun. Dehors, le soleil a définitivement investi la journée. La machine expire son dernier souffle de vie d’un double bip qui éteint l’écran. Chaque drogué est comme un soleil couchant. Zack se lève, saisit une serviette et y enveloppe son visage. Puis il plie la machine morte, la rendant aux charmes mystérieux d’un art incertain. Démembrée, désorganisée. La sculpture de plastique et d’acier retrouve sa place dans le bureau, coincée sous la fenêtre entre le radiateur et la porte.
L’eau de la douche emporte avec la mousse du savon les déchets de la souffrance. Zack est neuf, immaculé. Ses poumons piquent comme ceux d’un nouveau né. Ses muscles ressuscitent, son esprit se lève. Un jour, Zack calculera qu’en une année, il a rejoint la Corse depuis Nice. Il ne sait pas s’il reviendra un jour. En vélo peut-être.
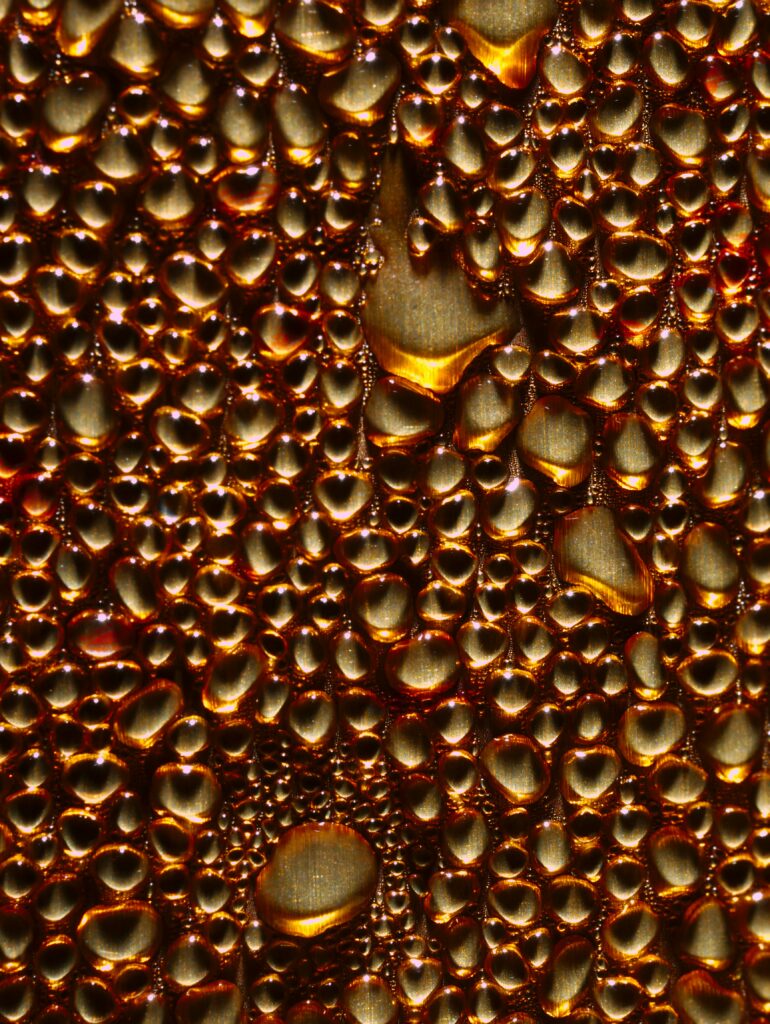
Photo de Michael Dziedzic sur Unsplash
ai beaucoup aimé cette phrase « Les premiers coups de rames appartiennent encore à la nuit », je ne sais pas pourquoi, comme un geste entre la nuit et le jour, encore dans le rêve
arghh, ce côté machine…
le paragraphe 4 entraîne à voler sur une lagune, une surface d’eau lisse quelque part… encore le rêve qui me prend à te llire
Merci Françoise. Du mal à me défaire du rêve. Un terreau.
C’est beau cette machine vivante qui respire, râle et qui finit par mourir.
c’est beau aussi de suivre ce corps de l’avant à l’après. Avec les nuances de lumières qui l’entoure. Au delà de l’effort du rameur il y a le rêve qui vient, le fait d’emporter le monde avec soi, même en restant sur place, d’explorer son envers.
Merci Françoise. Explorer l’envers, ramer la tête en bas sur le dessous des nuages. Ça vaudrait un voyage…
J’aime beaucoup le passage sur les rameurs : les volants, les « creusants » , les androïdes… j’aime ce voyage immobile sans eau qui fait parcourir des mondes intérieurs, et au cours duquel il se retrouve en eau… (un ami chorégraphe m’avait dit il y a longtemps que l’entraînement le plus complet se faisait sur un rameur.)
Je ne sais pas pour quelles raisons s’entraîne Zack. Danseur, oui, ça correspondrait bien à la silhouette de l’ombre qu’il laisse derrière lui. Merci Nathalie.
si vrai… distance entre les bateaux aigus comme de gigantesques insectes glissant propulsés par des sportifs et le banc de torture de ceux qui s’entretiennent ou se re-éduquent sas avoir toute une vie de cet effort (souvenirs, même si j’en restais à avant le banc, à un mime avec élastique)
belle façon de nous rendre les gestes et duleurs de ce corps (suis moulue)
Merci Brigitte. Zack a un rapport parfois conflictuel avec ce corps qui a des exigences que sa raison veut ignorer.
Machine triviale qui s’humanise, qui fusionne avec le personnage, comme une transe accompagnée de notes de musique
beaucoup apprécié ce texte