
« En souvenir d’André » est littérature, précisément parce qu’il s’attaque à bien plus grand – et que la langue y garde sa part essentielle – plus « Le cahier de transmissions » sur publie.net
Après, ce sont mes questions. C’est peut-être ça la supériorité du web sur la critique littéraire dans les journaux, on peut procéder autrement, on peut tenter d’aller au contact direct, on peut s’en tenir à son soi, on peut même se dispenser de discours. Juste quelque divagations, mais wincklériennes.
Je ne sais pas s’il dirait ça lui aussi, en réciproque, mais je me considère comme un proche de Martin Winckler. D’abord parce que j’ai lu son premier livre, et que le hasard a fait qu’on se soit rencontré peu après. Je n’ai plus cessé de le lire. Comme avec les autres amis auteurs, les rencontres sont rares, on est tous sur des chemins qui se croisent peu, mais ce sont des rencontres qui prennent le même timing que les livres.
Ainsi, lorsque peu après mon arrivée à Montréal, avant même qu’on se soit vus pour casser la croûte ensemble, je l’aperçois sur ce quai de métro ci-dessus – il ne m’a pas vu, je lance, mais sans élever la voix : « Monsieur le docteur... », et ça ne manque pas, il se retourne... Je viens de chercher dans mon disque dur à photos : quand on s’était retrouvés dans son bureau, à Montréal, je n’ai pas osé photographier, ni lui, ni son installation et ses livres. Aujourd’hui, je l’aurais fait, et je regrette de n’avoir pas d’images. Je retrouve quand même celle-ci, au salon du livre de Montréal, en haut à gauche Jean-Paul Hirsch, déjà à faire une vidéo avec son appareil photo, et en haut à droite un troisième copain.

Je ne sais pas si En souvenir d’André a à voir avec Montréal. Marc, dans son bureau, travaille parfois tard le soir, ou revient le dimanche, dans le bâtiment institutionnel de la fac quasi totalement vide. Depuis trois ans qu’il est installé à Montréal avec sa famille, il y a un effet de distance et de retrait – qu’il démentirait, puisque même là-bas maintenant il se réimplique dans l’univers médical. Et il a toujours continué site et blogs, interventions. Mais il est intégré via une fondation à un centre de recherches en éthique médicale. Donc beaucoup à réfléchir, mais dans un réfléchir ensemble. Il n’a pas laissé non plus les tâches de partage littéraire : cette année, il a pris en charge une option création littéraire à la fac d’Ottawa (à propos, si amis québécois passez là : je repartirai bien pour un semestre, US, QC ou CA, l’an prochain, ici maison vide, plus facile).
Quand j’ai lu En souvenir d’André, j’ai repensé à ces discussions avec Marc, où il disait que l’installation à Montréal c’était aussi pour renouer avec son année américaine d’autrefois, apprendre à écrire directement en langue anglaise. Pourtant, jamais il n’a écrit aussi épuré, avec autant de lumière diffractée, lumière de lapidaire.
Je sais que ces questions, celles qui concernent le soignant et le patient, celles qui concernent la responsabilité éthique de l’acte, sont de toujours présentes chez Marc. Comme toutes les questions reviennent sans cesse chez Montaigne, pas possible de dire : après tous ses livres, et Sachs le premier, il ouvre la dernière porte, ou la trappe de fond, celle qui concerne la douleur et la mort.
Par exemple, ce thème de la mort choisie, que ce soit via cette étrange histoire apocryphe de Sherlock Holmes au bout de l’âge et de la vie demandant à Watson la grâce d’une euthanasie, ou bien la réflexion à partir d’un proche qui s’en va dans le coma et c’est à vous que revient de débrancher, les cinq récits que Marc nous propose simultanément sur publie.net : Le cahier de transmissions. Et particulièrement fiers de cet honneur, et qu’il soit simultané à la parution de En souvenir d’André.
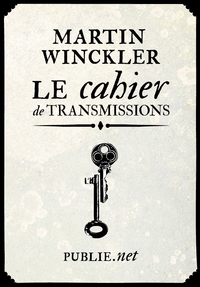
Je crois surtout que ce qui m’a impressionné dans En souvenir d’André c’est comment Marc déplace le curseur. La question du réel, convoqué, nommé, retourné sur lui-même, a toujours été présente chez Marc. La question de la narration fictionnelle s’y est toujours superposée. Parfois, quand il parle série télé, ou qu’il s’en va dans le plaisir de la nouvelle, la fictionnalité l’emporte et recouvre tout l’espace. Parfois, dans Le choeur des femmes par exemple, premier livre de son installation Montréal, c’est l’effet de superposition quasi stéréoscopique de la fictionnalité et du réel convoqué, la médecine et l’hôpital, les patientes, leur discours, la chute permanente à l’intérieur de lui-même du soignant, qui fait littéralement oeuvre, au plein sens du terme, y compris dans le côté excessif de Marc, qui donne, donne, donne, avec ses grands gestes bourrus, avec le ferraillage de ses chroniques et courriers (on se rappelle comment il a été viré de France Inter sous pression des industries du médicament, chose qui n’a probablement pas été indifférente à sa décision d’exil), qui a site et blog, une belle et vivante page facebook parce que ce n’est pas contradictoire avec la littérature, qui nous envoie de gros livres qu’on lit comme du roman-feuilleton (revendiqué pour Les trois médecins traité comme Les trois mousquetaires) par ce principe d’identification, la façon dont Marc travaille au corps notre inconscient collectif...
Dans En souvenir d’André, comme Gracq dans Lettrines 2, la fictionnalité est à échelle de ces mondes qu’il lève en quelques pages. La mort : une diffraction. Des noms, des visages qu’on sait pour soi-même référencer, dont on retrouverait la date, le lieu, probablement même adresse et numéro de téléphone, ou, pour ce qui le concerne, le numéro de sécu.
C’est un grand livre parce qu’il s’inscrit aussi là : l’absence infinie du mot roman sur la couverture gaufrée du livre POL (voir leur site pour une vue globale et des extraits, et la chaîne « vidéo-lectures » de Jean-Paul Hirsch pour une autre conversation avec Martin Winckler – il y a aussi lectures par l’auteur du dernier Pennequin).
FB
Martin Winckler | En souvenir d’André (extrait, p 43-47)
Il y avait des douleurs qui résistaient à tout.
Des douloureux qu’on n’arrivait pas à calmer.
Des visages qu’on ne parvenait pas à éclairer.
Et on ne parlait plus de douleur, alors, mais de tristesse, d’abattement ou, quand rien ne semblait agir, on se raidissait pour dire, sur un ton mécanique, métallique, qu’on avait affaire à une dépression profonde. Et on rajoutait des antidépresseurs.
Et puis, quand on avait tout épuisé, on sortait de la chambre, avant de l’être aussi. Et on y envoyait quelqu’un d’autre. Qui échouait à son tour.
Un jour, je me suis trouvé face à un de ces corps épuisés. Une femme.
« Je voudrais dormir.
– Je vais vous prescrire...
– Non. Je voudrais dormir. Vous ne m’entendez pas.
– Je vous écoute mais...
– Vous-ne-m’en-ten-dez-pas. »
Elle m’a regardé droit dans les yeux. « Je voudrais rentrer. Chez moi. Et dormir. S’il. Vous. Plaît. »
Ses mots m’ont renvoyé six ans en arrière, infirmier remplaçant, face à une autre femme fatiguée.
« Je veux rentrer chez moi. On me dit qu’il ne faut pas, que c’est trop tôt, qu’il y a peut-être encore des examens à faire. Qu’est-ce que vous en pensez ? »
Qu’est-ce que j’en pensais ?
Je pensais au résident grommelant pour lui tout seul, devant moi, comme si j’avais été un meuble, qu’il devrait avoir le courage d’annoncer à cette femme sa maladie terminale, lui dire qu’elle allait mourir et que tout ce qu’on avait à lui proposer ne pourrait que la faire souffrir un peu plus.
Je pensais au chef de clinique disant au résident que ça n’était pas à lui de dire la vérité à un patient.
Je pensais au patron disant au chef de clinique qu’annoncer sa mort à la patiente, c’était de la cruauté, c’était bien plus humain de le dire à son mari, je vous fais confiance, mon ami, vous ferez ça très bien.
Je pensais aux paroles évasives du chef de clinique s’adressant au mari de cette femme, et ses regards fuyants, et ses réponses monosyllabiques aux questions de l’homme qui tentait bravement de tenir debout sous les coups que l’autre con lui assénait sans égards et insistait : Surtout, surtout, surtout, il ne faut pas lui dire la vérité, ne lui enlevez pas l’espoir de voir ses enfants grandir même si malheureusement il n’y a plus rien à faire.
Et je pensais aussi aux paroles bonnes et tendres de cette femme rassurant doucement son mari, ce mari déchiré d’éructer des mensonges et dont les yeux hurlaient qu’il ne les croyait pas.
Quand j’ai cessé de penser, j’ai entendu ma voix.
« Vous devriez rentrer chez vous. »
C’était sorti tout seul. Mon dieu elle va comprendre et ça sera terrible, elle va s’effondrer complètement.
Sortie le soir même contre avis médical, elle est morte trois jours plus tard. Son mari est venu donner le faire-part d’obsèques à la secrétaire du médecin-chef. En repassant devant le bureau des infirmières, il m’a vu, il est entré. Je pensais qu’il allait me frapper. Il m’a tendu la main.
« Merci de lui avoir parlé. Moi aussi je voulais qu’elle rentre à la maison, mais je n’osais pas le lui dire. »
Sa voix s’est mise à vibrer.
« Merci pour ces trois jours. »
Elle m’a regardé droit dans les yeux.
« Je voudrais rentrer. Chez moi. Dormir. S’il. Vous. Plaît.
— Je fais le nécessaire. »
Elle est partie le soir même avec tout ce qu’il fallait.
Elle vivait à plusieurs dizaines de kilomètres de l’hôpital. Cette fois encore, j’ai attendu qu’un membre de sa famille vienne me faire des reproches. Mais personne n’est venu. Des mois plus tard, j’ai appris qu’elle avait dormi pendant plusieurs jours, dans sa maison, la fenêtre ouverte sur le printemps. Elle avait fini par se réveiller, elle s’était remise à manger, elle avait repris des forces.
Elle avait vu le soleil se lever, la pluie tomber.
Elle avait parlé avec ses frères, ri avec ses amies.
Et, une après-midi, à la fin de l’été, elle s’était endormie une dernière fois.
Beaucoup plus tard, un de ses frères m’a rapporté les boîtes de médicaments.
« Elle n’en a pas eu besoin. Ils pourront servir à quelqu’un d’autre. »
© Martin Winckler, éditions POL, En souvenir d’André, oct 2012.
diffusion sous licence Creative Commons CC-BY-SA
1ère mise en ligne 28 octobre 2012 et dernière modification le 31 décembre 2012
merci aux 1776 visiteurs qui ont consacré 1 minute au moins à cette page


