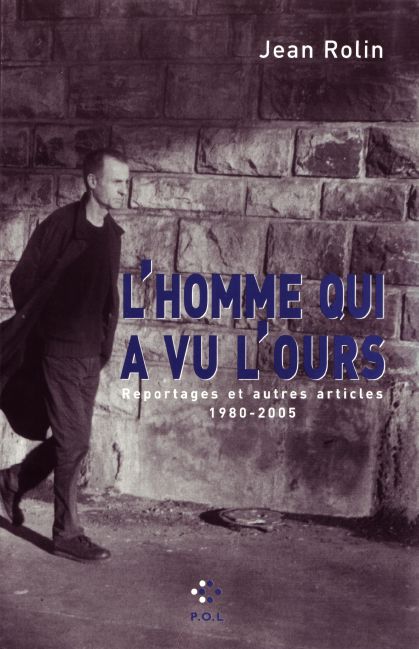
à propos de L’Homme qui a vu l’ours, de Jean Rolin
Ce matin dans la boîte (et l’enveloppe des services de presse POL n’y a pas résisté, la Poste avait renforcé par un scotch jaune à son logo), voilà L’Homme qui a vu l’ours un autre livre de 1000 pages, avec pareillement le luxe d’un papier fin et agréable sous couverture souple : oui, le livre graphique sait encore se défendre comme objet, et 25 ans de vie : la vie de reporter de Jean Rolin. L’auteur de Zone ou de Terminal Frigo dans sa vie professionnelle : est-ce qu’il y a une différence, est-ce qu’on écrit autrement ?
Disons que ce qui me fascine c’est qu’en se portant lui aux endroits de fissures, de fracture, en se confrontant à cet ailleurs nomade, Jean Rolin permet que ce soit l’affrontement de la langue et du réel qu’il nous donne à lire.
Les noms sont : Le Caire, la Crau, Tahitou en Cotentin, Beyrouth, Kartaba, les Marquises, Jericho ou Tel-Aviv, Bucarest, Tirana, Johannesbourg, Saint-Nazaire, Ormuz, Salamine, Tokyo, Singapour, Gdansk, Helsinki, Dubrovnik, Osojnik et les fleuves Amazonie, Congo, Nil, Danube...
C’est un très grand livre de voyage, mais aussi une façon où on se reconnaît tous de dire un bon merdre (Ceux qui merdrent c’est chez le même éditeur) au roman calibré 200 pages, noms de personnages de service dès la IV de couv : nous, pour la littérature, on veut le monde.
ARAN , ÎLES DE SAINTS ET D’ÉCRIVAINS
extrait de L’Homme qui a vu l’Ours reportages et autres articles, par Jean Rolin, chez POL, paraît le 16 mars - le texte ci-dessous était paru dans Air France Magazine en 2000
Dans le court mais bon livre qu’il a consacré aux îles d’Aran, Nicolas Bouvier évoque sa rencontre, à bord du petit avion qui l’achemine depuis le littoral occidental de l’Irlande jusqu’à la plus grande des trois îles, avec une jeune femme qu’il décrit comme extrêmement jolie, élégante, d’une certaine arrogance - il la qualifie même de « garce bottée », ce qui est étonnant de la part d’un auteur aussi aimable - et d’autre part plongée dans la lecture d’un roman de George Orwell. Il ajoute qu’elle tient un salon de coiffure - l’unique salon de coiffure - à Kilronan. Inévitablement, donc, et même si quinze ans ont passé entre-temps, quinze ans au terme desquels Nicolas Bouvier lui-même a eu la mauvaise idée de mourir et de nous priver de sa compagnie, inévitablement la première chose dont on s’enquiert, en arrivant a Kilronan. c’est le salon de coiffure. Or il n’y a pas le moindre salon de coiffure à Kilronan. Alors on s’obstine, on questionne, on tarabuste. et on finit par apprendre ceci : que la lectrice de George Orwell a bel et bien existé. qu’elle était jolie, en effet, qu’elle s’appelait Joséphine, qu’elle tenait l’unique salon de coiffure de Kilronan jusqu’à ce qu’elle s’éprenne d’un « garda » - un flic - en poste sur l’île, et qu’elle disparaisse avec ce dernier lorsqu’il reçut une nouvelle affectation. Ainsi ne peut-on plus se faire couper les cheveux à Kilronan, ni rencontrer cette énigmatique et littérairement attrayante jeune femme dont le départ laisse à jamais les lecteurs de Nicolas Bouvier sur leur faim. Quant à l’avion, il ne semble pas qu’il ait beaucoup changé depuis, c’est un bimoteur Islander solidement campé sur ses deux jambes bien droites et non escamotables, où le hasard, ou plutôt l’afflux tout de même très relatif de candidats à la traversée, le jour de mon propre passage, fit que je voyageai dans le siège du copilote, le manche à balai, ou le double du manche à balai, me rentrant dans la poitrine lorsque le pilote, de son côté, le tirait à lui. Juste derrière moi était assis un jeune couple d’insulaires avec un nouveau-né tout fripé et jaunâtre qui venait de voir le jour sur la terre ferme.
Imaginons une vague formée au cœur de l’Atlantique, dans le sein des tempêtes, une vague qui va son chemin, d’ouest en est, vers l’Europe. Pendant longtemps rien ne s’oppose à elle, rien ne lui réslste, tout au plus un navire, par ci par là, qu’elle soulève comme un fétu de paille si même elle n’est pas d’humeur à le submerger et à l’envoyer par le fond. Or voici que soudain un obstacle se dresse devant elle, un obstacle qui ne ressemble à rien de ce qu’elle a rencontré jusque-là : une falaise calcaire apparemment indestructible, roide et grise, culminant à près de 90 mètres d’altitude. La vague, qui a eu tout le temps de prendre son élan, l’attaque de plein fouet, explose en gerbes dont les plus formidables peuvent passer pardessus le sommet de la falaise, puis ce qu : reste de cette vague après l’explosion repart en sens inverse et se heurte à la suivante, et ainsi de suite, inlassablement, jusqu’à ce que la base de la falaise se creuse d’immenses gouffres où bouillonne l’écume, tandis que des étages supérieurs se détachent de loin en loin d’énormes quartiers de roc. Telle est aujourd’hui la situation sur le littoral occidental des îles d’Aran, mais on sent bien que la mer n’en restera pas là. et qu’elle ne se tiendra pour satisfaite que le jour où cet obstacle, à force de coups de boutoir, aura totalement disparu.
Si l’on attaque l’île d’Inishmore par sa pointe nord-ouest, on est tout de suite dans le bain. Par une journée normalement tempétueuse de la fin octobre, les îles Brannock - une poignée de cailloux auxquels un phare s’est attaché - disparaissent à demi dans une perpétuelle explosion liquide, d’une violence telle que ce spectacle, et le bruit qui l’accompagne, évoque lointainement un déchaînement d’artillerie. C’est ici, semble-t-il, que Flaherty a tourné la célèbre et catastrophique scène finale de L’Homme d’Aran, ce film magnifique auquel on peut tout de même adresser deux reproches. Le premier, c’est de prêter aux hommes d’Aran l’habitude de harponner les requins pèlerins, une pêche qu’ils n’avaient peut-être jamais pratiquée, et du moins pas de mémoire d’homme. Le second, c’est d’avoir été à l’origine de la fortune touristique de l’île d’Inishmore - et dans une moindre mesure des deux autres -, au point qu’en haute saison elle accueille aujourd’hui près de trois mille personnes par jour, et que l’on a quelque difficulté à suivre ses habitants - mais sans doute on a tort - lorsqu’ils soutiennent que la pêche reste, avant le tourisme, leur activité principale. Que sa venue dans l’île doive ou non quelque chose au film de Flaherty - elle le suit de quelques années -, l’un des visiteurs les plus remarquables d’Inishmore fut en 1937 Antonin Artaud. qui se promenait alors appuyé sur une canne dont il affirmait tantôt qu’elle avait appartenu à saint Patrick, tantôt à Jésus-Christ, et qui se signala notamment en laissant une ardoise dans la maison - peut-être appelait-on déjà ça un bed and breakfast - où il avait séjourné à Eoghanacht. Un peu plus tôt - avant le film de Flaherty -, James Joyce avait passé quelques heures à lnishmore, le temps d’écrire pour une revue italienne quelques pages qui comptent parmi les plus insignifiantes de cet écrivain colossal.
En fait, la mode littéraire des îles d’Aran avait pris naissance longtemps auparavant, dans les dernières années du siècle passé, lorsque le dramaturge John Synge, obéissant à une injonction de William Butler Yeats, s’était arraché aux miasmes parisiens pour venir gaéliser à Inishmaan, une île où il séjournera longuement, à plusieurs reprises, et d’où il rapportera, outre quelques chefs d’œuvre tels que Le Baladin du monde occidental, un petit livre plein d’embruns, de tempêtes et de diableries, intitulé Les îles d’Aran. Ces dernières ne se sont d’ailleurs pas contentées d’attirer des écrivains, elles en ont aussi fabriqué quelques-uns. (Beaucoup moins que de saints, il est vrai : rien que dans le cimetière de Teaghlach Einne, où saint Enda - un évangélisateur athlétique, qui franchissait les mers dans une auge de pierre passe pour reposer depuis près de quinze siècles, pas moins de cent vingt saints seraient enterrés avec lui, non loin de Tiger King - l’« homme d’Aran » et d’une paire de naufragés anonymes du Lusitania.) Le plus célèbre d’entre eux est incontestablement Liam O’Flaherty, l’auteur du Mouchard et d’Insurrection, né en 1896 dans le village - ou le hameau - de Gort na gcapall, peut-être le dernier, sur Inishmore, à présenter encore un tel caractère de perfection dans le dépouillement (à ma connaissance, Gort na gcapall n’offre fort heureusement aucun bed and breakfast, et pas la moindre commodité. En revanche, on y voit sécher sur les murs des filets, des casiers et d’autres engins de pêche). Si de Gort na gcapall on se dirige vers la mer, sur un chemin d’abord bien tracé, puis moins bien, puis plus du tout, on tombe un jour ou l’autre sur cette curiosité géologique appelée the wormhole, un trou dans le roc, de la taille à peu près d’une piscine, où la mer se débat avec son habituelle fureur, et qui constitue, pour paraphraser Nicolas Bouvier, l’un des très rares rectangles parfaits que la nature se soit offerts (certains ont voulu voir dans le wormhole une porte d’entrée du continent perdu, mais il s’est avéré qu’il ne menait nulle part). Si l’on se tient sur le rebord de la falaise avec à ses pieds le wormhole, en face de soi les vagues monstrueuses, tonnantes, follement crêtées d’écume, exerçant sur l’esprit une fascination peut-être dangereuse à la longue, si l’on se tient ainsi on découvre à main droite une pente aride, assez forte, hérissée de murets de pierres savamment empilées (savamment et non à la va comme je te pousse, afin que le vent, au lieu de les renverser, passe à travers), par où le littoral occidental d’Inishmore se hausse vers son point culminant, où l’un de ses points culminants, marqué par les trois enceintes semi-circulaires, ouvertes sur le vide, de Dun Aengus (ou Dun Aonghasa), ce curieux édifice datant vraisemblablement de l’âge du bronze mais dont on ne sait toujours pas à quoi il pouvait servir. A main gauche la falaise s’élève également, mais moins vite et moins haut, et si on la suit, en prenant tout de même garde de ne pas tomber - cela s’est vu -, dans une solitude vertigineuse, côtoyant des abîmes dont le seul souvenir vous fait encore dresser les cheveux sur la tête, on finit, si Dieu le veut, par atteindre Dun Duchathair (le « Fort noir »), un monument tout aussi énigmatique que le précédent. Enfin, au milieu, il y a un chemin, et c’est celui-là que je préfère, même s’il ne ménage pas de vues aussi spectaculaires que le chemin - ou le non-chemin - des falaises. Au milieu de quoi ? Au milieu de l’île, bien sûr, le long de ce qui constituerait son épine dorsale si elle en avait une, entre Gort na gCapall - en fait, depuis Port Mhuirbhigh - et la plage d’An Poll Mor. Ce chemin est comme un songe, il est un peu, si l’on veut, comme certains paysages de la peinture italienne avant l’invention de la perspective. Il est dans la réalité, sans doute, et cependant à côté d’elle. Il est aussi, si je puis me permettre, le chemin absolu, entre ciel et mer, une ligne à peu près droite dans un labyrinthe de murets de pierres, atteignant par moments ce point extrême de la vision où il n’y a pratiquement plus rien à voir, et où ce rien est tout : quelque chose comme ce que Rimbaud dit de l’Éternité. Pour revenir sur terre, pour respirer, précisons maintenant que les îles d’Aran sont peut-être le seul endroit d’Europe où les chiens - il y en a beaucoup - savent se tenir. Au lieu d’aboyer au nez des marcheurs ou de mordre les pneus des bicyclettes, ils les regardent passer dans une indifférence complète, princière, et si parfois ils se déplacent, c’est uniquement pour se faire gratter le crâne, apparemment parce qu’ils vous ont trouvé une bonne tête (la tête de quelqu’un qui aime beaucoup les chiens quand ils la bouclent). Ainsi nous cheminons - je chemine - entre Port Mhuirbhigh (quelle langue, le gaélique, pour mettre trois h dans un seul mot ... ) et An Poll Mor.
Au-dessus de moi le ciel, à ma droite, dans le lointain, la mer. Bientôt le chemin cesse d’être asphalté pour devenir herbu et caillouteux. Une averse soudaine me force à trouver refuge à l’abri d’un muret, et le passage du grain transforme à trois reprises - avant, pendant, après la physionomie de l’île et du monde extérieur. Quand la pluie cesse, on remarque que l’île et ses murets, ses haies, ses champs taillés à la masse dans le calcaire éclaté, raviné, sont pleins d’oiseaux comme l’étaient les nôtres - nos champs, si c’est une façon de parler - avant qu’on les remembre, qu’on les épile, que l’on y répande des engrais azotés et des herbicides pour y faire pousser du maïs, entre toutes les plantes la plus stupide et la plus laide. Il y a tant d’oiseaux - des corbeaux, des choucas, des faucons crécerelles, des courlis, des vanneaux, des pies, des rouges-gorges, des chardonnerets, des merles, des grives, des accenteurs, des traquets de plusieurs sortes, des bergeronnettes, des troglodytes - que c’est à donner le tournis. Tout ça chante et gazouille à s’en faire péter, s’ils en ont, les cordes vocales. Et des papillons, même à la fin du mois d’octobre.
Et dans certains de ces prés enclos de murets aux pierres savamment empilées, comme dans un immense et zoologique jeu de l’oie, il y a tantôt un âne solitaire (et lui aussi aime bien qu’on le regarde dans les yeux et qu’on lui frotte le museau), tantôt deux chèvres blanches, tantôt un taureau mugissant, ou une vache rousse avec son veau, tantôt un cheval noir et tantôt un nombre indéterminé de moutons ridicules et bêlants. On marche, on marche, les siècles fuient au loin comme des orages, plus ça va et plus il semble que ça ne devrait jamais finir. Et puis on redescend, il le faut bien, vers Kilronan, cette bourgade où il n’y a même plus un salon de coiffure mais encore un certain nombre de pubs. À la périphérie de Kilronan. des touristes japonais effarés, sac au dos, photographient une statue en plâtre de la Vierge Marie comme s’il s’agissait de l’ange de Reims. Le XXe siècle, on nous l’a dit, s’achemine vers sa fin. Après, soyez-en sûrs, il y en aura d’autres. L’idée, c’est d’arriver à Kilronan avant la fermeture du Spar - supermarket, coffeeshop, news-agent - et d’y acheter l’Irish Times pour prendre connaissance des dernières et mauvaises nouvelles de l’homme.
© Jean Rolin _ POL 2006

